|
CHAPITRE 1 : LES ANNÉES 1990 : UN BON DÉPART
Le gouvernement fédéral a modifié sensiblement,
en 1992, la façon dont le secteur des services financiers fonctionne
au Canada. La division du secteur en « quatre piliers » a pour
ainsi dire disparu à la suite de ces réformes. Depuis 1992,
la gamme des services financiers que toute institution financière
à charte fédérale pouvait offrir était quasi
illimitée. Cela s'est fait en partie en renforçant les pouvoirs
internes des institutions, mais surtout en autorisant une catégorie
d'institution d'avoir une filiale dans un autre domaine financier. C'est
ainsi que les banques possèdent aujourd'hui des courtiers en valeurs
mobilières, des sociétés de fiducie et des compagnies
d'assurances, et que des compagnies d'assurances possèdent des sociétés
de fiducie et des banques. Une grande coopérative de crédit
de la Colombie-Britannique, la Vancouver City Savings, est propriétaire
de la Banque Citizens. La Fiducie Trimark appartient à une société
de fonds communs de placement 1.
Le visage du secteur a donc beaucoup changé, grâce surtout
à ces modifications législatives, depuis 1992.
Les événements économiques et financiers ont aussi
contribué fortement à modifier le secteur financier. Les
sociétés de fiducie indépendantes, parmi lesquelles
seul le Canada Trust continue d'assurer une présence notable, ont
presque disparu. Certaines ont été acquises par des banques,
mais la disparition de ce secteur vient de l'impossibilité pour
elles de survivre et de soutenir la concurrence dans un monde en évolution.
À bien des égards, les changements apportés en 1992
pour leur permettre de mieux concurrencer les banques sont venus trop tard.
L'effondrement des piliers
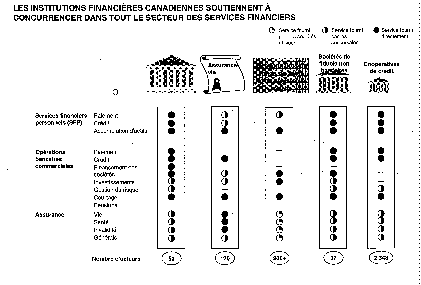
Source: Pièce 2-18 McKinsey & Company
Reconnaissant la nécessité de réformes constantes
dans un monde en rapide évolution, le gouvernement avait décidé,
au lieu d'examiner le cadre législatif des banques tous les 10 ans,
de procéder, à partir de 1997, à un examen quinquennal,
et ce, pour l'ensemble du secteur financier. Face aux faillites de plusieurs
sociétés de fiducie et de compagnies d'assurance-vie, le
secrétaire d'État (Institutions financières internationales)
a publié, en 1995, une étude intitulée Renforcer
et assainir le secteur des services financiers canadien. Les mesures
proposées visaient surtout à réduire le risque, à
protéger le consommateur et à renforcer la surveillance gouvernementale.
L'étude et la mesure législative qui en a découlé
étaient motivées par le désir de solidifier le système
financier. C'est ainsi que le mandat du Bureau du surintendant des institutions
financières (BSIF) a été établi et que la Loi
sur la Société d'assurance-dépôts du Canada
(SADC) a été modifiée de manière à permettre
l'adoption de règlements créant des primes de risque.
Le livre blanc intitulé L'examen de 1997 de la législation
régissant les institutions financières : propositions de
modifications, publié en 1996, a été le point
de départ des modifications législatives proposées
dans le projet de loi C-82. Cet examen visait à déterminer
si le cadre établi en 1992 était toujours valable et si les
buts des réformes antérieures étaient atteints.
Le livre blanc était l'aboutissement de consultations amorcées
en 1995 auprès des intervenants du secteur. L'annonce que le gouvernement
fédéral voulait étendre l'option de la démutualisation
aux grandes compagnies d'assurance-vie, comme aux petites, en a été
l'un des principaux résultats; un projet de règlement relatif
à ces conversions a paru en août 1998 et un projet de loi
a été déposé le 30 novembre de la même
année. Il était pourtant clair, aux yeux du gouvernement,
que le livre blanc et le processus qui l'a précédé
ne sauraient contrer efficacement certaines des forces très vives
de changement qui façonnaient le milieu mondial des finances et
rendaient les institutions financières canadiennes moins aptes à
s'adapter aux changements économiques, technologiques et démographiques.
De profondes réformes s'imposeraient vraisemblablement pour que
le Canada jouisse d'un secteur de services financiers de classe internationale.
Le gouvernement a donc chargé un Comité consultatif sur
le système de paiements d'examiner ce dernier, en lui demandant
de collaborer aux travaux du nouveau Groupe de travail sur l'avenir du
secteur des services financiers canadien, auquel il a confié l'étude
de tous les aspects du secteur. Le Rapport de ce Groupe de travail faisait
l'objet de notre propre étude et constitue le sujet du présent
Rapport.
En moins d'une décennie, comme nous l'avons mentionné,
une branche entière du secteur des services financiers (celle des
sociétés de fiducie indépendantes) a presque disparu.
Aussi dramatique qu'il puisse paraître, ce changement n'est qu'un
des nombreux événements qui se sont produits, et il n'est
rien en regard de ce qui semble se dessiner dans un très proche
avenir.
Les dépôts gardent une place importante parmi les actifs
financiers des ménages, mais leur croissance par rapport à
celle de l'actif global plafonne et elle devrait diminuer progressivement.
(Ce renseignement et tous les autres sont tirés des documents d'information
préparés pour le Groupe de travail sur l'avenir du secteur
des services financiers canadien.)
Les Canadiens acquièrent aujourd'hui des services financiers
bien différents de ceux qu'ils achetaient il y a quelques années
à peine. Il suffit, pour le faire ressortir, de songer à
la croissance explosive de l'industrie des fonds communs de placement.
Les Canadiens ont toujours eu la réputation d'être des épargnants
prudents. Rassurés par la garantie qu'offre un régime d'assurance-dépôts,
ils plaçaient jusqu'ici leurs économies dans des comptes
bancaires ou des certificats de placement garantis et achetaient de l'assurance-vie.
Rien de bien risqué. Pourtant, de la fin de 1991 au milieu de 1998,
les actifs nets des fonds communs de placement du Canada sont passés
de 50 milliards de dollars à 323 milliards. D'autre part, les dépôts
ont cessé de croître et régressent même lentement
d'un sommet d'environ 450 milliards de dollars. Le fait que les actifs
des fonds communs de placement pourraient dépasser les dépôts2
dans quelques années témoigne d'une partie des changements
rapides qui se produisent. Les produits et les institutions financières
traditionnels ne nous servent manifestement plus de moyens d'épargner.
En plus de montrer l'évolution de ce que le consommateur demande,
cela comporte de réels engagements pour les institutions pour lesquelles
les dépôts sont la forme traditionnelle d'entrée de
capitaux. Il leur faut maintenant financer par d'autres moyens les prêts
et les investissements que les dépôts leur permettaient de
financer dans le passé.
Depuis 20 ans, le pourcentage des avoirs des ménages investis
dans les comptes d'épargne a diminué de 31 % à 25
%, tandis que la partie investie dans les fonds mutuels est passée
de 1 % à 14 %.
Servis de manières différentes, les Canadiens se voient
offrir des produits par des institutions absentes de ce marché il
y a peu de temps encore, comme ING Direct, Banque Citizens, MBNA, mbanx
et Wells Fargo. Nous faisons des transactions financières par téléphone
et par Internet, et nous avons adopté en masse la carte de débit
comme moyen de paiement. Ce sont ces changements, dont la demande du consommateur
est le moteur, et la mondialisation du marché financier qui déterminent
le nouvel environnement des services financiers. Les institutions financières
adoptent aussi de nouvelles technologies pour offrir leurs services, et
les consommateurs n'ont qu'une petite idée de ce que l'avenir nous
réserve à cet égard.
Lorsqu'il envisageait, dans les années 1980, des façons
d'intensifier la concurrence des grandes banques canadiennes, le gouvernement
songeait à des institutions assez semblables à nos propres
banques, aux filiales de banques étrangères de l'annexe II
et aux sociétés canadiennes de fiducie. De nos jours, les
nouveaux concurrents des banques canadiennes sont toutefois des institutions
qui ne veulent pas ressembler aux banques canadiennes traditionnelles.
Nous avons ainsi des banques qui n'ont aucune succursale, des guichets
bancaires dans les supermarchés et des cartes de crédit d'institutions
étrangères dont c'est l'unique produit et par rapport auxquelles
les activités de cartes de crédit de nos propres banques
sont peu de choses. Nos petites entreprises obtiennent par ailleurs des
prêts d'une banque californienne qui n'a aucun bureau au Canada.
Nous achetons des polices d'assurance par téléphone, nous
faisons des transactions bancaires par Internet, et l'argent liquide disparaît
graduellement de notre société. Notre paie est déposée
directement dans notre compte en banque dont sont automatiquement débitées
nos factures mensuelles. Le monde de 1998 diffère grandement de
celui de 1992, et il n'y a aucun doute que celui de 2002 sera encore très
différent.
La vague mondiale de regroupements, concentrée surtout aux États-Unis,
mais aussi en Europe, est l'autre élément dominant du secteur
des services financiers. En Europe, le désir de réduire les
coûts et de profiter de l'union monétaire prochaine pousse
les sociétés à fusionner. Aux États-Unis, cela
découle surtout des réformes législatives qui permettent
enfin la création de banques nationales, comme c'est déjà
le cas au Canada. BankAmerica s'est lancée, par exemple, dans une
série de fusions, si bien que ses transactions s'étendent
maintenant d'un océan à l'autre et que ses actifs dépassent
d'environ 75 % ceux de la Banque Royale et de la Banque de Montréal
conjugués. Elle est pourtant présente dans moins de la moitié
des États de notre voisin du Sud. La fusion, aux États-Unis,
de Citicorp (une banque) et de Travelers (une institution financière
non bancaire) est aussi frappante. À la limite de ce que la législation
américaine actuelle autorise, elle a donné naissance à
un conglomérat financier semblable, quoique beaucoup plus gros,
à ceux qui caractérisent déjà l'industrie bancaire
canadienne.
Cette tendance aux acquisitions et aux fusions se manifeste aussi au
Canada. Depuis 1992, les institutions financières canadiennes sont
devenues de véritables conglomérats financiers. En 1997,
la Great-West a ravi la London Life à la Banque Royale. Le plus
dramatique cependant, c'est que certaines banques canadiennes aimeraient
participer à ce mouvement de fusions; la Banque Royale a proposé
de fusionner avec la Banque de Montréal en janvier 1998, puis la
Banque Canadienne Impériale de Commerce a annoncé en avril
son intention de fusionner avec la Banque Toronto-Dominion. Ces fusions
ne sont l'objet ni du Rapport du Groupe de travail, ni du présent
Rapport du Comité. La forme du secteur des services financiers qui
émergera, une fois que le Rapport du Groupe de travail aura fait
l'objet de débats et qu'on y aura donné suite, constitue
néanmoins le contexte dans lequel ces projets de fusion et ceux
qui suivront seront évalués. Les pressions à la fusion
et à la restructuration persisteront au Canada et dans le monde.
Nous examinerons ici les mesures recommandées par le Groupe de travail
pour faciliter la fusion et la méthode d'évaluation de ces
transactions proposée par le Groupe de travail pour s'assurer qu'elles
sont dans l'intérêt du public.
Le Rapport du Groupe de travail deviendra sans doute l'un des documents
les plus importants sur les services financiers jamais produits au Canada.
Il redéfinira le secteur financier tout comme la Commission Porter
l'a fait il y a trois décennies. Ce Rapport ne traite pas des projets
de fusions bancaires. Son importance vient du fait qu'il porte sur une
industrie, aussi vaste que changeante, qui est absolument vitale tant au
bien-être des Canadiens qu'au bon fonctionnement de notre économie.
Cette branche d'activité transcende les activités bancaires
et les banques prises isolément.
Le Rapport MacKay est excellent. Il est très équilibré.
Parfois, en le lisant, je me disais qu'il cherchait à plaire à
tout le monde dans les milieux financiers. C'est une chose très
difficile à faire, mais je trouve que le groupe a fait un excellent
travail.
Liam Hopkins (directeur exécutif, IFC Vancouver)
Le secteur des services financiers forme à bien des égards
une industrie sans pareil. Comme toute autre branche d'activité,
il sert la clientèle en lui fournissant les produits et les services
demandés. Des entreprises canadiennes y participent, créant
du même coup de la richesse et des emplois. Ce secteur emploie directement
plus de 550 000 Canadiens et compte pour 5 % de notre PIB, en plus de contribuer
20 % des impôts fédéraux sur le revenu des sociétés
et de verser un montant total de 8,5 milliards de dollars en taxes chaque
année. C'est aussi une grande industrie d'exportation, puisque plus
de 30 % des recettes bancaires et d'assurance-vie viennent de l'étranger.
Certaines institutions sont beaucoup plus tournées vers l'exportation.
La Banque de Montréal tire 58 % de ses recettes de l'étranger,
et la Financière Manuvie, 55 %. Environ les deux tiers des prêts
consentis par Newcourt Credit, une des institutions financières
canadiennes qui croît le plus rapidement, le sont maintenant à
l'étranger.
Je travaille dans le domaine des politiques depuis des années
et j'ai lu de nombreux rapports, mais je dois dire que ce rapport est l'un
des meilleurs que j'aie lus. Il est équilibré, clair et bien
rédigé. Je tenais à le signaler.
Peter Nares (directeur exécutif, Self-Employment Development
Initiatives)
D'après la revue The Banker, les banques canadiennes ont
une optique tout à fait mondiale. Si on les classait en proportion
d'actifs étrangers, elles viendraient au 20e (CIBC), au 21e (Banque
de Montréal), au 27e (Banque Scotia) et au 39e (Banque Royale) rang
parmi les banques mondiales. La CIBC et la Banque de Montréal ont
toutes deux 44 % d'actifs étrangers, et cette dernière tire
58 % de ses revenus de l'étranger, contre 49 % pour la Banque Scotia
et 28 % pour la Banque Royale.
Plus de la moitié de toutes les obligations de sociétés
canadiennes sont aujourd'hui émises sur les marchés étrangers
tout comme 20 % de toutes les obligations du gouvernement canadien.
La Banque de Montréal et la CIBC présentent, sur ce plan,
un caractère plus mondial que la Chase Manhattan, la Banque de Tokyo
et ING.
Le penchant à l'exportation du secteur financier canadien montre
qu'il est possible de servir la clientèle au loin à partir
du Canada. Nous commençons cependant à reconnaître
que les institutions étrangères peuvent aussi, de très
loin, servir les Canadiens.
Une vision possible du Canada est celle où nous sommes présents
à la table des négociations à titre de principal centre
financier en Amérique du Nord (contrôlé par des Canadiens
et dont le siège social est au Canada) et qui a une influence sur
les affaires financières mondiales. L'autre possibilité est
de quitter notre piédestal et de perdre graduellement notre influence
sur les affaires financières et, par le fait même, sur les
affaires mondiales. Le Canada demeurera peut-être un marché
financier sain du point de vue national, mais il ne constituera pas une
force financière mondiale.
Charles Baillie (président et chef de la direction,
Banque Toronto-Dominion)
Le Grand Toronto métropolitain (GTM), qui forme le principal
centre canadien de services financiers, avec plus de 165 000 emplois directs
dans ce secteur en 19953,
pourrait devenir un centre régional de services financiers en Amérique
du Nord. Il vient au troisième rang, derrière New York et
San Francisco, pour la concentration de ses services financiers en Amérique
du Nord. Comme la moitié des emplois dans ce secteur sont susceptibles
de déménager ailleurs, le GTM pourrait facilement, par contre,
se retrouver avec un rôle bien réduit et beaucoup moins d'emplois.
Le Boston Consulting Group a analysé les catégories d'emplois
dans le secteur des services financiers afin de déterminer lesquels
sont mobiles et pourraient, de ce fait, quitter le GTM, voire le Canada.
Les emplois sont catégorisés comme exportés (c.-à-d.
ceux qui peuvent être situés ailleurs) ou non exportés
(c.-à-d. ceux qui, à l'heure actuelle, doivent être
faits régionalement). Cinquante-cinq pour cent des emplois sont
considérés comme exportés et 45 %, comme non exportés4.
Sur les emplois exportés, un tiers sont considérés
comme bien ancrés dans le GTM, alors que les deux tiers pourraient
être mobiles. Parmi les emplois bien ancrés, il y a notamment
ceux-ci :
- Les fonctions du siège d'une banque
- Certaines fonctions de banques d'entreprise
- Le commerce de produits en dollars canadiens
- Les activités de placement liées aux assurances.
Dans le cas des emplois dans les sièges sociaux de banques, il
est présumé que le contrôle demeurera entre des mains
canadiennes.
Parmi les emplois exportés considérés comme possiblement
mobiles, il y a notamment ceux-ci :
- Les services de soutien, spécialement les centres d'informatique,
de traitement des données et d'appels
- La plupart des fonctions bancaires liées aux placements
- Les activités de l'assurance-vie et de l'assurance- maladie.
Quarante-cinq pour cent de tous les emplois sont considérés
comme non exportés. Mais la technologie a un impact grandissant
sur la mobilité des emplois. Sur les emplois non exportés,
40 % deviendront des emplois exportés et mobiles. Parmi ces emplois
qui évoluent, mentionnons:
- Les fonctions de ventes au détail effectuées au téléphone
ou sur Internet
- Les centres de traitement des données.
Parmi les emplois qui devraient demeurés non exportés
dans l'avenir, on note :
- Les services de conseil personnels
- Le réseau de banques au détail
- La planification financière personnalisée.
Ces emplois non exportés représentent un peu plus du quart
de tous les emplois.
C'est la technologie qui est responsable de la nature évolutive
des emplois et de la situation géographique des occasions d'emploi.
Avec la baisse des coûts des télécommunications et
des services informatiques, ainsi que le perfectionnement de la technologie
d'imagerie, des fonctions qui par le passé se faisaient sur place
peuvent maintenant se faire dans un endroit centralisé. Mais cela
signifie aussi que les emplois qui se font maintenant à proximité
des sièges canadiens des institutions financières, pourraient
se faire ailleurs, voire à l'extérieur du Canada. Ces emplois
demeureront au Canada seulement si le secteur financier est assez compétitif
pour qu'il soit rentable de les garder ici.
Les Canadiens ont été avantagés du fait que nos
institutions ont des ambitions mondiales et qu'elles créent des
emplois au pays pour servir les marchés mondiaux. Rien ne garantit
qu'il continuera d'en être ainsi. Presque tous les facteurs de production
deviennent de plus en plus mobiles. Pour les attirer et les retenir, il
faut un cadre qui permette aux institutions financières d'être
compétitives.
L'apport du secteur des services financiers à l'économie
n'est donc pas négligeable, mais son importance vient surtout du
rôle spécial qu'il y joue. Contrairement à d'autres
secteurs, c'est un élément vital de quasi toutes les transactions
économiques. Le secteur financier imprègne tellement l'économie
qu'il influe sur son fonctionnement de façon qu'aucune autre branche
d'activité ne pourrait égaler. C'est de lui que dépendent
vraiment, par le processus d'intermédiation financière, le
bon fonctionnement et l'efficacité de l'économie. Ceux qui
désirent épargner n'ont pas à trouver d'emprunteurs
dignes de confiance. Les institutions financières le font pour eux.
En plus de réduire fortement les coûts des transactions liées
à l'épargne et aux emprunts, cela atténue sensiblement
les risques auxquels les épargnants s'exposent. Ces derniers n'ont
pas besoin de savoir évaluer le risque que présentent des
emprunteurs ou des projets d'investissements particuliers, car les institutions
spécialisées le font pour eux. Et comme elles y affectent
des experts, elles réalisent des économies d'échelle
et de gamme.
Une autre fonction importante du secteur financier consiste à
assurer un système efficace de paiements, et celui du Canada fait
l'envie du monde entier. Des moyens de transaction sûrs et efficaces
favorisent les échanges économiques. Cela permet, en outre,
aux intervenants de se spécialiser et donc de maximiser les rendements.
Pour que son économie prospère, le Canada a besoin d'un
secteur des services financiers qui, tout en étant solide, stable,
efficace et compétitif, sache innover et offrir aux Canadiens une
vaste gamme de choix. Les institutions doivent s'adapter à mesure
que le monde qui les entoure évolue. Bref, il nous faut un secteur
des services financiers de classe mondiale.
La rapidité des changements, dont la technologie est l'un
des moteurs, touche le secteur financier. La chute rapide des frais de
télécommunications et de traitement des données permet
maintenant d'offrir des services financiers selon des façons et
à des endroits impossibles jusqu'ici, et qui pourraient se révéler
dépassés et peu rentables demain. Les transactions peuvent
se faire très rapidement. Ces changements amènent certaines
institutions à se restructurer de fond en comble pour centraliser
la prestation des services, au lieu de les offrir sur place comme elles
le faisaient dans le passé. Certaines institutions adoptent aussi
l'impartition pour certaines activités. Si certaines se lancent
dans de nouveaux créneaux, d'autres abandonnent ceux où elles
ne peuvent pas faire concurrence et d'autres encore forment des coentreprises.
Tous ces changements visent à réduire les coûts, ce
que l'apparition de nouveaux concurrents rend nécessaire.
Nul doute que la puissance des ordinateurs continuera à grimper
et les prix, à baisser. En 1982, les microprocesseurs ayant une
capacité d'un million d'instructions par seconde (c.-à-d.
un MIP) coûtaient près de 1 000 $. Aujourd'hui, un MIP coûte
environ 1,30 $; dans 10 ans, nous estimons qu'il coûtera autour de
0,001 $.
L'évolution technologique a aussi eu pour résultat de
faire apparaître de nouveaux produits financiers, surtout dans le
système de paiements, mais aussi sous forme de produits destinés
à réduire le risque et à accroître les possibilités
d'obtenir un meilleur rendement sur l'épargne. Le commerce des produits
dérivés, les cartes de débit et les cartes à
valeur stockée en sont des exemples. Ces changements ont ceci de
frappant qu'ils n'avantagent pas que les grandes institutions ou les riches;
les familles canadiennes typiques en tirent aussi des avantages tangibles.
Par exemple, les Canadiens qui ne peuvent pas investir plus en valeurs
étrangères à l'intérieur de leur REER peuvent
acheter des fonds communs de placement dont le rendement est lié
à des indices boursiers américains, ce qui a pour effet de
court-circuiter la limite de 20 % en valeurs étrangères imposée
aux investisseurs. Les Canadiens qui veulent la sécurité
d'un certificat de placement garanti (CPG) tout en s'exposant à
une partie des risques que présentent les investissements en valeurs
mobilières peuvent acheter un CPG dont le rendement est lié
à des indices boursiers canadiens. Ce sont les nouveaux produits
dérivés qui le permettent dans les deux cas5.
Les principales banques de gros sur la scène mondiale mettent
au point, en moyenne, un nouveau produit par semaine. Dans la plupart des
grandes banques d'investissement, il y a un groupe ou des groupes de mathématiciens
et de statisticiens diplômés qui s'efforcent sans cesse de
concevoir des ensembles de produits tant pour les émetteurs que
pour les investisseurs.
L'évolution de la technologie du savoir transforme aussi le secteur.
La mise au point de techniques d'évaluation de la cote de crédit
en vue d'évaluer le risque permet aux institutions d'examiner rapidement
les demandes de prêt à peu de frais. Par son système
de demande et d'approbation de prêts via Internet, mbanx est en mesure
d'approuver une demande d'hypothèque en 30 secondes dans 80 % des
cas. Les frais administratifs des prêts évalués ainsi
s'en trouvent fortement réduits. Les institutions peuvent maintenant
accorder à profit de petits prêts qu'elles ne pouvaient pas
offrir dans le passé.
Les logiciels perfectionnés d'analyse des données,
par exemple, ont permis aux institutions financières de concevoir
des programmes de marketing par bases de données sophistiqués
et hautement prédictifs. Des sociétés de cartes de
crédit ultraperformantes, comme la MBNA, ont exploité avec
succès ces programmes pour cibler des clients à valeur élevée
avec plus d'efficacité sur leurs marchés tant intérieurs
qu'étrangers.
La nouvelle technologie du savoir et de nouvelles méthodes de
marketing permettent aussi à des prêteurs comme la Wells Fargo
de servir le marché canadien à distance. Ce genre de service
ouvre tout grand le marché interne et répond au désir
des consommateurs d'obtenir plus de choix en faisant abstraction des initiatives
gouvernementales.
Le vieillissement de la population est une autre forme de changement
qui influe sur l'évolution du secteur. Qui plus est, la structure
d'âge de la population est telle que ceux pour qui l'épargne
est d'une importance primordiale prennent plus d'importance par rapport
à ceux qui se soucient davantage d'obtenir des capitaux. Pour les
institutions financières, les ménages sont non seulement
des clients qui ont besoin de capitaux, mais ils sont aussi de plus en
plus des clients qui ont besoin d'aide pour gérer leur patrimoine.
C'est pourquoi les institutions s'efforcent toujours davantage d'établir
des relations d'affaires globales avec leurs meilleurs clients.
Quelque 9,8 millions de Canadiennes et de Canadiens, soit environ
le tiers de la population, jouent un rôle prépondérant
sur le marché des services financiers de détail.
L'accent mis sur la gestion du patrimoine découle, outre le vieillissement
de la population, de plusieurs changements. La fortune se transmet d'une
génération à l'autre par de gros transferts forfaitaires
qu'il faut gérer sagement. Enfin, les Canadiens travaillent de plus
en plus à leur compte, de sorte qu'ils doivent pourvoir eux-mêmes
à leurs allocations-santé et à leurs prestations de
retraite. Pour servir ces Canadiens, nos institutions financières
doivent relever de nouveaux défis et se recentrer sur le plan des
services offerts.
La génération des baby-boomers héritera bientôt
d'un patrimoine sans précédent, légué par la
génération précédente. Selon une estimation,
un trillion de dollars d'actifs nets seront transférés d'une
génération à l'autre.
Conjuguées à un climat de faible inflation et à
la faiblesse des taux d'intérêt, ces tendances ont modifié
profondément le type de produits que les Canadiens désirent.
Les gens veulent de meilleurs rendements et sont prêts, à
cause de leurs horizons d'investissement toujours plus longs, à
assumer plus de risques.
Le travail indépendant représente maintenant 17,9 %
du nombre total d'emploi au Canada, contre 13,3 % en 1986. Onze pour cent
des Canadiens ayant un emploi déclarent travailler principalement
à partir de leur domicile. Près de la moitié (48 %)
des Canadiens ayant un emploi déclarent qu'ils travaillent régulièrement
ou occasionnellement depuis leur résidence.
L'évolution technologique et démographique échappe,
pour l'essentiel, à l'emprise de l'État. Les gouvernements
ont toutefois ouvert davantage les marchés internes à des
institutions étrangères par diverses ententes internationales.
Conjugué à la conversion des économies dirigées
en économies de libre marché, cela change du tout au tout
les possibilités qui s'offrent aux entreprises commerciales et financières.
La plupart des pays ouvrent leurs marchés à des institutions
étrangères en anticipant la réciprocité de
la part d'autres pays pour aboutir à une réelle mondialisation
des marchés. Si ces mesures renforcent la concurrence locale, elles
aident aussi les entreprises commerciales à obtenir l'accès
homogène aux services financiers du monde entier. La Banque Scotia
est un excellent exemple d'institution financière canadienne qui
a suivi sa clientèle à l'étranger, ce qui en fait
la banque canadienne la plus tournée vers le reste du monde et lui
permet de rappeler, non sans fierté, qu'elle avait des bureaux à
Kingston, en Jamaïque, avant d'en avoir à Toronto.
La position relative des différentes catégories d'institutions
a évolué avec le temps. Après avoir perdu des parts
de marché à divers intervenants qui sont apparus et ont disparu
avec les ans, les banques, qui étaient autrefois les intermédiaires
financiers dominants, détiennent maintenant une proportion beaucoup
moindre des actifs financiers.
Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes entreprend
cet examen pour envisager les façons dont les recommandations du
Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien
peuvent contribuer à doter le Canada d'un secteur financier de classe
internationale. Il nous faut reconnaître clairement que le rôle
de l'État est restreint. Comme le signale le Document de discussion
du Groupe de travail : « Le Parlement [. . .] ne peut adopter une
loi portant que les institutions financières canadiennes doivent
offrir des services d'une qualité de niveau international, que la
petite entreprise progresse rapidement ou que les Canadiens se maintiennent
à la fine pointe du progrès en ce qui touche la mise en place
d'industries fondées sur le savoir 6.
» Il peut cependant réitérer son engagement à
maintenir un cadre réglementaire solide et efficace en le combinant
à un environnement qui laisse libre cours à la souplesse,
à l'innovation, à la concurrence et à la possibilité
pour les institutions financières de servir les Canadiens de façon
rentable.
Le Comité reconnaît que l'avenir offre à la fois
des possibilités et des défis. Nous en avons la preuve aujourd'hui.
Sans se dérober aux défis, il faut aussi s'assurer de saisir
les occasions. C'est ce que le Comité vise réellement par
la création d'un cadre législatif et réglementaire
dans lequel le secteur financier pourra relever avec succès les
défis devant lui et saisir les nouvelles occasions qui s'offrent
à lui et dans lequel tous les Canadiens peuvent profiter d'un système
financier de classe internationale.
Le prochain examen législatif, que ce soit en 2002 ou avant,
sera décisif. S'il est couronné de succès, c'est que
les défis de la mondialisation, des nouvelles technologies, de la
promotion d'un secteur de services financiers progressif et de la protection
du consommateur auront été relevés.
Relever le défi international : Nous voulons nous assurer
que les Canadiens ne soient pas tenus à l'écart des diverses
innovations bénéfiques qui se produisent dans le monde. Par
Canadiens nous entendons ici tant les consommateurs que les fournisseurs
de services financiers. Les nouveaux produits et les nouvelles institutions
menaceront la part de marché des entreprises canadiennes actuelles.
Par contre, loin d'entraver les efforts des institutions canadiennes pour
devenir compétitives sur la scène internationale, le gouvernement
devrait au contraire les encourager et leur faciliter la tâche. Même
si le Comité ne croit pas opportun de promouvoir l'expansion dans
le seul but d'avoir de plus grosses institutions, il ne faudrait cependant
pas laisser la phobie des gros empêcher nos institutions financières
de se lancer à la conquête de nouveaux défis, à
la condition toutefois qu'ils soient dans l'intérêt public.
Le gouvernement devrait plutôt établir un cadre rigoureux
pour évaluer l'incidence de la fusion, et s'arranger pour que le
marché canadien fasse l'objet de concurrence autant que faire se
peut. C'est la seule façon de s'assurer que le secteur peut relever
le défi de la mondialisation et que les consommateurs canadiens
de services financiers ont droit à ce que le secteur financier mondial
peut offrir de meilleur.
Relever le défi technologique : La technologie contribue
à l'évolution des services financiers. En plus de donner
accès aux services financiers de façons nouvelles, par le
biais de banques virtuelles entre autres, nous pouvons aussi acheter des
produits novateurs. La technologie donne aux résidents des milieux
ruraux et des collectivités isolées l'accès à
de meilleurs services financiers que dans le passé, mais de façons
différentes.
La technologie peut aussi apporter des défis. À mesure
que les institutions trouvent des façons de l'utiliser pour réduire
les coûts, la pression concurrentielle les pousse à laisser
tomber le contact personnel traditionnel. Les Canadiens ne peuvent malheureusement
pas tous s'adapter rapidement à l'évolution technologique.
Le défi consiste à s'assurer de continuer à servir
tous les clients pendant cette période de transition d'un paradigme
à l'autre.
La croissance économique par le secteur des services financiers
: Pour que l'économie canadienne puisse prospérer, l'accès
aux capitaux et à une variété de services financiers
est primordial. Dans l'ensemble, l'économie est bien servie par
le secteur financier, mais certains secteurs le sont moins. Le plus grave,
c'est que ce sont ceux qui ont le plus de potentiel, à savoir les
PME (petites et moyennes entreprises) et les industries du savoir.
Le secteur des services financiers doit absolument trouver moyen de
servir ces importants segments de l'économie canadienne. La réforme
du secteur devrait avantager à la fois les PME et les industries
du savoir. Si les joueurs actuels ne sont pas en mesure de bien les servir,
il se peut que de nouveaux intervenants y arrivent, surtout s'ils apportent
avec eux de nouvelles façons de faire des affaires, comme de nouveaux
modes d'évaluation du risque ou de nouvelles attitudes à
son égard. Dans la mesure où ces nouveaux intervenants renforcent
la concurrence, les institutions en place seront contraintes de trouver
de meilleures façons de servir leur clientèle actuelle.
Pour contribuer au bon fonctionnement de l'économie canadienne,
le secteur des services financiers doit être efficace. Ces services
sont l'un des intrants du processus de production. Plus le secteur est
efficace, mieux l'économie sera servie. La conjugaison de la concurrence
et de l'efficacité fera baisser les prix et rehaussera la qualité
du service.
Pour un secteur des services financiers prospère et productif
: Étant donné les tendances du secteur financier, il
est parfois difficile d'en connaître l'étendue et les intervenants.
L'intensification de la concurrence résulte de sources inhabituelles,
voire étonnantes. Elle découle de plus en plus d'institutions
qui échappent à la réglementation canadienne.
Il est important que le secteur financier soit assez souple pour s'adapter
aux besoins changeants des Canadiens et à l'évolution de
son cadre de travail. Sinon, les Canadiens et les non-Canadiens se tourneront
vers d'autres fournisseurs. En plus de s'assurer du contraire, le gouvernement
du Canada doit s'employer à faire en sorte que les institutions
canadiennes ne ratent jamais pareille occasion de servir des marchés
étrangers.
Il est impossible de prédire l'avenir du secteur des services
financiers. Nous ne savons ni quels nouveaux produits feront leur apparition,
ni quels genres de produits les consommateurs voudront. Nous ne savons
ni comment ces services seront fournis, ni même qui les offrira.
La seule chose qu'on peut affirmer avec certitude au sujet de l'avenir,
c'est que toute tentative d'imposer un modèle rigide au secteur
des services financiers produira probablement l'effet contraire, du point
de vue tant des institutions financières que des consommateurs canadiens.
Préserver la confiance, la fiabilité et la solidité
: Par rapport aux autres secteurs économiques, celui des services
financiers est et continuera d'être fortement réglementé.
À bien des égards, cette réglementation est une source
de vigueur en inspirant confiance aux consommateurs. Cette confiance est
un bien collectif en ce sens qu'aucune entreprise ne peut se l'approprier.
Elle avantage tous les intervenants du secteur et renforce donc celui-ci.
Une réglementation excessive, inefficace ou inadaptée constitue
cependant un fardeau dont les consommateurs font les frais, directement
par une hausse des frais de service ou un choix moindre, ou indirectement
lorsque des règles du jeu divergeantes pénalisent certaines
institutions par rapport à d'autres. Il serait important que le
gouvernement trouve un bon compromis entre la réglementation prudentielle
qui favorise le secteur et la réglementation excessive qui lui est
néfaste.
Le Comité donne, dans les chapitres qui suivent, plus de détails
au sujet des quatre thèmes abordés dans le Rapport du Groupe
de travail - l'intensification de la concurrence et de la compétitivité,
le renforcement du pouvoir des consommateurs, l'amélioration du
cadre réglementaire et les façons de répondre aux
attentes des Canadiens - ainsi que des recommandations formulées
sur chacun.
CHAPITRE 2 : LE NOUVEAU VISAGE DU SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS DU CANADA
La mondialisation, la fusion d'entreprises, l'arrivée de nouveaux
joueurs canadiens, les innovations technologiques réclamées
par des consommateurs de plus en plus avertis qui exigent des modes de
prestation meilleurs et plus pratiques et les tendances démographiques
: tous ces facteurs sont sur le point d'entraîner des changements
spectaculaires dans le secteur des services financiers qui auraient été
impensables il y a seulement quelques années. Certains de ces changements
sont déjà observables, tant du côté de l'offre
que du côté de la demande, mais il va s'en produire encore
bien davantage, et beaucoup plus rapidement. Cette transformation que subit
le paysage des institutions financières canadiennes n'est pas unique
au Canada. En effet, des forces puissantes sont à l'oeuvre qui vont
entraîner des restructurations dans le monde entier et au Canada.
Compte tenu de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières
années et de ce qui se produira, on a du mal à imaginer ce
que l'avenir nous réserve.
Le tableau suivant donne une idée de l'évolution de l'importance
relative des diverses institutions financières.
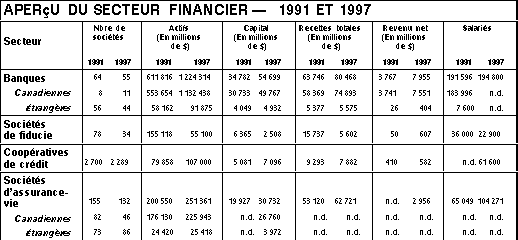
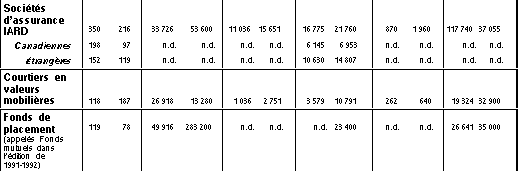
Source : The Canadian Financial Services Industry, The Year in Review,
1991-1992 et 1997, le Conference Board du Canada.
La mondialisation suscite un accroissement de la concurrence et des
choix plus nombreux pour les entreprises et les ménages du Canada.
Cette concurrence accrue va se traduire par des services financiers de
meilleure qualité, des choix plus variés et des prix plus
bas. Les institutions financières canadiennes connaissent depuis
longtemps les avantages et le potentiel de croissance des placements étrangers.
Au Canada, de nouveaux joueurs comme Wells Fargo, MBNA, Capital One et
ING Direct ont déjà un impact sur le secteur et sur les consommateurs.
Les nouveaux joueurs arrivés sur le marché par la voie d'acquisitions
(l'achat de Midland Walwyn par Merrill Lynch, par exemple) vont aussi changer
le visage du secteur des services financiers.
Le Groupe de travail considère que le mouvement de fusion et
de restructuration du secteur est une stratégie légitime,
voire souhaitable dans certaines circonstances, et il formule plusieurs
recommandations qui faciliteraient la fusion d'institutions. C'est une
des façons de s'adapter à des conditions et un contexte changeants.
Au demeurant, le phénomène de la fusion ne date pas d'hier.
Il a déjà servi d'instrument de politique pour réagir
à la faillite d'institutions financières. Mieux encore, il
importe de se rappeler que c'est la fusion qui a donné naissance,
il y a longtemps, à nos banques nationales.
Il existe d'ailleurs des exemples plus récents de ce phénomène.
Il suffit de penser à la récente tentative avortée
de la Banque Royale de prendre le contrôle de la London Life, laquelle
a finalement été achetée par la compagnie d'assurance-vie
Great-West. Il ne faut pas oublier non plus les restructurations qui ont
eu lieu dans le secteur des entreprises de fiducie. À leur apogée,
entre 1988 et 1991, les sociétés de fiducie comptaient pour
environ 22 % des dépôts au Canada. Après la faillite
d'un certain nombre d'entre elles, grandes et petites, dans les années
1980 et au début des années 1990, dont beaucoup se sont soldées
par l'acquisition des sociétés concernées par des
banques, il ne reste plus qu'une seule grande société de
fiducie indépendante (Canada Trust) et environ 30 petites contre
81 en 1993. Collectivement, ces sociétés contrôlent
actuellement environ 9 % des dépôts.
Les fusions comptent parmi les stratégies les plus visibles,
et donc parmi les plus controversées, qu'on puisse mettre en oeuvre
pour effectuer une restructuration dans le secteur des services financiers.
Le nombre des fusions a légèrement diminué au Canada
depuis 1994, mais le nombre des transactions effectuées chaque année,
de 1993 à l'heure actuelle, est beaucoup plus élevé
qu'à la fin des années 1980. Le Conference Board du Canada
a dénombré plus de 350 fusions dans le secteur des services
financiers canadien au cours des 10 dernières années.
Pensons aussi aux restructurations qui ont frappé l'industrie
des valeurs mobilières au moment où les banques ont été
autorisées à entrer sur ce marché en 1987. Presque
toutes les maisons de courtage moyennes ont disparu. Au total, il y a eu
plus de 350 fusions et acquisitions dans le secteur des services financiers
canadien dans les 10 dernières années.
L'exemple le plus visible de l'entrée de nouveaux joueurs dans
le secteur des services financiers canadien a été le résultat
des modifications apportées en 1980 à la Loi sur les banques
qui ont permis à des banques étrangères d'exploiter
des filiales au Canada. Il existe actuellement 44 filiales de banques étrangères
en exploitation au Canada, contre 56 en 1991. Une seule, la Banque Hongkong
du Canada, possède un vaste réseau de succursales et une
part de marché importante. Globalement, les banques étrangères
contrôlent maintenant environ 10 % des actifs nationaux7.
Cette tradition d'obstacles à l'accès des banques étrangères
ressort bien de l'enquête sur la compétitivité dans
le monde, du Forum économique mondial, qui classe le Canada 41e
sur 53 pays au chapitre de la concurrence exercée par les banques
étrangères.
Si elles sont mises en oeuvre, les recommandations du Groupe de travail
vont modifier encore davantage les possibilités qui s'offrent aux
institutions financières, agir sur l'équilibre de la concurrence
et favoriser d'autres restructurations découlant de la volonté
des institutions financières de constituer des alliances qui les
rendront plus fortes et plus rentables. Toutes les institutions financières
canadiennes, grandes et petites, devront évaluer leur position sur
le marché pour, dans certains cas, se repositionner ou, dans d'autres,
repenser leur stratégie commerciale. Certaines décideront
éventuellement de se départir de leurs activités non
compétitives. D'autres pourraient décider de fusionner ou
d'acquérir d'autres institutions pour élargir leur gamme
de produits. Il y a fort à parier que le paysage du secteur des
services financiers canadien sera totalement différent à
l'avenir.
iv. Innovations technologiques
Le nouveau visage du secteur des services financiers est le fruit de
pressions qui viennent à la fois du côté des institutions
(qui sont poussées par l'évolution rapide des techniques)
et du côté des consommateurs, qui exigent des services plus
pratiques (de plus en plus de Canadiens adoptent les nouvelles technologies).
Pour que les changements technologiques se produisent, les deux côtés
de cette équation doivent être bien alignés. Si les
institutions offrent de nouveaux mécanismes électroniques,
il faut qu'il y ait suffisamment de consommateurs qui acceptent de les
utiliser. Si les consommateurs veulent de nouveaux produits, il faut qu'il
y ait des institutions désireuses et capables de les leur fournir.
Les institutions, les produits et les modes de prestation changent donc
très rapidement. Pour relever ce défi technologique et faire
face à l'accroissement de la concurrence, le secteur des services
financiers canadien a été forcé d'investir des sommes
considérables dans les nouvelles technologies. En 1996, ce secteur
a affiché des dépenses de 2,92 milliards de dollars au chapitre
des technologies de l'information (dont 2,42 milliards de dollars ont été
dépensés par les 6 grandes banques à charte)8.
Les budgets consacrés aux technologies de l'information par
Citicorp et la Chase Manhattan - les plus dépensières à
cet égard - sont évalués à 2 milliards de dollars
américains environ pour chaque institution en 1997. On estime qu'une
poignée d'autres grandes banques américaines et européennes
consacrent bien au-delà de 1 milliard de dollars américains
à ce poste de dépenses. De leur côté, les plus
grandes banques canadiennes dépensent, selon les estimations, des
sommes de l'ordre de 400 à 600 millions de dollars américains
par année.
Le secteur se trouve en plein dans une importante transformation de
la prestation des produits, un des aspects les plus visibles du secteur
des services financiers. Les immeubles de même que le papier sont
progressivement remplacés par des signaux numériques. Le
Rapport du Groupe de travail signale que, entre 1988 et 1995, le volume
des transactions de paiement sans papier a crû à un rythme
annuel de 13,9 %, tandis que les transactions par chèques ont diminué
en moyenne de 1,5 % par an9.
En trois ans seulement, la proportion des transactions bancaires effectuées
dans des succursales est passée de la moitié à 30
% du total10,
ce qui représente une baisse de 40 %.
Les grandes institutions financières internationales consacrent
chacune nettement plus de 1 milliard de dollars américains chaque
année à la mise au point de technologies nouvelles, les dépenses
de certains établissements, comme Citicorp et la Chase Manhattan,
étant évaluées à près de 2 milliards
de dollars américains.
La principale solution de rechange à la succursale est le guichet
bancaire automatique, mais même lui pourrait bientôt devenir
désuet11.
Les guichets automatiques existent depuis déjà plus de 20
ans. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette technologie l'emporte
sur les transactions effectuées dans les succursales. En revanche,
les cartes de débit ont été offertes aux Canadiens
il y a seulement quatre ans et elles ont crû à un rythme extraordinaire
depuis lors : 30 millions de cartes en circulation, 235 000 détaillants
offrant le paiement direct par Interac et plus d'un milliard d'transactions
en 1997, contre 185 millions en 1994.
L'accessibilité des services de paiement semble bonne au Canada
par comparaison avec l'étranger. Le nombre de succursales et de
guichets automatiques par personne place le Canada au deuxième rang
dans l'OCDE, notre pays venant en troisième place pour le nombre
de terminaux au point de vente par personne.
Les TEF/PDV12
et les transactions par téléphone font plus que doubler chaque
année et ils représentent maintenant 18 % et 10 % des transactions
respectivement, ce qui demeure loin derrière les 38 % des transactions
réalisées par guichet automatique. Cependant, les transactions
par téléphone et les TEF/PDV progressent à un rythme
annuel beaucoup plus élevé (50 % et 91 % respectivement)
que les transactions par guichet (11 %). Ces deux modes de distribution
vont sans doute bientôt succéder aux guichets automatiques.
Au cours des 10 dernières années, le pourcentage de
maisons où il y a des ordinateurs au Canada est passé de
10 à 35 %. En outre, les clients se branchent rapidement à
Internet. Le Canada se classe aujourd'hui au septième rang pour
ce qui est du nombre d'hôtes Internet par habitant, et ces services
augmentent chaque année. Certains spécialistes prévoient
même que d'ici 5 à 10 ans il y aura autant d'ordinateurs personnels
et de branchements à Internet qu'il y a de téléphones
actuellement.
Les services bancaires sur PC viennent ensuite. Ils représentent
encore une très petite proportion des transactions, mais ils se
répandent rapidement. Ensemble, les transactions par téléphone
et les TEF/PDV dépasseront dès l'année prochaine les
transactions effectuées en succursale. Ce sera ensuite le tour des
transactions sur PC et sur Internet. La proportion des ménages canadiens
équipés d'un ordinateur personnel est passée de 10
% en 1986 à 36 % en 1997; 28 % des ménages ont maintenant
accès à Internet. Proportionnellement, ce sont les jeunes
ménages qui effectuent le plus de transactions financières,
et ils vont rapidement adopter de nouvelles formes de services bancaires
comme l'argent électronique et les cartes à puce. À
mesure que ces nouveaux véhicules financiers et que le commerce
électronique occuperont une place de plus en plus importante dans
notre économie, les guichets automatiques tels que nous les connaissons
vont devenir de plus en plus désuets. Ils vont devoir être
transformés lorsqu'ils perdront graduellement leur rôle essentiel
de machines distributrices de billets.
Les Canadiens semblent se mettre volontiers au diapason des nouvelles
technologies. Depuis une dizaine d'années, le nombre de ménages
possédant un ordinateur à la maison a plus que triplé.
Selon Statistique Canada, la proportion des ménages ayant un ordinateur
est passée de 10 % en 1986 à plus de 36 % l'an dernier.
Pour comprendre pourquoi les pressions du changement sont fortes dans
les modes de distribution, il suffit d'étudier la nature de ces
questions et les coûts qui y sont associés. Les transactions
en succursale sont généralement réalisées face
à face avec les clients et reposent largement sur du papier. Or,
c'est de loin la façon la plus coûteuse d'effectuer une simple
transaction bancaire. Dans l'échelle des coûts, les guichets
automatiques viennent au deuxième rang - ils représentent
environ le tiers du coût d'une transaction en succursale. Les transactions
par guichet automatique sont elles aussi des transactions sur papier, mais
la main-d'oeuvre y est utilisée de façon beaucoup plus rationnelle.
De 1988 à 1995, le volume des instruments de paiement sans
papier (c.-à-d. autres que les espèces ou les chèques)
a augmenté à un rythme annuel moyen de 13,9 %, tandis que
les transactions par chèques diminuent de 1,49 % en moyenne par
année.
Les transactions bancaires par téléphone sont légèrement
moins coûteuses que les transactions par guichet automatique. Elles
ne consomment pas de papier et représentent une exploitation rationnelle
de la main-d'oeuvre. Enfin, le canal de distribution de loin le moins coûteux
est Internet, où les coûts par transaction représentent
environ 1 % seulement du coût des transactions en succursale. Ce
service non seulement ne consomme aucun papier, mais n'exige presque qu'aucune
main-d'oeuvre.
Pour les deux tiers (67 %) des Canadiens, il était extrêmement
important de pouvoir effectuer des transactions bancaires en personne dans
une succursale.
Certains Canadiens résistent à la transition des succursales
vers les autres canaux de distribution. C'est en partie une question de
génération, mais cela tient aussi en partie au fait que les
frais de transaction facturés par les institutions de dépôts
ne sont pas proportionnels au coût des divers canaux13.
Elles s'attendent sans doute que les consommateurs adopteront ces solutions
de rechange parce qu'elles sont plus pratiques pour eux.
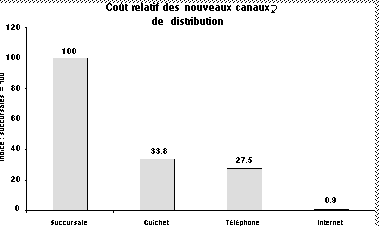
Par conséquent, ce dont nous sommes témoins déborde
de loin une simple désaffection pour les réseaux bancaires
fondés sur la brique et le mortier. Nous sommes témoins non
seulement de changements rapides, mais de changements qui s'accélèrent
et de flux sous la forme de nouveaux canaux de distribution offerts aux
Canadiens par les institutions financières canadiennes et étrangères.
Si les sociétés à produit unique ont autant de succès,
c'est parce qu'elles ont réussi à bien adapter leurs produits
financiers en sachant exploiter les ressources des techniques modernes.
Ces nouveaux modes de prestation des services financiers à forte
intensité technologique vont accroître la concurrence et élargir
l'éventail des choix qui s'offrent aux consommateurs disposés
à les accepter.
Les tendances démographiques jouent deux rôles importants
sur le plan des services qui sont offerts. Comme on l'a dit précédemment,
avec la jeune génération, plus instruite et plus ouverte
aux nouvelles technologies, les progrès technologiques vont se multiplier
dans les services bancaires. D'un autre côté, les générations
mûres qui approchent de la retraite et la génération
du baby-boom (dont beaucoup sont des travailleurs indépendants)
qui va bientôt profiter d'un transfert de richesses intergénérationnel
exigent des produits d'épargne, des services de courtage et des
services de gestion de fortune et de gestion de retraite nouveaux et innovateurs.
Les clients canadiens délaissent les produits traditionnels
protégés par le gouvernement, comme les dépôts,
pour les titres transigés sur les marchés et les fonds communs
de placement. En 1992, l'actif financier était composé, dans
une proportion de 31 %, de dépôts de base; en 1997, ce pourcentage
était tombé à 26 %. Dans l'avenir, les Canadiens prendront
vraisemblablement plus de risques en transférant une partie encore
plus grande de leurs actifs financiers discrétionnaires dans des
véhicules à long terme. Les actifs à long terme exprimés
en pourcentage de l'ensemble des actifs discrétionnaires devraient
passer de 40 % en 1996 à plus de 60 % d'ici 2006.
Les facteurs démographiques contribuent par ailleurs aux changements
les plus importants des caractéristiques des ménages canadiens,
à savoir la façon dont ces ménages investissent leur
fortune. Nous sommes tous au courant de l'expansion spectaculaire des fonds
communs de placement durant la décennie. Or, un changement beaucoup
plus impressionnant s'est produit dans les 25 dernières années.
En effet, les ménages détiennent une part croissante de leur
richesse sous la forme d'avoirs financiers (fonds communs de placement,
dépôts, actions, obligations et produits d'assurance) que
sous la forme de biens matériels (maisons et autres biens, voitures,
etc.). En 1997, 55 % des avoirs des ménages canadiens prenaient
la forme d'actifs financiers et 45 % d'actifs matériels. Il y a
25 ans, les proportions étaient inversées.
La place de plus en plus grande des avoirs financiers est un facteur
important pour expliquer la croissance des services financiers par rapport
au reste de l'économie. En même temps que les avoirs financiers
des ménages ont augmenté, les Canadiens changeaient la forme
sous laquelle ils détenaient ces avoirs. Le changement le plus spectaculaire
est représenté par les fonds communs de placement. Par ailleurs,
la croissance des demandes de pension est elle aussi impressionnante. La
part relative des dépôts, des actions et des obligations a
baissé depuis 20 ans. Ces changements se sont produits en grande
partie en réaction à la demande émanant des consommateurs,
laquelle est influencée par les facteurs économiques et démographiques.
Les bas taux d'intérêt de ces dernières années,
combinés à l'impression qu'ont les gens qu'ils doivent devenir
de plus en plus autonomes sur le plan de leur sécurité financière,
ont entraîné une accélération de la tendance
vers la désintermédiation, c'est-à-dire le processus
dans lequel les épargnants investissent directement dans des titres,
en particulier dans des titres à long terme14,
au lieu de passer par l'intermédiaire d'une institution de dépôts.
L'évolution démographique est telle qu'une proportion croissante
de la population se trouve maintenant dans les principales tranches d'âge
d'épargne. Tous ces facteurs ont des répercussions sur le
secteur des services financiers et sur les divers intervenants.
Avoirs financiers des ménages par produit
(en pourcentage du total des avoirs financiers des ménages canadiens)
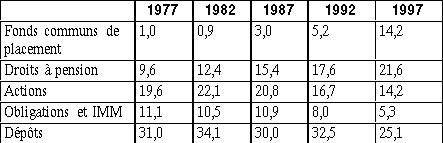
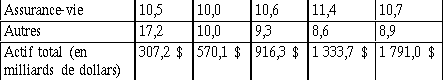
Source : Changement, défis et possibilités, pièce
4.1.
Le secteur des services financiers canadien est sur le point de se transformer
comme jamais auparavant. Au lieu de résister aux forces du changement,
au lieu de rechercher le statu quo, les décisionnaires et les organismes
de réglementation devraient instituer un cadre qui aidera les institutions
et les consommateurs à s'adapter rapidement, facilement et de façon
ordonnée. Nous avons l'occasion unique de modeler l'avenir du secteur
des services financiers. Les gouvernements ont à relever un défi
stimulant qui influera sur la vie de millions de personnes pendant de nombreuses
années.
CHAPITRE 3 : CONCURRENCE ET COMPÉTITIVITÉ
La concurrence est une caractéristique des marchés économiques.
Au sens large, le secteur des services financiers est un tel marché.
C'est un marché d'instruments d'épargne pour les consommateurs
et un marché de crédit pour les ménages et les entreprises.
Mais dans le passé, ce secteur avait tendance à se partager
en plusieurs marchés distincts. Chaque « pilier » fournissait
un ensemble de services financiers qui n'étaient pas substituables
aux services d'autres piliers. Un compte d'épargne dans une banque
n'était pas la même chose qu'un portefeuille d'actions ou
qu'un fonds commun de placement. Et il en était de même du
côté du crédit.
Aujourd'hui, les institutions financières se ressemblent de plus
en plus, ce que le Rapport MacKay n'a pas manqué de reconnaître.
De sorte qu'en théorie comme dans les faits, nous avons de plus
en plus affaire à un seul marché financier. Les nouveaux
produits et les nouvelles façons de les livrer rendent les différences
entre les institutions et instruments financiers de moins en moins marquées.
Cette convergence ne permet plus aux institutions de se cacher derrière
un « pilier » pour se protéger de la concurrence. On
en voit des exemples avec les consommateurs qui peuvent acheter presque
n'importe quel produit financier d'une banque ou d'une de ses filiales.
De plus en plus, les compagnies d'assurance-vie proposent des instruments
d'épargne plutôt que de l'assurance. De même, le consommateur
qui souhaite acheter un instrument d'épargne dont le rendement est
lié au marché boursier canadien peut acheter des certificats
de placement garanti (CPG) liés au TSE dans une banque, un fonds
distinct auprès d'une compagnie d'assurances, des fonds mutuels
d'une société indépendante de fonds mutuels ou des
fonds mutuels vendus par une banque.
Cette tendance à la convergence n'exclut pas pour autant la spécialisation
et l'exploitation de créneaux. Les consommateurs qui souhaitent
passer par un guichet unique peuvent le faire tout en profitant des institutions
spécialisées (également appelées « monogammes
») qui peuvent donner des conseils sur une gamme limitée de
produits. Ce que la convergence implique, toutefois, c'est que les services
de créneaux doivent être en mesure de soutenir la concurrence
des institutions qui offrent toute la gamme de services.
Par ailleurs, la concurrence oblige les institutions nationales à
soutenir la concurrence du marché. Si les notions de compétitivité
et de concurrence vont souvent de pair, il se peut que ce ne soit pas toujours
le cas15.
Dans un marché libre et avec des institutions nationales compétitives,
les consommateurs canadiens ont de meilleures chances de profiter de la
concurrence et de pouvoir se procurer les meilleurs produits aux meilleurs
prix. Mais l'inverse est également vrai. Plus la concurrence est
forte sur le marché intérieur, plus les institutions canadiennes
feront bonne figure sur les marchés internationaux. La concurrence
oblige les entreprises à être efficaces et à utiliser
les technologies, les pratiques commerciales et les méthodes de
gestion les plus récentes.
C'est ainsi qu'on peut considérer que la concurrence est un élément
important surtout du point de vue du consommateur, alors que la compétitivité
est une caractéristique d'une institution ou d'un groupe d'institutions
qui leur permet de se tirer d'affaire dans un monde de concurrence.
Il y a trois grandes façons d'accroître la concurrence
sur le marché, quel que soit le service financier : l'arrivée
de nouveaux acteurs nationaux, celle de nouveaux acteurs étrangers,
ou en permettant aux institutions existantes d'offrir une plus large gamme
de produits. De l'avis du Groupe de travail, il est également vital
d'accroître le pouvoir des consommateurs, car cela aide le marché
à discipliner les institutions, ce qui signifie que les consommateurs
sont mieux servis. Nous examinerons chaque point à tour de rôle
et nous verrons comment les recommandations du Groupe de travail favorisent
la concurrence. À cela, nous pourrions ajouter un cinquième
élément, la réglementation. Il est capital que la
réglementation n'empêche pas l'adoption de méthodes
et de technologies plus efficaces, ni la capacité d'offrir une combinaison
économique de produits. C'est une chose d'élargir la gamme
d'institutions qui peuvent offrir des services au Canada, mais si elles
doivent le faire à des prix excessifs, non seulement les consommateurs
ne pourront pas profiter des avantages de la concurrence, mais les institutions
ne pourront pas bénéficier de l'avantage concurrentiel dont
elles jouiraient normalement.
Pour mesurer le niveau de concurrence sur le marché canadien,
le Groupe de travail MacKay s'est donné un ensemble de critères
qui lui permettraient d'évaluer le marché. Ces critères
sont pour l'essentiel des mesures de performance utilisées par d'autres
pays développés. C'est à partir de ces normes que
le Groupe de travail s'est demandé dans quelle mesure les Canadiens
étaient bien servis par le secteur des services financiers.
Parce que la plupart [des grands] projets [de SNC] sont effectués
à l'extérieur du Canada, il nous faut pour la plupart les
financer. Parfois, ce financement revêt une importance presque aussi
grande que les aspects techniques de ces projets. Afin de réunir
ce financement, il nous faut un réseau bancaire canadien plus solide
afin de nous permettre de maintenir notre compétitivité et
notre réussite sur les marchés mondiaux.
Jacques Lamarre (président et directeur général,
Groupe SNC-Lavalin Inc.)
Il est arrivé à la conclusion que les Canadiens sont généralement
bien servis par le secteur des services financiers. Si nous ne bénéficions
pas des meilleurs produits ou des meilleurs prix du monde, les services
que nous recevons sont de haut niveau. C'est une conclusion semblable qui
se dégage des enquêtes auprès des consommateurs : dans
l'ensemble, le secteur fournit des services de haute qualité, mais
il est clair que certains secteurs de l'économie sont moins satisfaits
de leur sort.
Dans les services bancaires de gros, par exemple, le marché
des obligations est maintenant vraiment mondial, comme en témoigne
la convergence dans la tarification des obligations entre les principaux
marchés. Les émissions nettes de titres d'emprunt totalisent
environ 2,5 billions de dollars US et augmentent à un taux de croissance
annuel composé (TCAC) de 17 %. De ce montant, les émissions
internationales représentent 540 milliards de dollars, une part
de 2 % allant au Canada.
Les grandes entreprises sont très bien servies, ce qui n'est
pas étonnant, étant donné les choix qu'elles ont.
Elles profitent déjà de la mondialisation, elles font un
recours accru aux marchés financiers et elles représentent
le secteur de marché qui intéresse le plus les filiales des
banques étrangères. De fait, l'écart des taux d'intérêt
sur les prêts bancaires consentis aux grandes entreprises au Canada
est inférieur de 75 points de base à celui des États-Unis.
Les petites entreprises sont moins bien servies, ce qui n'est pas étonnant
non plus, étant donné que leurs choix sont limités.
Elles paient des frais de service qui sont inférieurs à ceux
des États-Unis, mais supérieurs à ceux qui ont cours
en Europe16.
Plus important est le fait que les PME déplorent souvent l'absence
de crédit, et il y a des indices que la fourchette de faibles taux
d'intérêt au Canada traduit de fait la crainte du risque de
la part de nos banques. Les PME qui obtiennent du crédit bénéficient
de bons taux d'intérêt, mais ce que les PME déplorent,
c'est qu'en tant que groupe elles n'obtiennent pas assez de crédit.
Cela va dans le sens de l'observation entendue fréquemment que les
institutions financières canadiennes sont réticentes à
passer à un niveau de risque supérieur et à consentir
des prêts à des entreprises à risques élevés.
La satisfaction des ménages canadiens à l'égard
du secteur financier est aussi mitigée. Sur le marché des
prêts hypothécaires résidentiels, la concurrence est
forte. Les consommateurs ont le choix entre plusieurs prêteurs, de
sorte qu'ils bénéficient de tarifs très avantageux
sur le coût des hypothèques. Pour une hypothèque d'un
an, la fourchette des taux d'intérêt est à peu près
ce qu'elle est aux États-Unis, et inférieure d'un tiers aux
taux des Pays-Bas, de presque deux tiers à ceux de la France et
de plus des trois quarts aux taux italiens. Sur les prêts personnels,
le Canada jouit encore de taux parmi les plus bas de tous les grands pays.
Les taux sont inférieurs de moitié à ceux qui se pratiquent
en Suisse, en Suède, en Allemagne ou en Australie. Mais les ménages
canadiens sont moins choyés dans le cas des cartes de crédit.
Nous payons des taux plus élevés (environ 200 points de base)
et des frais de service plus élevés que les Américains,
et nos frais bancaires sont légèrement au-dessus de la moyenne
des pays étudiés par le Groupe de travail.
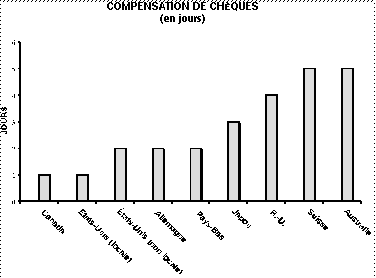
Par contre, les services liés à notre système des
paiements font l'envie des autres pays. À l'échelle du pays,
nos chèques sont compensés aussi rapidement que les chèques
américains le sont sur place. Notre système de compensation
en un jour fait mal paraître les systèmes suisses et australiens,
qui demandent cinq jours pour compenser un chèque, et le système
britannique, qui en demande quatre.
Il est donc évident que les Canadiens jouissent de très
bons services financiers, mais il y a moyen de faire des améliorations
sur certains points. Si certains éléments du secteur financier
canadien sont de niveau international, il faut dire qu'il y en a qui ne
le sont pas. Il s'agit donc d'identifier et de supprimer les freins qui
nuisent à l'adoption de normes de niveau international dans ces
secteurs particuliers du marché.
Mais même dans les gammes de produits où nous semblons
jouir de normes élevées de service, il n'y a pas lieu de
nous en contenter et de priver les consommateurs canadiens de services
qui pourraient encore s'améliorer. Il ne faut pas que la politique
gouvernementale soit entravée par la doctrine du « mieux est
l'ennemi du bien ». Les Canadiens n'étaient pas mal servis
par les quincailleries indépendantes et les magasins à succursales
avant l'arrivée de Home Depot. Et pourtant, avec son arrivée,
le marché a été considérablement transformé,
la concurrence a augmenté et les consommateurs en ont profité,
grâce à un choix plus vaste et à de meilleurs prix.
Si nous nous contentons de regarder le présent, nous fermons les
yeux sur ce qui pourrait être. Nous ne pouvons pas savoir quels avantages
de nouvelles institutions ou de nouveaux produits peuvent apporter.
Le même principe s'applique au secteur financier. C'est à
ceux qui veulent restreindre l'entrée qu'il incombe d'apporter des
preuves, pas à ceux qui veulent l'élargir. C'est à
ceux qui veulent résister au changement que revient le fardeau de
la preuve, pas à ceux qui sont en faveur du changement. Aussi longtemps
que la fiabilité et la solidité, la concurrence ou l'intérêt
public ne sont pas menacés, il faudrait toujours aller dans le sens
du changement.
Nous appuyons les recommandations du groupe de travail qui inciteront
à plus de concurrence dans le secteur bancaire. En particulier,
nous croyons que tout doit être fait pour encourager le développement
de nouvelles banques canadiennes. Nous aimerions voir, très sincèrement,
une solution « fait au Canada » pour assurer de la concurrence,
et pas seulement ouvrir toutes grandes les portes à des institutions
étrangères.
Paul J. Lowenstein (président, Canadian Corporate
Funding Limited)
Une caractéristique frappante du secteur des services financiers
au Canada est l'absence de nouveaux concurrents, notamment dans la branche
des dépôts. Les Canadiens sont fiers que notre secteur financier
ait été plus stable que celui de notre voisin du Sud. Il
y a à la fois du bon et du mauvais. Si le secteur financier canadien
a connu beaucoup moins de départs pour cause de faillite, il a par
contre assisté à beaucoup moins d'arrivées. Dans un
marché mondial, où les fusions sont de plus en plus courantes,
l'absence de nouveaux acteurs nationaux n'est certes pas une tradition
que nous souhaitons maintenir.
Le Groupe de travail a reconnu plusieurs obstacles à la création
de nouvelles institutions financières au Canada, le plus important
étant la règle de participation de 10 % dans les banques
nationales. Bien qu'une nouvelle banque nationale puisse appartenir à
peu d'actionnaires au départ, elle doit se conformer à la
règle du 10 % dans les 10 ans. Comme il faut plusieurs années
pour qu'une banque devienne rentable, les entrepreneurs hésitent
à prendre le risque de former une nouvelle banque, étant
donné qu'il leur faudra se départir de la vaste majorité
des actions alors même qu'elles pourraient commencer à rapporter.
Pour surmonter cet obstacle, le Groupe de travail recommande un nouveau
régime de propriété fondé sur la taille et
non plus sur le type d'institution (voir recommandations 29 à 43).
Ainsi, d'après la recommandation 32 du Rapport, une nouvelle banque
(ou une compagnie d'assurances ou une société de fiducie
fédérale) pourrait être établie et n'avoir qu'un
actionnaire jusqu'à ce que son avoir atteigne 1 milliard de dollars,
et avoir un actionnaire principal jusqu'à ce que l'avoir atteigne
5 milliards de dollars. Cet actionnaire principal pourrait détenir
jusqu'à 65 % des actions si les autres appartiennent à un
grand nombre d'actionnaires et sont cotées en bourse. Ce n'est qu'une
fois que l'avoir dépasse 5 milliards de dollars qu'une institution
financière fédérale devrait avoir un capital largement
réparti. Cette recommandation élimine effectivement l'obstacle
à la création de nouvelles banques nationales, et le Comité
la fait sienne.
La législation financière fédérale (les
lois sur les banques, les sociétés de fiducie et de prêt,
les sociétés d'assurances) constitue également un
obstacle au lancement de nouvelles institutions du fait qu'elle exige un
capital minimum de départ. À l'heure actuelle, ce capital
est de 10 millions de dollars. Si cette condition a pu être justifiée
pour des raisons de fiabilité et de solidité, cela veut dire
qu'un capital de 10 millions de dollars représente la taille minimale
pour qu'une institution soit efficace. Il y a pourtant de nombreuses institutions
plus petites qui sont fiables et solides, et dont le capital est suffisant
pour leurs activités. Les coopératives de crédit,
qui appartiennent aux membres, sont différentes des institutions
qui appartiennent à un entrepreneur, et elles présentent
des risques prudentiels qui sont aussi différents. Ce sont néanmoins
des institutions de dépôts, comme les banques et les sociétés
de fiducie, et elles ont en général un capital inférieur
à 10 millions de dollars. Le tableau ci-dessous indique le capital
moyen des coopératives de crédit et des caisses populaires
à la fin de 1996. Ce n'est qu'en Colombie-Britannique que les coopératives
de crédit ont en moyenne un capital de 10 millions de dollars, et
ce chiffre est faussé en raison de la présence de 5 institutions
assez importantes.
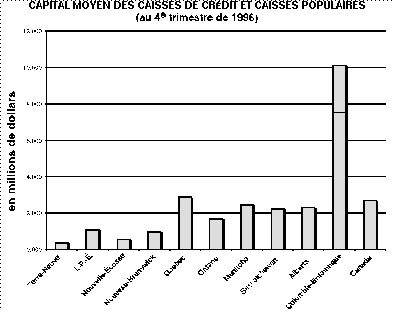
Le Groupe de travail a recommandé que le ministre des Finances
ait la possibilité d'autoriser la création de nouvelles institutions
qui exerceront des activités limitées, avec un capital inférieur
à 10 millions de dollars. Cela va dans le sens du Rapport du Comité
permanent de l'industrie de la Chambre des communes, paru en 1994 et intitulé
Pour financer le succès de la PME, qui est d'avis que, sous
réserve de dispositions destinées à assurer la fiabilité
et la solidité, le gouvernement devrait permettre la création
de petites institutions financières.
Le Groupe de travail a également recommandé que les demandes
soient approuvées dans un délai de 120 jours et que les exigences
réglementaires soient proportionnées à la taille et
à la nature des activités de l'institution. Le Comité
appuie toutes les propositions que renferme la recommandation 4.
Le dernier élément de la stratégie pour favoriser
la création de nouvelles institutions financières concerne
l'impôt sur le capital qui s'applique à ces institutions.
Le capital est l'assise d'une institution financière saine, et pourtant,
les gouvernements canadiens ont choisi de l'imposer assez lourdement. Pour
les grandes institutions qui font des profits, ce n'est peut-être
pas un fardeau bien lourd, mais pour les petites institutions nouvelles,
qui accusent habituellement des pertes les premières années,
un tel impôt peut être prohibitif. Le Groupe de travail signale
qu'une institution financière avec un capital de 10 millions de
dollars doit payer des impôts qui grugent 2,2 % de son capital de
base chaque année. Comme ces jeunes sociétés sont
plus vulnérables, ces impôts constituent un obstacle important
à leur entrée sur le marché. Ainsi, le Groupe de travail
recommande une exonération fiscale fédérale de 10
ans pour les nouvelles institutions financières et invite les gouvernements
provinciaux à en faire autant (voir recommandation 5). S'ajoutant
à d'autres recommandations, cela contribuerait fortement à
inciter les entrepreneurs canadiens à créer de nouvelles
institutions financières.
Le Comité appuie l'objectif de cette recommandation, mais il
a des réserves à propos de la recommandation 5 concernant
l'exonération fiscale. Le secteur financier se transforme rapidement,
les institutions se défont et se regroupent. La forme de société
de portefeuille proposée renferme la possibilité de structures
de société encore plus complexes. Quelle serait alors la
définition de la nouvelle institution financière aux fins
de l'exonération fiscale? C'est ce côté peu pratique
de la recommandation qui incite le Comité à la rejeter et
à proposer à la place que le gouvernement mette davantage
l'accent sur la création d'un régime fiscal qui soit pratique
et efficace pour le secteur financier. Cette question sera examinée
plus longuement à la fin du chapitre.
Les institutions financières étrangères constituent
une source de concurrence de plus en plus forte. Si, par le passé,
elles n'ont eu qu'un impact marginal sur le secteur financier (les banques
de l'annexe II, par exemple, n'ont jamais détenu plus de 8-10 %
de tous les avoirs du secteur bancaire), elles ont aujourd'hui un impact
qui dépasse de beaucoup leur taille réelle au Canada.
Ces institutions contribuent grandement à la concurrence, pas
seulement parce qu'elles sont nombreuses ou qu'elles détiennent
une large part du marché, mais parce qu'elles initient les Canadiens
à des façons nouvelles et innovatrices de faire des affaires.
Les nouvelles banques étrangères ne ressemblent pas à
la banque canadienne classique, et l'impact sur la concurrence est beaucoup
plus fort que si elles avaient tenté d'entrer sur le marché
comme des sosies des banques canadiennes.
Le véritable avantage de ces nouveaux arrivants est le fait qu'ils
introduisent sur le marché canadien des façons nouvelles
et innovatrices de faire des affaires. La somme des prêts que Wells
Fargo consent aux petites entreprises est très faible par rapport
au marché des prêts dont les PME canadiennes disposent. L'important
ce sont les modalités de prêt et le groupe qui est ciblé.
Grâce à des techniques comme la cote de crédit, Wells
Fargo peut réduire ses frais administratifs de façon appréciable
et servir des marchés qui étaient laissés de côté
par les institutions en place. Mais le plus important est qu'elle a introduit
une nouvelle technique bancaire dont d'autres pourront s'inspirer le moment
venu.
[On] propose à nouveau un accroissement de la propriété
étrangère comme remède pour accroître la concurrence.
Manifestement, les banques étrangères chercheront à
occuper des créneaux rentables. Elles ne voudront pas s'approprier
des créneaux difficiles à pénétrer et peu rentables
du secteur du détail. Elles écumeront les grands centres
urbains rentables et s'occuperont des commerces et des entreprises plus
lucratifs.
Peter Bleyer (directeur exécutif, Conseil des Canadiens)
L'arrivée de nouvelles institutions « monogammes »
repré- sente un avantage semblable. En n'offrant qu'un seul service,
mais en offrant de la qualité à bon prix, elles obligent
les concurrents « multiservices » à faire face à
la concurrence. Si ceux-ci ont pu par le passé se servir de ces
sous-marchés pour interfinancer d'autres produits, ils n'ont plus
cette possibilité aujourd'hui.
Certains critiquent les services des institutions « monogammes
», parce qu'elles viendraient « écrémer »
la clientèle au Canada, c'est-à-dire qu'elles souffleraient
aux institutions nationales les meilleurs clients, les plus sûrs
et les plus rentables. Ce n'est certes pas le cas de Wells Fargo, de Capital
One ou de Norvest, qui recrutent des clients plus à risque que la
moyenne. Et même si l'accusation d'« écrémage
» était fondée, ce serait un signe d'une concurrence
inexistante, car les bons clients ne se laisseront « entraîner
» que si on leur demande des taux trop élevés. Si,
grâce à des coûts d'exploitation plus bas, les «
monogammes » peuvent réduire les prix courants des services
ou en améliorer la qualité, c'est dire que ce sont ces prix
et ces niveaux de qualité que les consommateurs canadiens devraient
pouvoir obtenir. Le Comité ne croit pas que les lois et les règlements
devraient servir à protéger les fournisseurs qui sont chers
contre les fournisseurs qui le sont moins, puisque cela n'est pas dans
l'intérêt du consommateur.
Dans le cadre de l'OMC, le Canada a accepté de permettre aux
banques étrangères de s'établir directement au Canada
à compter de 1999. Avec le Mexique, le Canada est le seul pays à
interdire la création de succursales. Cette proposition a reçu
un très large appui. Nous sommes d'accord et nous appuyons donc
la recommandation 9.
À notre avis, [. . .] il ne devrait pas y en avoir entre les
fusions bancaires proposées et la possibilité de permettre
aux banques étrangères d'exploiter des succursales. Peu importe
la décision qu'on prendra au sujet des fusions proposées,
il est nettement rationnel de permettre aux banques étrangères
d'exercer leurs activités au Canada par l'entremise de succursales
de l'institution mère. Tous les secteurs financiers et commerciaux,
comme les grands partis politiques, les médias et la population,
appuient fortement l'idée de permettre aux banques étrangères
d'exercer directement leurs activités par l'entremise de filiales
et reconnaissent que ce sera très bénéfique pour le
Canada et les Canadiens.
Gennaro Stammatti (président et directeur général,
Comité de direction des banques étrangères et président
de la Banque commerciale italienne)
Comme l'a clairement dit Gennaro Stammati, de l'Association des banquiers
canadiens (Comité de direction des banques étrangères),
les retards créent de l'incertitude qui, à son tour, empêche
les institutions financières de se donner des plans adéquats
pour servir le marché. Il a affirmé au Comité : «
Le gouvernement fédéral ne devrait certainement plus reporter
son autorisation aux banques étrangères d'exploiter des succursales.
Il est presque impossible à une banque étrangère de
prospérer et de mettre en oeuvre un plan d'entreprise cohérent
pour ses activités canadiennes quand on s'attend constamment à
voir modifier les règles de base, sans que cela se produise jamais.
» Aussi, nous sommes d'avis que le gouvernement devrait sans tarder
faire le nécessaire pour permettre aux banques étrangères
d'ouvrir des succursales au Canada.
Le Comité fait également sien l'avis du Rapport du Groupe
de travail qu'on ne devrait pas empêcher les Canadiens d'utiliser
une technologie comme Internet pour « magasiner » des services
financiers à travers le monde. Le gouvernement ne devrait pas tenter
de contrecarrer cette pratique, mais devrait plutôt s'employer à
fournir le plus d'informations possible et participer aux initiatives internationales
destinées à établir un cadre réglementaire
plus cohérent.
L'intégration internationale est une caractéristique évidente
des marchés financiers de gros. À mesure que la déréglementation
a fait disparaître bon nombre de barrières aux transactions
transfrontalières, l'intégration internationale a pris de
l'ampleur. Et la technologie y a contribué en facilitant l'accès
et en abaissant le coût de ces transactions.
Le Canada a toujours accepté la mondialisation. En tant que pays
commerçant, notre histoire en est le témoignage. Par suite
d'une mondialisation accrue des marchés financiers, la concurrence
se déplace vers les marchés mondiaux plutôt que vers
les marchés nationaux, ou même régionaux.
Les ménages canadiens n'ont pas encore vraiment senti les effets
de la mondialisation, mais la croissance phénoménale d'Internet
devrait changer cela. Il y a une chose qui freine la croissance du marché
à l'heure actuelle, c'est le manque de confiance des consommateurs
dans la sécurité des transactions en direct. Une fois cet
obstacle franchi, la mondialisation des marchés financiers se fera
sentir au niveau des ménages, d'une manière dramatique et
irréversible.
Et une fois la mondialisation pleinement réalisée, les
entreprises et les ménages canadiens auront accès à
des produits et à des services partout dans le monde. Les innovations
commerciales atteindront les Canadiens à une vitesse que nous ne
pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Les institutions canadiennes
qui souhaitent garder leurs clients n'auront d'autre choix que d'être
aussi performantes que les meilleures au monde, indépendamment du
lieu où elles se trouvent ou de leur taille. De fait, les institutions
étrangères seront voisines de leurs concurrentes canadiennes.
Dans l'avenir, c'est cette forme de concurrence étrangère
qui pourrait avoir le plus grand impact sur les institutions financières
canadiennes. Ce ne sont pas tellement ces institutions qui pénétreront
sur le marché canadien, mais plutôt les Canadiens qui, virtuellement,
iront se procurer des services financiers à l'étranger.
Les recommandations 119 à 124 du Groupe de travail portent sur
la question de la fourniture de services financiers à partir de
l'étranger. Ces recommandations ont pour but de créer un
régime réglementaire international pour les fournisseurs
de services financiers transfrontaliers, d'établir un cadre pour
le commerce électronique, de fournir en temps utile des renseignements
aux consommateurs et de mettre en place une procédure d'agrément
pour les institutions financières. Ces recommandations ont l'appui
du Comité et seront examinées plus en détail dans
le chapitre 3.
Enfin, le traitement fiscal des paiements d'intérêts transfrontaliers
constitue un autre frein à une meilleure concurrence de la part
des institutions étrangères. Une retenue fiscale de 25 %
est appliquée aux intérêts versés aux prêteurs
étrangers. Dans certains cas, cette retenue tombe à 10 %
en raison de traités fiscaux. Comme elle s'applique au revenu brut
des intérêts et pas aux marges ni aux profits, c'est un impôt
au taux très élevé. Cela a pour effet soit d'augmenter
les coûts d'emprunt pour les Canadiens ou de leur interdire l'accès
aux sources de crédit à l'étranger. Cette retenue
fiscale a un impact direct sur des prêteurs tels que Wells Fargo,
qui a dit au Comité que cette retenue représentait environ
la moitié de sa marge de profit sur les prêts aux Canadiens17.
Le Comité appuie la recommandation 8, qui demande l'élimination
de toutes les retenues fiscales sur les emprunts sans lien de dépendance.
Cette recommandation tire son origine du Rapport du Comité technique
de la fiscalité des entreprises (le Rapport Mintz). En droit fiscal
canadien, il existe déjà une exemption pour les emprunts
à long terme. Si l'emprunteur n'est pas tenu de rembourser plus
de 25 % du principal avant 5 ans, aucune retenue fiscale ne s'applique
aux intérêts18.
La recommandation 8 va dans ce sens et ne fait qu'appliquer cette mesure
aux emprunts à plus court terme.
Pour le Rapport du Groupe de travail, ce sont les institutions financières
existantes qui renferment le plus fort potentiel d'une concurrence accrue.
C'est la continuation de tendances antérieures, lorsque l'écroulement
des piliers financiers a multiplié les choix pour les consommateurs
canadiens, introduit des innovations dans la prestation des services et
forcé les institutions financières à s'adapter à
la nouvelle réalité économique.
Cela découlait dans une certaine mesure des forces du marché.
Les institutions financières souhaitaient pénétrer
de nouveaux marchés : les compagnies d'assurances commen- cèrent
à proposer des produits d'épargne liés à l'assurance,
les sociétés de fiducie, à ressembler aux banques,
et les banques, à garantir les dettes de leurs entreprises clientes.
Cette évolution a incité le gouvernement à légiférer
pour mettre fin au système des piliers, renforçant ainsi
les tendances dues au marché.
Il est clair que cette évolution a été à
l'avantage des consommateurs. Mais les mesures prises se sont arrêtées
à mi-chemin. Par exemple, les sociétés de dépôts
à charte fédérale n'étaient pas autorisées
à vendre de l'assurance aux particuliers et le crédit-bail
automobile était interdit à toutes les institutions fédérales.
L'interdiction de la vente d'assurances aux particuliers a été
réitérée dans le budget de 1996, pour la raison que
le secteur financier ne s'était pas encore pleinement ajusté
à la réforme financière de 1992. À l'époque,
le gouvernement n'a pas fermé la porte complètement au «
réseautage » en matière d'assurances.
Notre secteur exhorte donc le comité à donner son aval
aux recommandations concernant le système de paiements et à
appuyer la suggestion du Groupe de travail voulant que des mesures soient
prises au plus vite.
Chris McElvaine (président et directeur général,
Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes)
L'autre domaine où l'écroulement des piliers n'a pas donné
tous les résultats attendus est celui de l'accès au système
de paiements. La réforme de 1992 devait permettre aux compagnies
d'assurances d'accéder au système de paiements en étant
propriétaires de succursales de dépôts. D'autres entreprises
financières et commerciales ont depuis longtemps la possibilité
de le faire en étant propriétaires de sociétés
de fiducie. Mais il n'en est pas résulté grand-chose, puisque
c'était une solution coûteuse et que bon nombre d'obstacles
auxquels les sous-adhérents étaient confrontés demeurent.
Le système des paiements fait également l'objet d'un
grief de longue date du secteur des assurances. [. . .] Essentiellement,
cela signifie que chaque fois que nous payons un de nos clients, et nous
versons des milliards de dollars tous les ans à nos clients, nous
envoyons en fait de l'argent à un concurrent, qu'il s'agisse d'une
banque, d'une coopérative de crédit ou d'une caisse populaire.
Claude Garcia (président et directeur général,
Compagnie d'assurance Standard Life)
À cet égard, le Groupe de travail recommande que les sociétés
d'assurance-vie, les fonds communs de placement et les courtiers en valeurs
mobilières aient pleinement accès au système de paiements
(voir recommandation 13). Ces trois groupes offrent des produits qui sont
des quasi-dépôts, de sorte que le Groupe de travail a jugé
qu'il était normal qu'ils participent à ce système.
John Kaszel, de l'Institut des fonds d'investissement du Canada, a fait
valoir que faire partie de l'Association canadienne des paiements «
nous aiderait énormément. La participation au système
de paiements permettrait une circulation ininterrompue de fonds entre nos
clients et nous. Cela représenterait des économies pour tout
le monde, des diminutions de coûts et un meilleur rendement. Par
meilleur rendement je veux dire que les pertes seraient minimisées
pendant la circulation des fonds et qu'il y aurait une plus grande concurrence.
» Donald Stewart, de la Compagnie d'assurance-vie Sun Life, a affirmé
: « L'évolution de la technologie, les attentes des consommateurs
et l'intensification de la concurrence font en sorte qu'il est maintenant
essentiel de pouvoir accéder au système de paiements pour
attirer et fidéliser la clientèle. »
L'accès au système des paiements permettrait aux sociétés
de valeurs mobilières d'offrir directement des comptes-chèques
à leurs clients. Les sociétés d'investissement seraient
donc placées sur le même pied que les banques pour gérer
les actifs de leurs clients, et nos clients pourraient ainsi se lancer
résolument dans le commerce électronique en ayant directement
accès au réseau Interac.
Joseph Oliver (président et directeur général,
Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières)
Nous abondons dans le sens de ces témoins et nous recommandons
que le gouvernement fédéral suive de près les règles
et les règlements de l'ACP afin de prévenir tout nouvel obstacle
à l'accès au système destiné à contourner
l'esprit de la recommandation 13 du Groupe de travail. Nous appuyons également
les recommandations 14 et 15 qui autorisent le ministre des Finances à
approuver des règlements et à émettre des directives
pour modifier les règlements. Un règlement qui, de l'avis
du Comité, nuit à la concurrence est la règle H-4
de l'ACP, qui interdit les prélèvements électroniques
ou ponctuels entre institutions financières. Le Comité estime
qu'une telle règle n'a pas de raison d'être, sauf à
des fins de sécurité.
[Le Groupe de travail] recommandait aussi que le ministre ait le
pouvoir de revoir toutes les règles nouvelles ou révisées
de l'Association canadienne des paiements (ACP) et de révoquer toutes
celles qu'il juge contraires à l'intérêt public. Compte
tenu du nombre considérable de règles de l'ACP, du caractère
très technique de la plupart d'entre elles et de la nécessité
que l'ACP puisse réagir rapidement aux questions émergentes,
l'approche du Groupe de travail serait manifestement une formule plus efficiente
que l'obligation de faire approuver d'avance toutes les règles par
un organisme gouvernemental.
Robert Hammond (directeur général, Association
canadienne des paiements)
Il est également important pour la stimulation de la concurrence
que de nouveaux réseaux soient développés, en particulier
Interac. Comme l'a fait valoir Donald Stewart, de la Sun Life : «
[. . .] pour maximiser le potentiel concurrentiel des acteurs en place,
il faudra leur donner, à des conditions raisonnables, libre accès
à d'autres réseaux. En particulier, nous appuyons fortement
la proposition d'élargir les fonctions offertes par le réseau
Interac . » Les recommandations 16 et 17 du Groupe de travail reconnaissent
l'importance de ce réseau. Là aussi nous sommes d'accord.
Le ministre des Finances devrait suivre de près les activités
d'Interac pour s'assurer que la concurrence s'exerce librement. Rendre
les réseaux plus fonctionnels favorisera très nettement la
concurrence en aidant à la création de l'équivalent
de réseaux à grande échelle, même pour les petites
institutions de dépôts locales. Mais avant de permettre les
dépôts interbancaires dans des GAB, les questions techniques
et de sécurité doivent être réglées.
En outre, rendre le système plus fonctionnel, comme le recommande
le Groupe de travail, pourrait nuire à l'efficacité du système
de paiements électroniques si cela signifiait un recours accru à
des transactions « sur papier », alors que le système
s'automatise de plus en plus.
Nous reconnaissons que les consommateurs pourraient profiter de services
supplémentaires. [. . .] Toutefois, nous croyons que les spécialistes
qui conçoivent et élaborent des solutions technologiques
sont les mieux placés pour déterminer comment mettre en oeuvre
les solutions innovatrices aux besoins des consommateurs. La solution proposée
dans la recommandation 17 est une façon d'aborder le service aux
consommateurs, mais votre comité doit prendre conscience qu'il s'agit
d'une solution coûteuse et complexe.
Judith Wolfson (présidente, Association Interac
Dans le même sens, le Comité croit que les institutions
de dépôts peuvent, dans les bonnes circonstances, stimuler
la concurrence grâce à des pouvoirs accrus en matière
de réseautage d'assurances et de crédit-bail automobile.
Étendre les pouvoirs des institutions financières à
charte fédérale peut être une mesure favorable aux
consommateurs. Mais cela demeure un domaine très sensible. C'est
pourquoi nous approfondissons la question plus loin dans le Rapport.
Le Groupe de travail recommande l'ouverture de l'ACP à de
nouveaux membres. Je tiens à signaler que, dès le début
du processus d'examen, l'ACP a fait savoir qu'elle n'avait pas d'objection
de principe à l'ouverture de l'ACP. Elle a aussi fait valoir que
les décideurs devraient alors bien peser les ramifications d'une
telle décision sur les attributs du système de compensation
et de règlement auxquels les Canadiens attachent tant de prix, à
savoir l'efficience et la sécurité.
Robert Hammond (directeur général, Association
canadienne des paiements)
Par des mesures telles qu'une politique de la concurrence, les gouvernements
peuvent tenter de stimuler la concurrence sur le marché, mais, en
définitive, c'est le comportement des consommateurs qui fait que
la concurrence s'exerce effective- ment. Ceux-ci doivent non seulement
avoir des choix, mais sentir aussi qu'ils peuvent en profiter. Il a été
dit plus tôt que les institutions monogammes avaient le potentiel
de contribuer à la concurrence, mais si les consommateurs se sentent
contraints de demeurer avec les fournisseurs de multiservices, ils pourraient
ne pas prendre avantage de ces nouveaux services. En pareil cas, les concurrents
qui exploitent des créneaux pourraient demeurer impuissants.
Le Comité estime qu'il est important que les consommateurs se
sentent libres de choisir entre les divers services financiers et entre
les fournisseurs. Il est important non seulement qu'ils aient la capacité
de magasiner, mais aussi qu'ils en soient bien conscients. Ils doivent
savoir qu'ils peuvent compter sur la politique du gouvernement. Aussi,
le Comité recommande que le public en soit bien informé,
non seulement par les institutions financières concernées,
mais par le gouvernement fédéral également.
Par ailleurs, le Comité est conscient que les mesures destinées
à protéger le consommateur sont coûteuses pour les
institutions, et que ces coûts se répercutent sur le consommateur.
Il y a donc un compromis à trouver, car mettre en place une protection
légale accrue, qui coûte cher, peut ne pas être dans
l'intérêt des consommateurs.
Le Comité appuie plusieurs des recommandations du Groupe de travail
visant à renforcer le pouvoir des consommateurs, même si elles
vont bien au-delà de ce qui existe et qu'elles pourraient faire
augmenter les coûts de conformité. Le Groupe de travail fait
valoir que ces recommandations protégeraient les consommateurs contre
les abus qui pourraient découler de l'élargissement du pouvoir
des entreprises.
Les mesures de protection des consommateurs recommandées par
le Groupe de travail sont vastes, aussi seront-elles examinées plus
longuement dans ce Rapport.
Le dernier outil pour favoriser la concurrence, l'instrument réglementaire,
a toujours été d'une importance vitale dans le secteur financier,
et il le devient de plus en plus. Le cadre réglementaire a un très
gros impact sur le profil du secteur financier, pour le meilleur ou pour
le pire. On dit souvent que c'est un facteur critique dans la compétitivité
des institutions financières, mais il n'est pas moins vrai que la
structure de la réglementation peut aussi avoir un impact direct
sur la concurrence.
Plus tôt, le Comité s'est prononcé en faveur de
la recommandation 4, destinée à favoriser l'arrivée
de nouveaux concurrents dans le secteur financier. En demandant de «
ne plus assujettir toutes les institutions à des règles identiques
», la recommandation 4(c) vise précisément les petites
institutions. L'idée de conformité avec la réglementation
évoque la notion d'économies d'échelle. Pour les petites
institutions, cela représente un coût disproportionné,
alors qu'elles ne présentent qu'un petit risque pour le secteur
financier. Si nous voulons promouvoir la concurrence au moyen d'institutions
financières de second rang, il est important que le gouvernement
ne nuise pas aux perspectives financières de ces institutions. Il
est important que des mesures réglementaires comme les primes liées
au risque de la SADC ou les mesures de protection des consommateurs ne
nuisent pas à la compétitivité d'un groupe donné
d'institutions.
Un marché se caractérise par l'existence ou l'absence
de concurrence, sur la base du comportement effectif ou potentiel des participants.
Le nombre des participants est un indicateur utile de la structure d'un
secteur d'activité, mais il ne dit pas tout.
Si rien n'entrave l'entrée sur un marché donné,
et s'il existe un groupe d'institutions qui pourraient entrer sur ce marché,
celui-ci présenterait probablement des signes de concurrence. Si
les entreprises rivalisent et s'efforcent chacune d'obtenir une plus grande
part de marché, il y aura concurrence. Si une entreprise essaie
de profiter de sa position sur le marché pour augmenter ses prix,
les autres réagiront immédiatement, car elles verront dans
ces prix plus élevés une occasion d'accroître leur
part de marché et d'augmenter leurs bénéfices.
Le Rapport MacKay essaie de stimuler la concurrence en jouant sur ces
deux variables. En réduisant les obstacles qui entravent l'accès
aux marchés, on rend le marché plus concurrentiel, car les
nouvelles institutions à la recherche de parts de marché
stimulent la compétitivité.
On peut faciliter l'accès au marché de plusieurs manières
: en permettant plus facilement aux institutions financières étrangères
de servir le marché canadien, en donnant à un certain type
d'institutions financières davantage accès au système
de paiements, en abaissant les exigences de capital pour les nouvelles
institutions et en réduisant leur impôt sur le capital, en
encourageant la création de banques coopératives et en accroissant
les pouvoirs des centrales des coopératives de crédit de
manière à leur permettre de mieux servir leurs membres. On
peut aussi permettre aux institutions financières existantes d'offrir
des produits qu'elles ne pouvaient pas vendre auparavant ou leur permettre
de recourir à des mécanismes de prestation nouveaux et plus
efficaces. C'est cette question qui nous intéresse ici. Ces mesures
semblent stimuler la concurrence en augmentant la compétition et
en permettant à de nouveaux joueurs d'entrer dans le jeu.
Soucieux d'accroître la concurrence dans le secteur des services
financiers, le Groupe de travail MacKay a recommandé que soient
élargis les pouvoirs des institutions financières. Les recommandations
13 à 17, qui portent sur le système de paiements et d'autres
réseaux comme Interac, ne sont pas très controversées
et sont généralement bien acceptées. Ces recommandations
étendraient l'accès au système de paiements aux compagnies
d'assurance-vie, aux sociétés de fonds communs de placement
et aux courtiers en valeurs mobilières. Elles auraient aussi pour
effet d'élargir les fonctions du réseau de guichets automatiques,
ce qui, d'après la Banque Hongkong du Canada, entraînerait
l'apparition d'une foule de nouveaux concurrents.
Les institutions financières sont de plus en plus semblables.
Elles offrent des produits d'épargne très similaires et découvrent
que les consommateurs veulent trouver dans l'institution financière
avec laquelle ils font affaire un plus vaste éventail de produits
financiers. C'est le système de paiements, et en particulier le
système de paiements électronique, qui va de plus en plus
définir le système financier de l'avenir. C'est l'élargissement
de l'accès au système de paiements qui va, en dernière
analyse, faire définitivement disparaître le système
traditionnel des quatre piliers. Tant que les nouveaux participants répondent
aux conditions de solvabilité et de liquidité, il n'y a pas
de raison de penser que leur entrée sur le marché risque
de compromettre la solidité et la haute qualité du système
de paiements que nous avons actuellement19.
Ces recommandations sont bien acceptées et ne prêtent pas
à controverse.
En somme, tout le Rapport MacKay s'arrête à ce qui est
avantageux pour le secteur des services financiers et les banques. Il ne
tient pas compte de ce qui est bon ni pour les petites entreprises, ni
pour les petites localités, ni pour l'industrie automobile, ni pour
les consommateurs au bout du compte.
Gilles Richard (président sortant, Corporation des
concessionnaires d'automobiles de Montréal et président,
Le Circuit Mercury (1977) Ltée)
Ce n'est pas le cas cependant des recommandations 18 à 21, lesquelles
conféreraient aux institutions de dépôts sous réglementation
fédérale le pouvoir de vendre des produits d'assurance au
détail (assurance-vie ou assurances IARD) dans leurs succursales
et de se servir des renseignements qu'elles possèdent sur leurs
clients pour cibler la commercialisation de ces produits, sous réserve
de mesures de protection des renseignements personnels plus strictes et
légiférées. Ces recommandations permettraient aussi
à toutes les institutions financières sous réglementation
fédérale de faire du crédit-bail de véhicules
légers, c'est-à-dire du crédit-bail automobile. Le
Groupe de travail prévoit que ces recommandations n'entreraient
en vigueur qu'après l'établissement de règles appropriées
régissant la protection des renseignements personnels et les ventes
liées. Ces règles, qui font l'objet des recommandations 64
à 75, légiféreraient un régime complet de protection
des renseignements personnels dans lequel elles deviendraient un droit
fondamental. Les consommateurs devraient donner leur consentement express
à la divulgation des renseignements qui les concernent et à
leur utilisation à de nouvelles fins, et un code exécutoire
de protection des renseignements personnels serait institué. Ces
recommandations élargiraient par ailleurs la portée de l'interdiction
actuelle visant les ventes liées et forceraient les institutions
financières à remettre à leurs clients, avant la signature
de tout contrat, une description écrite des ventes liées
avec coercition indiquant clairement que cette pratique est illégale.
Les petites institutions aussi pourraient profiter de cet élargissement
des pouvoirs une fois que des mesures de protection des consommateurs seront
instituées. Les grandes institutions, c'est-à-dire celles
dont l'avoir des actionnaires dépasse 5 milliards de dollars, ne
pourraient pas se prévaloir de ces nouveaux pouvoirs jusqu'en l'an
2002.
La Banque Nationale du Canada accueille très favorablement
la possibilité de vendre des assurances, surtout que notre principal
concurrent au Québec le fait. Ce dernier a le pouvoir de vendre
non seulement des assurances-vie, mais des assurances IARD. J'estime également
qu'il incombe au gouvernement fédéral d'harmoniser la législation
qui régit les institutions financières. Si le fait qu'une
institution soit constituée sous le régime de la loi fédérale
dans une province en particulier pose problème, il faut absolument
prendre des mesures pour régler ce problème. On ne peut pas
se permettre de l'ignorer.
Léon Courville (président, Banque des particuliers
et des entreprises, et chef des opérations, Banque Nationale du
Canada)
Le Groupe de travail justifie essentiellement la vente d'assurances
dans les succursales bancaires en disant que cela élargirait les
choix des consommateurs sans compromettre grandement la protection des
renseignements personnels ni accroître le risque de pratiques abusives.
D'après des sondages d'opinions, moins du tiers des Canadiens sont
inquiets au sujet de cette dernière éventualité. Les
ménages à faible revenu seraient mieux servis, et à
moindre coût, si l'on pouvait vendre de l'assurance dans les succursales
des institutions de dépôts. Au demeurant, le Canada est une
anomalie à cet égard à l'échelon international.
En effet, que ce soit en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni,
les institutions de dépôts peuvent avoir comme filiales des
sociétés d'assurances, peuvent vendre de l'assurance au détail
dans leurs succursales et peuvent exploiter les renseignements qu'elles
possèdent sur leurs clients pour commercialiser cette assurance.
L'information contenue dans les renseignements sur les clients permet aux
agents d'être plus productifs et donc d'abaisser les coûts
de distribution. Pour leur part, les institutions de dépôts
américaines ne peuvent pas avoir comme filiales des sociétés
d'assurances, mais elles peuvent en revanche vendre de l'assurance au détail
et exploiter à cette fin les renseignements qu'elles possèdent
sur leurs clients.
Le Groupe de travail conclut, en outre, que les institutions de dépôts
ne risquent pas d'évincer les institutions et les réseaux
de distribution traditionnels. Les deux canaux coexistent dans d'autres
pays, et il est fort probable que, comme les compagnies d'assurance-vie
auront les reins plus solides grâce à la démutualisation
et à l'accès au système de paiements, on ne compromettra
pas leurs possibilités de coexistence avec les institutions de dépôts20.
Les institutions à capitaux étrangers jouent un rôle
prépondérant dans le secteur de l'assurance générale.
Même s'il existe beaucoup d'entreprises canadiennes dynamiques dans
ce secteur, les sociétés à capitaux étrangers
ont accaparé environ 68 % des primes nettes souscrites au Canada
en 1997, comparativement à environ 63 % en 1991.
Il devrait en aller de même des assurances IARD. Les nouveaux
canaux de distribution gagnent déjà des parts de marché
au chapitre des assurances de particuliers et de l'assurance-automobile,
et cela tient au fait que le produit est assimilable en quelque sorte à
un « produit de consommation ». L'assurance commerciale, beaucoup
plus complexe, continue d'être offerte par les canaux traditionnels.
En ce qui concerne le crédit-bail automobile, le Groupe de travail
fait remarquer que, là encore, le Canada se distingue des autres
pays industrialisés. Aux États-Unis, où les banques
peuvent consentir du crédit-bail automobile, les consommateurs bénéficient
de choix plus nombreux. Ces choix sont offerts au détriment des
sociétés de financement captives. Or, au Canada, celles-ci
possèdent actuellement 80 % du marché du crédit-bail
automobile. Trois entreprises accaparent à elles seules 70 % du
marché.
Les recommandations du Groupe de travail suscitent passablement de controverse,
malgré les mesures de protection des consommateurs très strictes
qui seraient imposées avant de conférer aux institutions
des pouvoirs additionnels en matière de vente d'assurance et de
crédit-bail automobile. Le Comité a entendu de nombreux témoins,
en particulier des courtiers d'assurances IARD, qui sont contre l'élargissement
des pouvoirs des banques. Leurs critiques tournent autour de plusieurs
thèmes fondamentaux, notamment l'aptitude des banques à se
livrer à des ventes liées en usant de méthodes coercitives,
l'avantage injuste dont jouissent les banques du fait qu'elles ont accès
à des renseignements personnels sur leurs clients et l'aptitude
des banques à recourir à l'interfinancement pour décrocher
des parts de marché. Ils affirment, en outre, que cet élargissement
des pouvoirs des banques va entraîner l'éviction de courtiers
d'assurances privés du marché, ce qui aura pour effet de
réduire la concurrence et non de l'accroître.
D'après les estimations tenant compte des fusions les plus
récentes, les 5 plus grandes sociétés d'assurance-vie
détiendront maintenant environ 59 % du marché de l'assurance
individuelle et 62 % du marché de l'assurance collective, comparativement
à 42 % et 43 % respectivement en 1991.
Abstraction faite de ces doléances des courtiers d'assurances,
les constructeurs et les concessionnaires d'automobiles voient un conflit
d'intérêts potentiel si les banques sont autorisées
à louer des automobiles directement en même temps qu'elles
financent les stocks des concessionnaires. On a aussi argué que
les banques jouissent d'un avantage important sur le plan du coût
de l'argent dont elles pourraient se servir pour évincer leurs concurrents.
Les groupes qui seraient touchés par les recommandations du Rapport
MacKay ne protestent pas tous avec la même vigueur. Les agents et
les courtiers d'assurance-vie, par exemple, ne sont pas aussi inquiets
que les courtiers d'assurances IARD et les concessionnaires d'automobiles.
La compagnie d'assurance-vie Great-West et sa société mère,
Power Corporation, ont dit qu'elles ne pouvaient pas soutenir la concurrence
des banques si celles-ci vendaient de l'assurance dans leurs succursales,
mais qu'elles n'avaient pas d'objection à ce que les banques soient
propriétaires de compagnies d'assurances et vendent leurs produits
de la manière traditionnelle, comme c'est le cas actuellement. La
Sun Life, en revanche, privilégie des choix plus grands pour le
consommateur et ne s'oppose donc pas à la recommandation du Groupe
de travail voulant que les banques soient autorisées à vendre
de l'assurance dans leurs succursales. La Compagnie d'Assurance du Canada
sur la Vie non plus n'est pas contre cette recommandation; 75 % de son
actif concerne des produits d'épargne et non des produits d'assurance,
et elle pourrait soutenir la concurrence des banques. D'ailleurs, elle
le fait déjà sans problème au Royaume-Uni et en Irlande,
où la bancassurance existe depuis plus de 10 ans. La Financière
Manuvie elle aussi croit pouvoir être aussi compétitive que
les banques, même si celles-ci étaient autorisées à
vendre de l'assurance au détail dans leurs succursales, à
la condition que la transition soit progressive. La Mutuelle du Canada
hésite, mais elle n'est pas carrément contre la vente d'assurance
par les banques; elle pense cependant qu'il faudrait attendre la disparition
des inégalités sur le plan de la concurrence entre les compagnies
d'assurance-vie et les institutions de dépôts avant de conférer
aux banques de nouveaux pouvoirs en matière d'assurance.
Le Rapport du Groupe de travail admet que les produits d'assurance-vie
et d'assurance générale sont très différents,
mais conclut aussi que les problèmes de réglementation que
pose la combinaison des activités de prise de dépôts
et des activités de vente d'assurance sont les mêmes pour
les deux types de produits. Il a donc concentré son analyse sur
les produits d'assurance-vie, car c'est dans ce secteur que l'expérience
est le plus grande au niveau international.
[L']évaluation [du Groupe de travail] des territoires où
les institutions de dépôts sont autorisées à
vendre de l'assurance et à offrir du financement par crédit-bail
montre que les assureurs traditionnels, les sociétés de financement
par crédit-bail et les concessionnaires d'automobiles peuvent bel
et bien coexister, se livrer concurrence et prospérer dans ce marché
aux côtés des institutions de dépôts.
Raymond Protti (président et chef de la direction,
Association des banquiers canadiens)
Les études de fond et les rapports techniques étudient
l'expérience internationale de la vente d'assurance-vie dans les
banques. La bancassurance existe en Europe depuis un certain temps. Elle
résulte de l'évolution démographique et des avantages
fiscaux que présentent certains produits d'assurance. En France,
où les banques vendent de l'assurance depuis les années 1970,
la part des banques du marché de l'assurance dépasse 50 %.
La part des banques est aussi élevée en Italie (plus de 33
%). Dans les autres pays, les banques n'ont pas réussi à
s'imposer autant sur le marché de l'assurance. Les avantages des
nouveaux canaux de distribution sont essentiellement d'ordre financier
et concernent les coûts. Le coût de distribution de produits
d'assurance dans les banques représente environ la moitié
du coût associé à la vente d'assurance par un courtier
indépendant.
Les banques vendent surtout de l'assurance-vie, mais la Royal Bank of
Scotland a innové en vendant de l'assurance générale
par le biais de centres téléphoniques. Aux États-Unis,
les banques vendent des produits d'assurance, notamment ceux de nombreuses
compagnies d'assurance-vie canadiennes.
Notre secteur exhorte donc le Comité à recommander
que l'adoption et la mise en place de mesures efficaces relatives au système
de paiements et aux mécanismes d'indemnisation des consommateurs
précèdent toute modification du cadre législatif et
réglementaire actuellement applicable à la distribution de
l'Assurance par les institutions de dépôts.
Chris McElvaine (président, Association canadienne
des compagnies d'assurance de personnes et président et directeur
général, Empire Life)
Le Comité n'est pas convaincu que la concurrence ne sera pas
accrue si les institutions financières fédérales obtiennent
de nouveaux pouvoirs. Ce qu'il faut, c'est un train de réformes
préalables qui feront en sorte que les pouvoirs accrus seront bénéfiques.
Voici ce que le Comité pense des divers arguments avancés.
En règle générale, les détracteurs de l'élargissement
des pouvoirs des banques supposent une absence de concurrence dans le secteur
bancaire, maintenant et dans l'avenir. Ils ne croient pas tellement aux
effets des tendances actuelles du marché qui avivent la concurrence
et n'ont pas grande confiance dans les recommandations du Groupe de travail
conçues pour stimuler la concurrence et améliorer la protection
des consommateurs. Ainsi, pour eux, toute mesure visant à permettre
aux banques d'accroître leur part de marché est forcément
préjudiciable à la concurrence. Ce sont là, toutefois,
des affirmations gratuites qui restent à démontrer.
La présence accrue des banques dans certaines branches d'activité
ne signifie pas pour autant que la concurrence s'en trouve réduite.
On a beaucoup fait valoir le fait que les banques occupaient maintenant
une position dominante dans la prestation de certains services qui leur
étaient auparavant interdits. Or, si les banques se sont taillé
une place parce qu'elles sont plus efficaces et qu'elles peuvent par conséquent
offrir les services en question à un meilleur prix, les consommateurs,
loin d'être perdants, y gagnent.
Le marché du crédit à la consommation en est un
bon exemple. Les sociétés de financement ont perdu du terrain
au profit des banques parce que celles-ci pouvaient pratiquer des taux
moins élevés. Les taux pratiqués sur le crédit
à la consommation ont baissé lorsque les banques se sont
mises de la partie. L'écart entre les taux du crédit à
la consommation et le taux d'escompte est plus faible aujourd'hui que dans
les années 1950, lorsque la part de marché des banques représentait
la moitié de celle dont elles jouissent aujourd'hui21.
Dans l'ensemble, les sociétés de financement ne sont pas
réglementées, si bien que leur marché est très
ouvert. Si les banques profitaient de leur position pour pratiquer des
prix élevés, ces sociétés pourraient facilement
revenir récupérer leur part de marché. Le fait qu'elles
ne l'aient pas fait dans les 40 dernières années montre que
le marché est compétitif. Le fait que les banques accaparent
maintenant les deux tiers du marché du crédit à la
consommation est le résultat de la concurrence et non pas la marque
de l'absence de concurrence. La même chose vaut pour le crédit
hypothécaire à l'habitation. Les banques ont maintenant la
moitié du marché, comparativement à environ 10 % dans
les années 1970, et pourtant on s'entend généralement
pour dire que c'est celui des services financiers où la concurrence
est la plus vive. L'écart des taux d'intérêt hypothécaires
correspondant à l'écart entre le taux hypothécaire
et le rendement moyen des obligations à trois ans et à cinq
ans du gouvernement est bien moindre que ce qu'il était dans les
années 197022.
Il en va de même dans le secteur des valeurs mobilières.
Dans les 10 dernières années, les banques ont saisi les trois
quarts du marché par la voie d'acquisitions, pourtant, à
de nombreux égards, les frais de service ont diminué, en
partie à cause de modifications de la réglementation et en
partie directement à cause de l'accroissement de la concurrence23.
Là encore, ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait dans un
marché où les banques domineraient en totalité.
Il est aussi important de tenir compte des changements qui se produisent
et qui continueront de se produire même si l'on ne conférait
pas de pouvoirs nouveaux aux institutions sous réglementation fédérale.
La position des joueurs actuels est déjà menacée.
L'assurance IARD est dans une large mesure assimilable bien davantage à
un produit qu'à un service financier, et elle sera de plus en plus
vendue selon des modes non traditionnels, par exemple par vente directe,
par le biais de centres téléphoniques, et ainsi de suite.
Le secteur de l'assurance de biens et de risques divers est parvenu
à maturité au Canada. Si la commercialisation de l'assurance
se fait en majorité par l'intermédiaire des courtiers indépendants,
ce n'est pas parce qu'il y a une affinité entre les assureurs et
les courtiers, mais plutôt parce que l'on s'est bien rendu compte
que le réseau de distribution des courtiers était efficace
et rentable. Ces éléments propres à l'industrie et
bien d'autres facteurs ont été totalement passés sous
silence par le Groupe de travail MacKay.
Gil Constantini (président élu, Insurance Brokers
Association of Ontario)
À de nombreux égards, les sociétés d'assurances
IARD se trouvent devant le même dilemme que les banques. Elles ont
un réseau de distribution qui les a bien servies dans le passé,
mais les changements technologiques et les exigences des consommateurs
les forcent à trouver de meilleures manières d'assurer la
prestation de leurs produits. Elles doivent traverser cette transition
sans s'aliéner les consommateurs qui se satisfont de canaux de distribution
courants. Selon une étude réalisée par Coopers &
Lybrand pour le compte du Groupe de travail, « [. . .] comme il a
été possible de le constater dans d'autres pays, une partie
importante du marché du courtage pourrait s'effriter rapidement
à mesure que les assureurs continueront de rechercher de nouveaux
canaux de distribution qui offrent les avantages de la rapidité
et de la commodité aux consommateurs 24.
»
Il se passe un peu la même chose dans le secteur de la vente d'automobiles,
ce qui explique peut-être en partie l'opposition des concessionnaires
à la participation directe des banques au crédit-bail automobile.
L'apparition de courtiers sur Internet, comme Auto-by-Tel, a pour effet
de réduire les marges des concessionnaires sur les ventes d'automobiles25,
ce qui va devenir de plus en plus courant. Le fait que les banques pratiquent
directement du crédit-bail automobile ne pourrait qu'accentuer cette
tendance.
Interfinancement : Un des arguments invoqués contre l'entrée
des banques sur le marché de la vente d'assurance au détail
est le fait que les banques peuvent recourir à l'interfinancement
des produits d'assurance pour accaparer des parts de marché. Cependant,
l'interfinancement ne dépend pas de la distribution en succursale.
Il est déjà possible maintenant. Ce qui inquiète,
c'est l'ampleur éventuelle du phénomène et la possibilité
que cela nuise à la concurrence, le cas échéant.
L'interfinancement permet de vendre un produit à un prix inférieur
au coût de production, la différence étant financée
par les recettes provenant d'une autre gamme de produits. Cette pratique
exige l'existence d'une gamme de produits qui n'est pas exposée
à la concurrence et qui peut donc générer les profits
excédentaires nécessaires au financement de la gamme de produits
subventionnés. Il faut une absence de concurrence entre les institutions
de dépôts, ce qui est précisement ce que les opposants
disent du secteur financier au Canada.
La proportion du financement des entreprises reliée aux prêts
bancaires est passée d'un sommet de 50 % en 1982-1983 et a depuis
chuté à moins d'un tiers. Les entreprises se sont tournées
vers des sources de capitaux à meilleur marché et vers des
sociétés de prêt sur actif pour répondre à
leurs besoins de financement.
Les banques sont confrontées à une concurrence de plus
en plus forte. Elle vient des institutions monogammes qui pénètrent
le marché des cartes de crédit. Elle vient des marchés
financiers où les entreprises court-circuitent les banques pour
se financer directement26.
Elle vient des fonds communs de placement qui se substituent aux dépôts
bancaires et aux CPG27.
La question est de savoir toutefois si ces tendances et les effets de réformes
proposées par le Groupe de travail pourront contrer les éventuels
impacts négatifs sur la concurrence du réseautage des assurances.
Il existe un autre facteur important, à savoir la structure du
marché dans lequel l'interfinancement pourrait se produire. S'il
est très facile d'y entrer, pas un prédateur ne pourrait
exploiter la part de marché acquise par interfinancement parce que
de nouvelles institutions viendraient immédiatement lui faire concurrence.
L'interfinancement devient alors une façon coûteuse d'obtenir
des gains à court terme qui n'ont pas de retombées avantageuses
à long terme.
Le secteur des assurances IARD est facile d'accès, comme l'admettent
les assureurs eux-mêmes, et on peut en dire autant de celui du crédit-bail
automobile, à peu près pas réglementé.
Utilisation des renseignements sur les clients: Certains affirment
par ailleurs que la vente d'assurance au détail par les banques
présente un autre effet néfaste pour la concurrence, qui
tiendrait à l'avantage « injuste » des banques et d'autres
qui peuvent exploiter les renseignements personnels sur leurs clients pour
cibler la vente d'assurance. Les banques sont mieux renseignées
sur les Canadiens que n'importe quelle autre institution.
Le Rapport répond à cette préoccupation en recommandant
plusieurs réponses. D'abord, le Groupe de travail MacKay recommande
plusieurs mesures conçues pour protéger les consommateurs,
notamment des dispositions législatives pour la protection des renseignements
personnels, des interdictions plus strictes concernant les ventes liées
et un poste d'ombudsman indépendant. Les risques d'abus sont grandement
réduits si les consommateurs peuvent définir eux-mêmes
leurs rapports avec une institution financière. Aujourd'hui, bien
des Canadiens estiment qu'ils ne sont pas adéquatement protégés
contre les atteintes à leur vie privée. Si le niveau de protection
des consommateurs n'est pas accru, le réseautage des assurances
pourrait les exposer à des atteintes encore plus grandes.
Ventes liées abusives: Enfin, il y a la question des ventes
liées avec coercition. Le Comité traite de cette question
ailleurs dans le présent Rapport et souscrit aux recommandations
du Rapport MacKay qui renforceraient sensiblement les interdictions relatives
aux ventes liées. Compte tenu des autres mesures de protection des
consommateurs recommandées par le Groupe de travail, il semble que
les consommateurs seront protégés efficacement lorsqu'elles
seront appliquées.
Toutes les institutions financières ont une réputation
à préserver, et c'est cette réputation qui leur permet
d'attirer de nouveaux clients et de les garder. Plusieurs institutions
ont indiqué clairement au Comité qu'un comportement mal inspiré
de leur part risque de compromettre sérieusement leurs relations
avec leurs clients. Les tentatives d'appliquer des méthodes coercitives
peuvent non seulement faire avorter de nouvelles affaires, mais également
entraîner la perte d'affaires existantes. Cet effet dissuasif sur
les pratiques abusives ne peut s'exercer que si les consommateurs ont la
possibilité de changer de fournisseur.
En somme, le Rapport MacKay, c'est la vision de ce qui est bon pour
les banques. Ce n'est pas ce qui est bon pour la petite entreprise, ce
n'est pas ce qui est bon pour les localités, ce n'est pas ce qui
est bon pour l'industrie automobile, et ce n'est pas ce qui est bon pour
le consommateur à long terme.
Gérald Drolet (président, Corporation des Associations
de détaillants d'automobiles)
L'avantage injuste du coût des fonds : Les concession-
naires d'automobiles qui s'opposent avec véhémence au crédit-bail
direct par les institutions financières fédérales
mentionnent souvent l'avantage injuste dont jouissent les banques par rapport
aux donneurs à bail traditionnels, en raison de leur capacité
de recueillir des fonds grâce aux dépôts à bon
marché. Les donneurs à bail ne pourraient donc jamais lutter
à armes égales avec les banques.
Outre l'intérêt qu'elles versent sur les dépôts,
les institutions de dépôts doivent acquitter toute une panoplie
de frais. Le différentiel de taux d'intérêt n'est donc
pas indicatif des marges de profit. Ce qui importe davantage, c'est que
les grandes sociétés de crédit-bail comptent parmi
les firmes les plus stables et les plus rentables du monde. Avec leurs
excellentes cotes de solvabilité28,
elles peuvent obtenir des fonds à très bon marché
grâce aux effets de commerce, sans être obligées de
soutenir un réseau étendu de succursales de détail.
Deuxièmement, les dépôts deviennent de moins en
moins avantageux comme sources de fonds, surtout parce que les consommateurs
se tournent vers les fonds communs. Il y a déjà davantage
de placements dans des fonds communs que de dépôts personnels
dans les banques, et leur taille dépassera bientôt celle de
tous les dépôts. À la limite, les institutions de dépôts
qui financeraient le crédit-bail automobile à l'avenir obtiendraient
leurs fonds par des moyens qui ne sont sans doute guère différents
de ceux qu'utilisent les donneurs à bail actuels. Elles ne jouiraient
donc pas d'un avantage important.
orsque vous entreprendrez cette révision, il est important
que vous sachiez que le Rapport MacKay contient plusieurs erreurs cruciales.
Ce dernier, par exemple, allègue que les caisses populaires du Québec
louent directement des véhicules, alors pourquoi les banques ne
pourraient-elles pas le faire elles aussi? En réalité, cette
affirmation est fausse. Au Québec, les caisses populaires ont avec
des concessionnaires une entente écrite stipulant qu'ils ne feront
pas de location directe.
Gilles Richard (président sortant, Association des
marchands d'automobiles de Montréal, et président, Le Circuit
Mercury (1977) Ltée)
Conflit d'intérêts : L'un des arguments les plus
anciens à l'encontre du crédit-bail automobile direct par
les banques est que ces dernières se trouveraient en conflit d'intérêts
par rapport aux concessionnaires, dont les stocks sont également
financés par les banques. D'une part les concessionnaires seraient
leurs clients, d'autre part ils seraient leurs concurrents.
À cet égard, l'Association des marchands d'automobiles
de Montréal a cité une déclaration faite en 1990 par
le sous-ministre adjoint des Finances de l'époque :
Essentiellement, le gouvernement a conçu cette politique (de
limitation des pouvoirs des banques en matière de crédit-bail)
parce qu'il percevait un énorme conflit d'intérêts
potentiel à l'échelon local. Si les banques participaient
également au marché du crédit-bail, nous ne sommes
pas persuadés qu'il serait possible de régler les conflits
en question par des règlements et des limites. [. . .] Je suis gérant
de banque à Perth, en Ontario [. . .] Je suis là en train
de prendre des décisions concernant le crédit-bail du concessionnaire
d'autos installé de l'autre côté de la rue, mais je
fais moi-même de la location à bail dans une section de ma
banque. Est-il possible de résoudre ce dilemme d'une manière
fondamentale, substantielle?
Cette préoccupation se justifie dans la mesure où les
concessionnaires sont obligés de faire appel aux banques pour leur
financement. Toutefois, tous les constructeurs d'automobiles ont des sociétés
de financement captives dont les activités contribuent à
l'écoulement de leur production. À l'heure actuelle, le crédit-bail
constitue la majeure partie des activités en question, mais cela
peut changer. Ces sociétés captives accordent aussi des prêts
et, si les concessionnaires ont l'impression que les banques les traitent
injustement, ils peuvent toujours demander aux premières de financer
l'acquisition de leurs stocks. Mais, chose plus importante, si la concurrence
s'accroissait suffisamment, les concessionnaires auraient un plus grand
choix pour financer leurs stocks.
Enfin, le conflit d'intérêts décrit dans la citation
qui précède s'applique à une situation où la
succursale bancaire dispose de son propre stock de voitures. Mais les banques
disent que ce n'est pas de cette façon que le crédit-bail
serait offert. Les Canadiens ne peuvent passer outre au concessionnaire
lorsqu'ils font l'acquisition d'une nouvelle voiture. Cela est vrai, peu
importe qu'ils effectuent leur achat par le truchement d'Internet ou qu'ils
obtiennent un crédit-bail d'une coopérative de crédit.
Ce que les banques disent vouloir, c'est la possibilité d'offrir
une autre option aux concessionnaires. Au lieu de devoir faire affaire
seulement avec des sociétés de financement captives (comme
GMAC ou Crédit Ford), des donneurs à bail indépendants
comme Newcourt et GE Capital, et certaines institutions provinciales comme
les caisses populaires et les coopératives de crédit, le
concessionnaire pourrait également se prévaloir des services
des banques. Le concessionnaire serait toujours l'intermédiaire
du crédit-bail. Si les banques ne peuvent acheter de voitures directement
du manufacturier, il est possible qu'elles aient de fait un stock de voitures
d'occasion à l'expiration des baux initiaux. C'est à ce moment-là
qu'on craint qu'elles ne deviennent les concurrents directs des concessionnaires.
Mais il y a des banques qui offrent des produits qui sont des quasi-baux,
comme des prêts rachetables, qui peuvent les amener à prendre
possession des voitures à la fin du contrat. Elles préparent
la vente de ces voitures avec d'autres institutions et ne les vendent pas
elles-mêmes.
Crédit-bail et risque : Les opposants à l'entrée
des banques sur le marché du crédit-bail automobile craignent
que ces dernières ne fassent une concurrence déloyale aux
donneurs à bail actuels, mais ils jugent également que les
banques ne connaissent pas assez bien le marché. Elles ne comprennent
pas le risque résiduel de la même façon que les protagonistes
en place. Ils invoquent comme preuve l'exemple des banques américaines
qui ont perdu de l'argent dans ce secteur et se sont par la suite retirées
du marché.
Il importe que les banques comprennent les risques liés à
toutes leurs activités. Le BSIF se préoccupe lui aussi de
la situation. Mais les institutions financières évaluent
constamment des risques de toutes sortes. Lorsqu'elles s'engagent dans
le commerce des instruments dérivés, elles doivent évaluer
des risques que la plupart des simples citoyens ne pourraient comprendre.
Il est peu probable que les risques liés au crédit-bail automobile
soient à ce point incompréhensibles, surtout que les banques
offrent déjà des produits qui s'y apparentent de près
et qui supposent qu'elles comprennent la nature des risques en question.
Déduction pour amortissement : Un argument invoqué
vers la fin des audiences concerne la déduction pour amortissement
liée au crédit-bail direct. Les banques voudraient louer
à bail afin de profiter de la déduction pour amortissement
et mettre à l'abri de l'impôt leurs profits déjà
très élevés.
La déduction pour amortissement peut être utilisée
par tous les donneurs à bail et, dans la mesure où elle permet
de réduire les impôts courants, elle favorise tout le monde,
pas uniquement les banques. Toutefois, le plus important est qu'elle ne
peut s'appliquer qu'au revenu provenant du crédit-bail des biens
d'équipement sujets à la déduction. Elle ne peut mettre
d'autres sources de revenu à l'abri de l'impôt courant.
En conclusion, le Comité estime que les arguments des opposants
des pouvoirs élargis ne sont pas définitifs. Les exigences
des consommateurs évoluent, tout comme les méthodes de distribution
des produits. Ces facteurs agissent sur les fournisseurs en place dans
tous les secteurs de l'économie. Les recommandations du Groupe de
travail auront pour effet d'accélérer ces tendances, mais
elles ne constituent pas la source des pressions qui s'exerceront dans
l'avenir sur les courtiers d'assurances et les concessionnaires d'automobiles.
Le Comité croit que l'élargissement des pouvoirs des institutions
financières fédérales soulève effectivement
des préoccupations légitimes liées aux intérêts
des consommateurs. C'est pourquoi nous recommandons qu'on mette en oeuvre
rapidement un système amélioré de protection des consommateurs.
Les préoccupations concernant la concurrence sont légitimes.
C'est pourquoi nous appuyons également les recommandations du Groupe
de travail favorisant l'arrivée de nouveaux acteurs.
Le Comité est d'avis que, sous réserve des considérations
touchant la sécurité et la qualité, les différentes
institutions financières devraient pouvoir établir leurs
propres stratégies d'affaires et fournir les produits qu'elles considèrent
appropriés de la manière qu'elles jugent la plus efficace.
Elles devraient pouvoir donner suite aux changements qui se produisent
au sein de l'économie. Il s'agit de décisions de gestion.
De même, les consommateurs devraient avoir la possibilité
d'acheter leurs services financiers selon les modalités qui les
avantagent le mieux. Il s'agit là de décisions individuelles.
À condition que ces deux types de décisions soient prises
dans un marché compétitif, les consommateurs en profiteront.
Le crédit-bail de véhicules neufs représentait
35 milliards de dollars en 1997, ce marché étant détenu
dans une proportion de 70 % à 80 % par les sociétés
de financement affiliées aux grands constructeurs d'automobiles.
Le marché de la vente au détail d'automobiles évolue
rapidement et le crédit-bail devient de plus en plus populaire,
dans une large mesure à cause de la hausse du prix des voitures.
À l'heure actuelle, 46 % des nouvelles voitures sont louées
à bail, contre seulement 4 % en 1990. Pourquoi un changement des
habitudes des consommateurs devrait-il écarter les institutions
financières fédérales de ce marché, où
elles font affaire depuis longtemps en fournissant des prêts-automobiles?
Pourquoi seraient-elles tenues à l'écart, alors que certains
de leurs concurrents réglementés à l'échelon
provincial ne le sont pas? Pourquoi certaines sociétés de
financement étrangères seraient-elles protégées
ici de la concurrence des banques, alors qu'elles ne le sont pas dans leur
pays d'origine? Aux États-Unis, les banques peuvent louer à
bail des automobiles depuis les années 1960, et il semble qu'elles
aient exercé cette activité surtout aux dépens des
sociétés de financement captives. C'est également
le cas dans la plupart des autres pays. Qu'y a-t-il de si différent
au sujet de l'économie canadienne qui justifierait qu'on refuse
cette option aux consommateurs?
La situation est analogue du côté des assurances. À
l'heure actuelle, de nombreux pays permettent aux banques de vendre de
l'assurance au détail, ce qui offre aux consommateurs des choix
à moindre coût. De fait, dans les pays où les banques
peuvent proposer des produits d'assurance, le système de distribution
a une meilleure productivité qu'au Canada. Pourquoi le Canada ne
pourrait-il pas tirer parti de ce facteur et pourquoi devrait-il demeurer
l'exception à la règle internationale?
Dans une publication récente de l'Institut C.D. Howe, on mentionne
ce qui suit au sujet de l'entrée des banques sur le marché
de l'assurance en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Malgré le nombre relativement important de protagonistes qui
occupaient le marché des assurances en Australie et en Nouvelle-Zélande,
l'entrée des banques a fait augmenter de façon marquée
le niveau de concurrence. Cela s'est produit parce que les banques ont
instauré une nouvelle technologie de distribution au sein de l'industrie,
et non en raison d'un manque de concurrence auparavant.29.
. .
Cet exemple est intéressant parce qu'il répond directement
à certains des arguments invoqués par les personnes qui s'opposent
à l'élargissement des pouvoirs des banques. Que ce soit au
sujet de la vente d'assurance au détail ou du crédit-bail
automobile, celles-ci affirment souvent que le marché compte déjà
un grand nombre de participants et que, de ce fait, il bénéficie
déjà des effets avantageux de la concurrence. Pour elles,
« le mieux est l'ennemi du bien ». Le Comité estime
que les consommateurs pourraient être avantagés par de nouveaux
fournisseurs de crédit-bail automobile et de nouvelles méthodes
de distribution des produits d'assurance. Mais nous ne croyons pas que
ce soit le bon moment.
Le Comité estime que la concurrence dans le secteur des services
financiers au Canada sera accrue par les recommandations du Groupe de travail.
Il estime également que la protection des consommateurs est inadéquate.
Il recommande que le gouvernement accorde une haute priorité à
la mise en place d'un nouveau régime de protection des consommateurs,
et qu'il le fasse sans tarder. Un tel régime comprendrait notamment
les mesures suivantes :
- Une meilleure transparence des contrats et la divulgation complète
et rapide des modalités des contrats (recommandations 57 à
62);
- Des mesures élargies et prévues dans la loi assurant
aux consommateurs le contrôle de l'usage qui est fait des renseignements
les concernant personnellement, en exigeant le consentement explicite du
consommateur, qui peut être retiré par la suite (recommandations
64 à 69);
- L'interdiction plus large des ventes liées avec coercition par
une mesure législative, la mise en place d'un mécanisme de
recours et l'exigence imposée aux institutions financières
d'informer leur clientèle de ce que constitue une vente liée
avec coercition avant de conclure une transaction (recommandations 70 à
75);
- L'instauration d'un mécanisme de recours comprenant un ombudsman
indépendant pour le secteur des services financiers (recommandations
76 à 80);
- La mise sur pied d'un bureau de protection du consommateur.
Le Comité recommande que le Comité permanent des finances
de la Chambre des communes soit chargé d'évaluer le nouveau
régime de protection des consommateurs et de concurrence afin de
déterminer s'il est efficace et s'il protège mieux les consommateurs.
Cette évaluation devra se faire avant le prochain examen de la législation
fédérale sur les institutions financières et associer
les parties prenantes au processus.
Ainsi, l'interdiction qui est faite aux institutions de dépôts
sous réglementation fédérale de vendre des produits
d'assurance aux particuliers dans leurs succursales sera réexaminée
seulement une fois connus les résultats de cette évaluation.
Le Comité souhaite que la concurrence soit renforcée,
parce qu'il se préoccupe du bien-être des consommateurs. Comme
l'ont déclaré de nombreux témoins, l'objectif ultime
de la réforme financière doit être de mieux servir
le consommateur. C'est l'intérêt du consommateur qui procure
les avantages les plus intéressants aux Canadiens. Un secteur financier
qui sert les intérêts des consommateurs, qu'il s'agisse de
ménages ou d'entreprises, sert l'intérêt économique
de tous les Canadiens.
Cela dit, le Comité tient à préciser que la politique
fiscale devrait également permettre aux institutions canadiennes
de prendre des mesures en vue de devenir plus compétitives à
l'échelle internationale. Autrement dit, nous devrions privilégier
les mesures qui permettent à nos banques de devenir des institutions
de classe internationale à tous les égards. Après
tout, ce secteur emploie directement plus d'un demi-million de Canadiens,
et a un impact considérable sur l'économie. Par ailleurs,
comme nous l'avons déjà mentionné, les consommateurs
canadiens sont beaucoup plus susceptibles de tirer parti de la concurrence
si les marchés sont ouverts et les institutions financières
nationales compétitives.
À mon avis, la meilleure façon de protéger le
système bancaire canadien est de lui donner l'envergure nécessaire
et la possibilité de réaliser des économies d'échelle
de façon qu'il soit en mesure de faire face à la concurrence.
La concurrence est bel et bien là. Je ne pense pas que les fusions
se solderont par la création d'un monopole; ce sont les forces du
marché qui prévaudront. Si j'en crois ce qu'indiquent les
forces du marché, les fusions auront un effet positif, car cela
nous donnera des institutions financières de classe internationale.
Glen Calkins (propriétaire-exploitant, Restaurants
McDonald's de Saint John et de Lquispansis)
La compétitivité est un trait caractéristique d'une
institution, d'un groupe d'institutions ou d'un secteur. Les institutions
financières canadiennes, si elles veulent être en mesure de
livrer une concurrence efficace et rentable sur la scène mondiale,
doivent avoir les outils qu'il faut. Elles doivent fournir les mêmes
produits que leurs concurrents, ou de qualité supérieure.
De plus, il faut que leurs coûts, si elles souhaitent réaliser
un profit, soient comparables à ceux des autres institutions.
Les institutions financières canadiennes sont, depuis de nombreuses
années, soumises à la concurrence étrangère
sur les marchés internationaux. Elles sont confrontées au
même défi, et ce, de plus en plus, sur le marché intérieur.
Les profits des banques canadiennes se comparent très bien
à ceux des banques étrangères de plusieurs pays.
De manière générale, les institutions financières
canadiennes occupent une bonne position par rapport à leurs concurrents
internationaux. Elles ne figurent pas parmi les meilleures, mais se classent,
de manière générale, parmi les premières. De
plus, les banques et les sociétés d'assurance-vie sont plus
actives à l'échelle internationale que bon nombre de leurs
concurrents internationaux. D'après la revue The Banker,
par exemple, les banques canadiennes ont toutes des activités à
l'étranger. Elles occupent le 20e (CIBC), le 21e (Banque de Montréal),
le 27e (Banque Scotia) et le 39e (Royale) rang à l'échelle
internationale pour ce qui est de leurs avoirs étrangers. La CIBC
et la Banque de Montréal tirent respectivement 44 % et 58 % de leur
revenu des activités menées à l'étranger. Pour
la Banque Scotia, la proportion est de 49 %, et pour la Banque Royale,
de 28 %. Ainsi, la Banque de Montréal et la CIBC ont une vocation
beaucoup plus internationale que la Chase Manhattan, la Banque de Tokyo
et l'ING.
Dans son Rapport de 1997, Le Forum économique mondial accorde
au système financier canadien le cinquième rang au niveau
de la compétitivité parmi les 53 pays les plus développés.
En outre, le régime de réglementation canadien a permis
aux institutions canadiennes de devenir plus concurrentielles. En effet,
les réformes adoptées en 1992 et avant ont favorisé
l'émergence de conglomérats financiers à l'échelle
nationale, contrairement à ce qui s'est produit dans d'autres pays
comme les États-Unis.
Néanmoins, des initiatives peuvent être entreprises dans
certains domaines pour renforcer la compétitivité des institutions
financières canadiennes et faire du Canada un centre international
de services financiers.
Comme nous l'avons déjà indiqué, le Rapport du
Groupe de travail recommande que la convergence des fonctions se poursuive
dans le secteur financier. Cela permettra d'offrir de meilleurs choix aux
consommateurs et de renforcer la compétitivité des institutions,
puisqu'elles pourront mieux servir les clients et, partant, devenir plus
rentables. Comme le précise un rapport de la Banque du Canada, c'est
la rentabilité qui permet d'établir si les institutions financières
sont véritablement efficientes. En effet, ce n'est pas tellement
la taille des fournisseurs de services financiers qui compte, mais plutôt
la nature de leurs activités30.
Il est essentiel, à notre avis, que les institutions financières
canadiennes offrent aux Canadiens les services qu'ils désirent.
Cela leur permettra d'être compétitives. Le Comité
propose que le gouvernement tienne compte de ces deux facteurs au moment
d'évaluer les recommandations.
Il existe une autre façon de renforcer la compétitivité
des institutions : soit au moyen des règles qui régissent
la propriété et la structure des institutions financières.
Nous allons examiner ici les quatre principaux groupes de recommandations
qui figurent dans le Rapport du Groupe de travail, à savoir le régime
de propriété, l'assouplissement de la définition d'une
large répartition du capital, la démutualisation des grandes
sociétés d'assurance-vie et le modèle de la société
financière de portefeuille. En outre, nous allons analyser les problèmes
auxquels font face les coopératives qui souhaitent devenir une force
concurrentielle sur le marché national.
D'après le Groupe de travail, le régime de propriété
doit tenir compte des tendances actuelles et éventuelles vers une
plus grande convergence des fonctions. Il recommande que toutes les institutions
financières réglementées au niveau fédéral
soient assujetties aux mêmes règles, en fonction de leur taille.
Le régime de propriété peut présenter certains
avantages d'une part, mais entraîner certains coûts d'autre
part. Le Groupe de travail a jugé que toutes les institutions, qui,
à la longue, vont être en mesure d'offrir les mêmes
services, devraient bénéficier des mêmes avantages
et assumer les mêmes coûts sur le plan de la réglementation.
La Financière Manuvie est d'accord avec les recommandations
du Groupe de travail en ce qui concerne le maintien à perpétuité
du régime de la large répartition du capital - qu'on appelle
également la règle des 10 % - pour les grandes institutions
financières. Cette politique a bien servi notre secteur et le pays
dans son ensemble. Je suis convaincu qu'en l'absence d'une telle politique
notre secteur des services financiers ne serait jamais devenu aussi dynamique
ni concurrentiel qu'il l'est actuellement, et ne serait pas non plus contrôlé
par des intérêts canadiens, ce qui est également vrai.
Dominic D'Alessandro (président et directeur général,
Financière Manuvie)
Les recommandations 29 à 41 traitent des règles de propriété
qui devraient s'appliquer aux institutions financières réglementées
au niveau fédéral. D'après le Groupe de travail, il
ne devrait pas y avoir une série de règles pour les banques
et une autre pour les institutions non bancaires. Ces recommandations abordent
également la question du régime de propriété
qui doit s'appliquer aux sociétés d'assurance mutuelle qui
se transforment en sociétés par actions. Le tableau suivant,
qui s'inspire de données tirées du Rapport du Groupe de travail,
classe les grandes institutions financières canadiennes en fonction
de leurs avoirs; il indique aussi le rang qu'elles occuperaient relativement
aux nouveaux seuils établis.
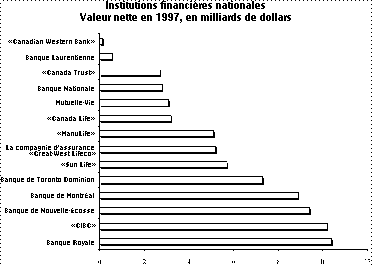
La recommandation 29 définit les trois grands principes qui sous-tendent
le régime de propriété. Ce dernier devrait favoriser
l'esprit d'entreprise et la concurrence, la solidité et la stabilité
du système financier, ainsi que le maintien du contrôle canadien.
Les recommandations 29 à 41 proposent certains changements
aux règles de propriété des institutions financières.
Ces recommandations, une fois acceptées, influeraient largement
sur les règles actuelles. Certaines banques de l'annexe 1 et les
sociétés d'assurance mutuelle se transformant en sociétés
par actions n'auraient plus besoin d'avoir un grand nombre d'actionnaires.
Les exigences en matière de propriété seraient fondées
sur la taille de l'institution. [. . .] Nous croyons, et c'est une opinion
que partagent la plupart des responsables de la réglementation,
que des institutions financières à peu d'actionnaires augmentent
l'étendue du risque et que des gains commerciaux amplifient celui-ci.
L'historique des faillites institutionnelles au Canada tend à soutenir
ce point de vue.
John Palmer (surintendant, Bureau du surintendant des institutions
financières Canada)
Pour le Groupe de travail, le fait d'obliger les grandes institutions
(celles dont l'avoir des actionnaires ne dépasse pas 5 milliards
de dollars) à avoir un capital largement réparti favorise
la solidité et la stabilité des institutions, tout en leur
permettant d'éviter les problèmes et les conflits qu'entraînent
les alliances commerciales. Cette méthode facilite aussi le maintien
du contrôle canadien sur les institutions, puisque aucune banque
étrangère ne pourrait mettre la main sur une institution
nationale par le biais d'une offre publique d'achat hostile. Par ailleurs,
en permettant aux petites institutions (celles dont l'avoir est inférieur
à un milliard de dollars) d'être contrôlées par
un seul actionnaire prépondérant, on favorise le lancement
de nouvelles institutions et l'esprit d'entreprise. À l'heure actuelle,
les entrepreneurs peuvent créer et contrôler des sociétés
de fiducie et des compagnies d'assurances. Le Groupe de travail propose
que, pour la première fois, les entrepreneurs puissent créer
et contrôler des banques nationales. Les institutions financières
dont l'avoir est supérieur à un milliard de dollars mais
inférieur à 5 milliards pourraient avoir un capital fermé,
à condition que 35 % de leurs actions avec droit de vote soient
réparties dans le public et cotées en bourse. Ces règles
correspondent plus ou moins aux règles de propriété31
qui s'appliquent actuellement aux institutions non bancaires réglementées
au palier fédéral dont l'avoir est supérieur à
750 millions de dollars.
Le Groupe de travail recommande de permettre aux nouvelles institutions
bancaires dont l'avoir des actionnaires est inférieur à 1
milliard de dollars d'avoir un capital fermé ou même d'appartenir
à une personne ou à une société, et aux institutions
dont l'avoir des actionnaires est supérieur à 1 milliard
de dollars, mais inférieur à 5 milliards de dollars, d'avoir
au moins 35 % de leurs actions participantes avec droit de vote réparties
dans le public et cotées en bourse. Cette recommandation contribuera
grandement à accroître le nombre de fournisseurs de services
financiers au Canada, et elle sera très bien reçue par les
entreprises moyennes, de même que par les plus petites.
Paul J. Lowenstein (président, Canadian Corporate
Funding Limited)
Dans les cas où un actionnaire détient un intérêt
dans plus d'une institution réglementée au palier fédéral,
c'est l'avoir combiné des institutions qui permettra de déterminer
les paramètres applicables en matière de propriété.
Le Groupe de travail propose une forme de propriété
plus élargie pour les gros établissements dont la faillite
aura des répercussions sur l'ensemble du système. Si la propriété
est largement diffusée dans le public, cela ne veut pas dire simplement
que l'on renforce la propriété canadienne, c'est une mesure
de sécurité et de protection parce que, tout bien considéré,
les établissements dont la propriété est largement
diffusée dans le public ont tendance à être plus sûrs
que les établissements à propriété restreinte.
John Palmer (surintendant, Bureau du surintendant des institutions
financières Canada)
Selon le Comité, le régime proposé offre un bon
compromis entre les règles conflictuelles actuelles et la taille
des institutions existantes. Seules la Canada Trust et la Great-West Life
Co. ne respectent pas les règles proposées, la première,
parce qu'elle n'a pas 35 % d'actions en circulation, comme l'exige le Groupe
de travail, et la deuxième, parce qu'elle constitue une entreprise
à capital fermé dont l'avoir est supérieur à
5 milliards de dollars. Le Rapport recommande que les règles de
propriété actuelles s'appliquant aux deux institutions soient
maintenues. Le contrôle des institutions pourrait changer de main
une fois, sans que cela n'influe sur les droits acquis. Toutefois, il faudrait,
lors de tout changement de contrôle subséquent, que les institutions
se conforment aux nouvelles règles de propriété.
En vertu de cette proposition, toutes les grandes banques canadiennes
doivent continuer d'avoir un capital largement réparti; la plus
petite des cinq banques, c'est-à-dire la Banque TD, disposait d'un
avoir de 7,3 milliards en octobre 1997. La Sun Life et la Manuvie, une
fois transformées en sociétés par actions, seraient
également tenues d'avoir un capital largement réparti. Toutes
les autres institutions financières canadiennes pourraient continuer
d'avoir un capital fermé et 35 % d'actions en circulation ou non.
Certaines entreprises à capital largement réparti, comme
la Canada Life et la Mutuelle du Canada, pourraient à la longue
avoir un capital fermé. La Banque Nationale, la Banque Laurentienne
et la Banque canadienne de l'Ouest auraient toutes le droit d'être
reclassées dans une autre catégorie et de devenir des institutions
à capital fermé.
Ce régime offre beaucoup de souplesse aux entrepreneurs qui veulent
créer des institutions financières ou en faire des joueurs
majeurs avant d'en céder le contrôle. Le plafond de 5 milliards
de dollars pour le capital largement réparti est un seuil qui correspond
à la moitié de l'avoir de la Banque Royale et de la CIBC,
les deux plus grandes institutions financières du Canada.
Les nouvelles règles de propriété pourraient changer
le visage du secteur financier canadien. Par exemple, les banques et les
chaînes de détail participent à divers projets en vue
de fournir aux consommateurs de nouveaux moyens d'obtenir des services
financiers. Mentionnons, par exemple, le PC Financial offert par Loblaws
et la CIBC, l'entente de marketing entre la Banque TD et Wal-Mart et la
prestation de services financiers de l'ING par l'entremise des magasins
Canadian Tire. Ces initiatives créent de nouveaux canaux de distribution,
non pas de nouvelles institutions financières.
Le nouveau régime de propriété proposé par
le Groupe de travail offre de nouvelles possibilités (p. ex., une
banque Loblaws, une banque Wal-Mart). Ces banques seraient véritablement
de nouvelles institutions, et non pas de nouveaux moyens de fournir des
services existants. Rien n'indique que les entreprises vont profiter des
changements proposés par le Groupe de travail. Toutefois, cette
possibilité ouvre la voie à l'arrivée de nouveaux
joueurs sur le marché.
Dans le cadre de ce régime, le Groupe de travail propose une
approche souple quant à la définition de propriété
élargie, laquelle, à l'heure actuelle, signifie qu'aucun
actionnaire ou groupe d'actionnaires ne peut détenir plus de 10
% d'une catégorie d'actions. D'après le Rapport, la propriété
élargie ne s'applique plus aux banques de l'annexe I, mais plutôt
à toutes les grandes institutions financières à charte
fédérale. La propriété élargie garantit
un contrôle canadien, point que le Rapport juge aussi important pour
préserver les emplois canadiens que pour servir le marché
canadien. Cependant, la propriété élargie limite également
la capacité des institutions à créer des alliances
et à faire des acquisitions. Comme le reconnaît le Groupe
de travail, le capital-action est souvent une monnaie d'échange
utilisée pour les acquisitions de sociétés. En limitant
les actions individuelles à 10 %, la valeur de cette monnaie d'échange
diminue pour les institutions canadiennes, surtout lorsqu'elles font de
très grandes acquisitions. Par conséquent, il est recommandé
de conférer au ministre des Finances le pouvoir d'autoriser des
actions quelque peu plus concentrées dans certains cas. Les regroupements
globaux visant à réaliser de plus grandes efficiences étant
devenus une réalité, le Groupe de travail a tenté
de faciliter la participation des institutions financières canadiennes
à cet égard. Le Comité approuve les propositions de
la recommandation 33.
Les participations de plus de 10 % ne sont pas autorisées pour
les investissements de portefeuille, mais doivent plutôt contribuer
à une stratégie commerciale visant à favoriser les
alliances et les acquisitions susceptibles de rehausser la compétitivité
de l'institution financière. La recommandation 33b), qui limite
à 45 % le total de la participation des actionnaires qui ont été
autorisés à détenir plus de 10 % d'une catégorie
d'actions, limite le nombre de fois où une institution financière
peut avoir recours à cette stratégie - elle pourrait avoir
3 actionnaires détenant 15 % des actions chacun ou 2 détenant
20 % des actions. Faudrait-il interdire une transaction qui sert l'intérêt
du public uniquement parce qu'une exemption à la règle des
10 % a déjà été utilisée? Le Comité
considère donc qu'il faut clarifier l'intention de toute restriction,
comme celle que l'on retrouve dans la recommandation 33b).
La troisième partie de la recommandation 33 permet au ministre
d'autoriser temporairement une participation supérieure au plafond
de 20 %, dans certains cas, même si l'actionnaire ne peut exercer
son droit de vote sur les actions en sus. Là encore, le Comité
souscrit à la recommandation en principe, mais est d'avis qu'elle
est trop vague. Le Groupe de travail envisage-t-il une participation temporaire
de 25 % ou de 35 %? Le plafond de 45 % indiqué dans la recommandation
33b) engloberait probablement cette participation excédentaire temporaire
et pourrait ainsi empêcher de futures alliances stratégiques.
Là encore, le Comité est d'avis que le gouvernement devrait
clarifier les conditions dans lesquelles une telle exemption serait accordée,
ainsi que les conséquences qu'elle aurait pour les institutions
financières. Il devrait également indiquer la période
au cours de laquelle la cession de participation doit avoir lieu. Le Comité
considère que, dans la mesure où le gouvernement accepte
la recommandation 33, il doit également fixer des paramètres
définissant clairement les limites d'un tel pouvoir discrétionnaire.
Le Comité appuie également la recommandation 32e) qui
se lit comme suit: « Une institution financière réglementée
dont le capital est largement réparti et qui est constituée
au Canada devrait pouvoir posséder jusqu'à 100 % d'une autre
institution financière réglementée, peu importe sa
taille . » Cette recommandation intéressante pourrait modifier
en profondeur le secteur financier. Elle signifie que, sous réserve
du processus d'examen des fusions bancaires, les grandes banques canadiennes
pourraient, pour la première fois, autant que l'on s'en souvienne,
faire l'objet d'une offre hostile de prise de contrôle par une autre
banque ou une autre institution financière à capital très
largement réparti. Alors qu'il apparaît très clairement
qu'une banque de l'annexe I et la Sun Life ou la Manuvie sont de taille
différente, il n'est pas inconcevable qu'elles pourraient faire
une offre de prise de contrôle de l'une des banques actuelles de
l'annexe I. La possibilité de faire une telle offre pourrait être
accentuée par la définition souple de propriété
élargie recommandée par le Groupe de travail.
Comme il est indiqué ci-dessus, le nouveau régime de propriété
que propose le Groupe de travail comprend une disposition relative aux
droits acquis, laquelle permettrait à la compagnie d'assurance-vie
Great-West et à la Canada Trust de maintenir leur structure de propriété
actuelle. Ces deux sociétés pourraient prendre de l'expansion
et faire l'acquisition d'autres institutions, sans que leur société
mère n'ait à se départir de ses actions excédentaires.
La disposition relative aux droits acquis impose toujours cependant
certaines restrictions à ces deux institutions. Bien que les deux
puissent faire l'acquisition d'autres institutions, aucune ne peut faire
l'acquisition d'une institution dont l'avoir dépasse 5 milliards
de dollars, étant donné qu'une telle institution doit être
à capital très largement réparti. Ces règles
ne les empêchent pas de faire l'acquisition de plusieurs institutions
de moindre importance. Ainsi, pour revenir au tableau précédent,
il est évident que la compagnie d'assurance-vie Great-West pourrait
acheter Canada- Vie ou la Mutuelle du Canada, voire la Banque Nationale.
Elle ne pourrait pas acheter Manuvie, à moins que son propriétaire
ne soit prêt à vendre sa participation majoritaire. Par contre,
Manuvie pourrait acheter l'Assurance-vie Great-West.
Le Canada Trust est restreint de la même manière par ces
droits acquis. Au total, ces deux sociétés gagnent plus des
réformes proposées par le Groupe de travail qu'elles ne perdent
dans le nouveau régime de propriété. Les réformes
envisagées par le Groupe de travail ouvrent de nouveaux horizons
en matière d'acquisition et de pouvoirs. La possibilité de
devenir de grandes institutions est renforcée plutôt que diminuée
par les recommandations du Groupe de travail. Le Comité appuie donc
ces dispositions relatives aux droits acquis.
Le Groupe de travail recommande l'adoption d'une politique plus souple
et plus innovatrice en ce qui concerne la propriété des institutions
financières canadiennes. On faciliterait ainsi la création
d'alliances stratégiques et on aiderait les institutions financières
à devenir plus compétitives sur le marché canadien
et à s'établir comme des institutions d'ordre mondial. De
plus, la politique permettrait aux entrepreneurs et aux entités
commerciales de se porter acquéreurs de petites institutions et
ferait en sorte que les grandes institutions n'aient pas de liens commerciaux
qui peuvent parfois nuire à la sécurité et à
l'intégrité du secteur des services financiers. Grâce
aux propositions faites par le Groupe de travail, le gouverneur en conseil
pourrait autoriser l'acquisition, par des intérêts étrangers,
de grandes institutions canadiennes dans des circonstances exceptionnelles,
si cette acquisition coïncide avec les intérêts canadiens.
La possession canadienne d'établissements mondiaux signifie
en bout de ligne le maintien de plus d'emplois au Canada. À titre
de centre financier solide, nous avons l'occasion de maintenir et de consolider
un bassin de talents mondiaux. Mais si nous sommes retenus et que les géants
du Sud arrivent à pénétrer nos marchés tout
en gardant presque tous les emplois pour eux [. . .] qu'adviendra-t-il
de nous?
Charles Baillie (président et chef de la direction,
Banque Toronto-Dominion)
Le nouveau régime est structuré de manière à
préserver le contrôle national des plus grandes institutions
financières canadiennes. En fait, presque tous les témoins
entendus durant les audiences s'entendaient sur le besoin de garder la
maîtrise de notre secteur des services financiers. En règle
générale, on faisait bon accueil à l'idée d'y
admettre des institutions étrangères, mais la plupart des
témoins estimaient crucial que l'industrie demeure essentiellement
canadienne et que les grandes institutions soient de propriété
et de contrôle canadiens.
Le Groupe de travail définit une institution financière
sous contrôle canadien comme étant « [. . .] gérée
par des institutions établies au Canada, assujettie aux exigences
canadiennes en matière de régie et non soumise à l'influence
d'un intérêt étranger dominant 32.
» Selon cette définition, l'institution à grand nombre
d'actionnaires étrangers pourrait tout de même être
sous contrôle canadien. Toutefois, il est plus facile d'exercer le
contrôle si la propriété est canadienne.
Le Comité estime que la propriété et le contrôle
canadiens nous ont bien servis par le passé et qu'ils continueront
de le faire. Le Canada n'est pas le seul à vouloir faire en sorte
que ses grandes institutions financières demeurent sous son contrôle.
De fait, la Nouvelle-Zélande est le seul pays parmi les pays industrialisés
à avoir un secteur bancaire sous contrôle étranger.
Le contrôle canadien comporte d'importants avantages. Le premier
est d'ordre réglementaire. Comme les décisions sont prises
au Canada, les instances de réglementation peuvent user de persuasion
morale pour arriver à leurs fins, ce qui ne serait pas possible
si les décisions étaient prises ailleurs. Comme le laisse
entendre le Groupe de travail, sur le plan de la réglementation,
c'est la régie des institutions qui compte. Le contrôle canadien
donne l'assurance que ce sont des Canadiens qui sont aux commandes des
institutions au Canada. En réalité, la Nouvelle-Zélande
a essentiellement renoncé à contrôler elle-même
ses institutions financières, puisque l'industrie n'est plus sous
contrôle national.
Ce n'est pas le seul avantage économique direct. Le contrôle
canadien signifie que les emplois de cadre supérieur dans ces institutions
se trouvent au Canada. D'autres emplois de qualité et très
spécialisés demeureraient aussi au Canada, ce qui créerait
un important bassin de compétences canadiennes (avocats, informaticiens,
analystes en logiciel, spécialistes du marketing, agents de prêt,
économistes, comptables, etc.). Ainsi, on compte 165 000 travailleurs
employés directement par le secteur des services financiers dans
la seule grande région de Toronto. Les banques du Canada sont d'importants
employeurs du secteur privé. En 1997, ces banques ainsi que leurs
filiales employaient directement plus de 221 400 Canadiens. Si ce n'était
du contrôle canadien, bon nombre de ces emplois seraient créés
ailleurs. Les institutions canadiennes servent leur clientèle internationale
en grande partie à partir du Canada, ce qui signifie qu'elles emploient
des Canadiens et qu'elles paient des impôts canadiens. Si nous n'exercions
pas un contrôle canadien sur notre secteur des services financiers,
l'inverse pourrait facilement être vrai. Les institutions étrangères
qui fournissent des services à des Canadiens le font à partir
de l'étranger. Elles emploient donc des non-Canadiens et paient
leurs impôts ailleurs.
Un secteur des services financiers sous contrôle canadien signifie
également que l'on est plus attentifs aux besoins des Canadiens.
On a en effet soutenu que les institutions sous contrôle étranger
se retiraient du marché canadien durant les périodes de ralentissement
économique. C'est effectivement ce qu'ont fait les banques japonaises
aux États-Unis vers la fin des années 1980.
Le contrôle canadien signifie également que ces institutions
contribuent davantage à la société canadienne et y
participent plus. Par exemple, les banques canadiennes ont donné
66 millions de dollars à des oeuvres de bienfaisance canadiennes
en 1997. Grâce à leurs dons et à leurs commandites,
elles contribuent à des programmes de soutien axés sur les
jeunes, l'éducation, la santé et l'aide sociale, les arts
et la culture ainsi que le développement économique.
Les institutions financières canadiennes dont le siège
se trouve au Canada paient des impôts au Canada. En 1996, les institutions
financières ont versé au total 8,4 milliards de dollars en
impôt fédéral, provincial et municipal.
Enfin, bien que le Canada ne fasse pas partie des grandes ligues sur
les places financières mondiales, il importe que des institutions
financières canadiennes y assurent une présence. En effet,
le Canada tire son pouvoir économique en partie de la présence
sur les marchés internationaux d'un secteur des services financiers
canadien fort, sain et fiable. Sa souveraineté est assise en partie
sur des institutions sous contrôle canadien fortes qui sont plus
susceptibles d'échapper aux effets extraterritoriaux des lois étrangères.
Le Comité estime que le contrôle des institutions financières
canadiennes devrait demeurer essentiellement au Canada. Il faudrait bien
sûr admettre au sein de notre marché des institutions étrangères.
L'essentiel, toutefois, est que nos institutions canadiennes puissent continuer
de prospérer. Le nouveau régime de propriété
que propose le Groupe de travail et qu'appuie le Comité sera plus
souple. Il ira donc dans le sens des intérêts du Canada.
La meilleure façon de continuer à avoir une industrie
sous contrôle canadien est de faire en sorte que les institutions
canadiennes soient capables de livrer concurrence et de se développer
dans un contexte de plus en plus marqué par la mondialisation. La
plus grande menace que pourrait affronter le service des secteurs financiers
sous contrôle canadien est le manque d'efficacité et une piètre
rentabilité. Les recommandations du Groupe de travail favorisent
en règle générale le maintien du contrôle canadien
puisqu'elles aident à rehausser notre compétitivité.
Le Groupe de travail MacKay indique dans son Rapport qu'à
son avis la démutualisation sera vraiment dans l'intérêt
des compagnies mutuelles et des titulaires de leurs polices, tout en étant
bénéfique pour l'évolution future du secteur des services
financiers. Nous sommes tout à fait du même avis, et notre
conseil d'administration a d'ailleurs demandé à Canada-Vie
de préparer un plan d'action pour la démutualisation, plan
que nous élaborons activement à l'heure actuelle.
David A. Nield (président et directeur général,
Canada-Vie)
Plusieurs de nos grandes compagnies d'assurance-vie fonctionnent en
vertu d'une structure de propriété unique telle que certaines
catégories de détenteurs ont des droits qui ressemblent en
quelque sorte à des droits de propriété. Cette forme
mutuelle de propriété a protégé les institutions
d'éventuelles prises de contrôle, mais a également
limité leur capacité de réunir des capitaux et, par
conséquent, de se développer, à l'interne ou au moyen
d'acquisitions. Les plus grandes compagnies mutuelles ont donc annoncé
leur décision de se transformer et de passer du statut de société
mutuelle à celui de société par actions.
À l'instar du Groupe de travail, nous appuyons les propositions
du gouvernement permettant aux grandes compagnies mutuelles d'assurance-vie
de se transformer en sociétés par actions. Nous appuyons
également les mesures de protection des détenteurs proposées
par le gouvernement et souhaitons aussi protéger ces compagnies
d'une éventuelle prise de contrôle hostile tout de suite après
leur transformation. Le Comité convient avec le Groupe de travail
que les compagnies transformées devraient avoir plus de latitude
en matière d'affiliations susceptibles de rehausser leur compétitivité.
Dans le cas de la Financière Manuvie, vu la qualité
de nos franchises et le potentiel considérable de nos diverses activités
dans le monde entier, une fois que la démutualisation sera réalisée,
nous - et, à mon avis, d'autres compagnies démutualisées
également - deviendront des cibles intéressantes d'offres
publiques d'achat. Le Groupe de travail a d'ailleurs reconnu cette réalité
et recommande, par conséquent, une période de transition
de trois ans au cours de laquelle les compagnies démutualisées
ne pourraient faire l'objet d'offres publiques d'achat (OPA) hostiles ou
de projets de fusion. Cependant, cette période de transition nous
semble trop brève. Une période de transition de cinq ans
nous semble plus réaliste pour ce qui est de permettre à
ces compagnies de devenir des sociétés ouvertes, dynamiques
et indépendantes.
Dominic D'Alessandro (président et directeur général,
Financière Manuvie)
Le projet de loi C-59 propose une transition de deux ans. Le Rapport
MacKay recommande une transition de trois ans. Nous ne voulons pas qu'elle
soit portée à cinq ans comme cela a été demandé,
car nous sommes d'accord avec la recommandation de trois ans. D'après
le Comité, la période de transition protège l'institution
nouvellement transformée de certaines situations et ne sert certainement
pas à lui passer une camisole de force, ni à l'empêcher
de se lancer dans des stratégies commerciales. Tout comme ces compagnies
ont indiqué qu'il était nécessaire d'entamer rapidement
le processus de démutualisation, nous croyons que les compagnies
nouvellement transformées devraient pouvoir se lancer rapidement
dans des stratégies commerciales qui leur permettraient de mieux
soutenir la concurrence avec les groupes financiers bancaires actuels,
ainsi qu'avec d'autres conglomérats étrangers qui se sont
formés ou sont en train de le faire. Le secteur financier évolue
rapidement et tout retard peut coûter cher. Étant donné
que deux propositions de fusion bancaire sont actuellement présentées
et que des regroupements ont lieu dans le monde entier, il est crucial
que le reste du secteur puisse prendre les mesures nécessaires permettant
l'émergence de nouveaux et solides concurrents. Par conséquent,
le Comité recommande que le ministre puisse examiner des demandes
de fusion ou d'acquisition présentées par les conseils d'administration
d'institutions transformées au cours de la période de transition.
De telles demandes ne devraient pas être examinées à
moins qu'elles n'aient été approuvées par les actionnaires.
Dans le cadre de la stratégie visant à rehausser la compétitivité,
il est proposé d'autoriser les institutions financières à
s'organiser sous l'égide d'une société financière
de portefeuille réglementée. La société mère
serait une société inactive servant uniquement à réunir
les capitaux nécessaires pour appuyer les activités des institutions
financières filiales. Elle serait assujettie à une très
légère forme de réglementation, le BSIF s'intéressant
essentiellement aux transactions entre institutions affiliées et
à celles entre la société mère et ses filiales.
Bien que le Rapport du Groupe de travail souligne que le recours au
modèle de la société de portefeuille pourrait permettre
une réglementation plus nuancée, il ne précise pas
les nuances en question. En fait, le Rapport n'examine pas beaucoup les
possibilités de réforme réglementaire que pourrait
permettre un modèle de société financière de
portefeuille. Beaucoup d'analystes ont recommandé le recours au
modèle de sociétés financières de portefeuille
afin de réglementer comme il le faut les activités qui méritent
le plus d'attention en la matière et d'alléger la réglementation
dans le cas des activités qui ne présentent pas de problèmes
prudentiels. Ce faisant, le recours à un tel modèle pourrait
rendre notre réglementation plus efficace et permettrait une plus
grande uniformité en la matière, tout en résolvant
certains des déséquilibres qui existent actuellement ou qui
pourraient surgir.
Le Comité est d'avis que le Groupe de travail aurait pu aller
plus loin et profiter des occasions présentées par le recours
au modèle de la société de portefeuille. En fait,
le Groupe de travail reconnaît que la concurrence accrue qu'il souhaite
pourrait en fait produire un déséquilibre concurrentiel entre
institutions financières nationales et étrangères.
Le modèle proposé de société financière
de portefeuille, tel que le recommande le Groupe de travail, ne résout
pas nécessairement cette question. Tout comme la concurrence ne
devrait pas être sacrifiée pour permettre aux institutions
nationales de devenir plus compétitives, la compétitivité
ne devrait pas être sacrifiée pour assurer une meilleure concurrence.
Le Comité croit fortement que concurrence et compétitivité
sont des alliées naturelles et que la politique du secteur financier
devrait le refléter.
Nous sommes heureux de constater que le Groupe de travail va dans
le sens de notre intervention en refusant d'accorder aux établissements
réglementés par le gouvernement fédéral la
possibilité de s'organiser au moyen d'une société
de portefeuille. Tout le monde sera ainsi placé sur le même
pied pour ce qui est des entreprises n'obéissant qu'à un
minimum de réglementation dans des secteurs tels que le financement
et le crédit-bail à grande échelle.
Joseph Oliver (président et directeur général,
Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières)
Le Comité a parfaitement conscience des avantages que pourrait
offrir le modèle de la société de portefeuille aux
petites institutions qui souhaitent former des alliances avec d'autres
afin de mieux soutenir la concurrence. Nous croyons qu'il faudrait donner
rapidement suite à cette recommandation.
Le gouvernement pourrait toutefois aller plus loin. Alors que nous pensons
que le modèle est prometteur et devrait être poursuivi, nous
sommes frappés par le manque général d'enthousiasme
de la part des témoins que nous avons entendus. Peu d'institutions
financières et de témoins ont manifesté beaucoup d'intérêt
en la matière. Donald Stewart, de la Sun Life, a déclaré
: « Nous croyons que la structure de la société de
portefeuille peut présenter des avantages considérables,
notamment un accroissement de l'efficacité de la réglementation,
une plus grande latitude pour se procurer des capitaux et la possibilité
d'offrir une meilleure valeur aux actionnaires de la société
de portefeuille. » Un tel enthousiasme est toutefois rarement manifesté.
Le Comité recommande donc que les institutions financières
qui profitent du modèle de la société de portefeuille
soient autorisées à constituer des filiales non réglementées,
assurant ainsi une uniformité en matière de traitement par
rapport aux actuelles sociétés de portefeuille non réglementées.
Cela assurerait également une plus grande uniformité de traitement
des institutions financières étrangères qui peuvent
percer le marché canadien autant comme institutions financières
réglementées que comme institutions non réglementées.
Le Comité recommande donc également que la réglementation
imposée aux sociétés de portefeuille soit aussi légère
que possible et que, avec le temps, les sociétés de portefeuille
non réglementées le deviennent. Ce phénomène
serait déclenché par la vente d'une institution une seconde
fois.
Les règles comptables qui s'appliquent aux institutions financières
relativement à certains types de fusions ont été critiquées
parce qu'elles compliquent la réalisation des mesures nécessaires
pour que ces institutions puissent devenir plus efficientes. Ces règles
ont un effet néfaste sur les revenus des institutions financières
et sur leur valeur au marché et, par conséquent, sur leur
capacité de se servir de leurs actions comme monnaie aux fins d'acquisitions.
Elles favorisent aussi les fusions entre égaux.
De plus, on peut constater un manque de cohésion, dans ces règles,
entre la manière dont l'actif doit être déclaré
dans les registres et celle dont le BSIF traite le même actif comme
la base de capitaux des institutions financières. Le Groupe de travail
suggère une modification des règles comptables en vigueur
au Canada afin que soit neutralisé l'effet négatif qu'elles
exercent sur la capacité des institutions canadiennes de se restructurer
(voir recommandations 42 et 43).
Le meilleur expert des problèmes concernant les règles
comptables a été Henri-Paul Rousseau, de la Banque Laurentienne.
Il a expliqué que, lorsque des institutions financières de
tailles différentes fusionnent, il y a écart d'acquisition.
Cet écart ne constitue pas, aux yeux du BSIF, une part du capital
de base. Il doit cependant être intégré aux éléments
d'actif inscrits au bilan de l'entreprise et être amorti sur une
certaine période. Cet amortissement doit être imputé
sur le revenu déclaré; les projections de profits de l'institution
sont donc plus faibles et, par voie de conséquence, sa valeur boursière
aussi. De plus, l'institution acheteuse doit démontrer au BSIF qu'elle
dispose d'un capital suffisant pour soutenir son acquisition, tandis qu'elle
impute à l'exercice une partie de l'actif qu'elle vient d'acquérir.
M. Rousseau a très bien su résumer le problème qui
se pose : « Sur le plan comptable, cet actif est reconnu, mais il
ne l'est pas sur le plan réglementaire. On crée ainsi la
première différence entre le bilan comptable et le bilan
réglementaire [. . .] [N]on seulement vous avez besoin de capitaux
supplémentaires, mais une partie des liquidités que vous
versez disparaît purement et simplement parce que l'écart
d'acquisition n'est pas reconnu comme actif. On se retrouve donc frappé
d'une double malédiction. »
Ces règles réduisent les incitatifs qui encouragent les
institutions financières canadiennes à se restructurer et
créent un déséquilibre dans la concurrence avec les
institutions américaines, lesquelles sont mieux en mesure de se
restructurer sans que soit créé un écart d'acquisition
amortissable. Bien que ce généreux traitement comptable américain
soit susceptible d'être modifié dans le futur, il sera probablement
adapté au modèle en vigueur au Royaume-Uni, où l'écart
d'acquisition est traité comme un élément d'actif,
mais n'est amorti que s'il est négatif33.
Le Comité a appris que l'Institut canadien des comptables agréés
(ICCA) a annoncé il y a quelques semaines que de nouvelles règles
comptables devraient être en place pour l'automne 1999. Il appuie
cette initiative. Il estime qu'une révision des règles comptables
non seulement augmenterait la compétitivité des institutions
financières, mais améliorerait aussi la qualité de
la concurrence. Les institutions financières désireuses de
fusionner auront plus de choix, à l'échelle nationale et
internationale, et ne seront pas obligées, comme c'est le cas maintenant,
de fusionner entre égaux.
Dans tout le Canada, les institutions financières coopératives
offrent un choix aux institutions d'entreprise à but lucratif, nombreuses
dans le secteur. L'actif des coopératives de crédit et des
caisses populaires représente 10 % de l'actif total des institutions
de dépôts au Canada. Leur vigueur varie cependant largement
d'une province à l'autre. Ainsi, au Québec et en Saskatchewan,
l'actif des coopératives représente plus de 35 % de l'actif
des institutions de dépôts, au Manitoba, il est de 25 %, alors
qu'à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, il ne
compte que pour 5 % ou moins de l'actif des institutions de dépôts.
Ces données font clairement ressortir la vigueur du mouvement
coopératif. Ses points forts et son attrait varient dans tout le
pays, cependant, en fonction des différences de culture sociale
ou d'options du marché.
Le mouvement coopératif fait néanmoins preuve d'une grande
vigueur. Il faut donc déterminer comment tirer parti de cette vigueur
et rendre ces institutions plus compétitives et, de là, stimuler
la concurrence. Ces institutions sont généralement de très
petite taille et ont souffert de ne pas pouvoir réaliser des économies
d'échelle. Seules les coopératives de crédit de la
Colombie-Britannique disposent en moyenne d'un actif de plus de 200 millions
de dollars34.
Cela est attribuable au fait que l'actif de 5 coopératives de crédit,
dont la Vancouver City Savings, qui a près de 5 milliards de dollars,
dépasse 900 millions de dollars. En Alberta, l'actif moyen se situe
à environ 50 millions de dollars, tandis que la moyenne des coopératives
du Manitoba est légèrement plus élevée. Dans
toutes les autres provinces, l'actif moyen des coopératives de crédit
et des caisses populaires se situe au-dessous de la barre des 50 millions
de dollars.
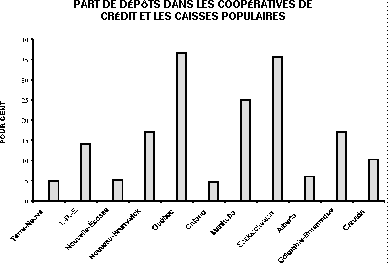
Parce que ces institutions sont des coopératives, il leur est
difficile d'obtenir un capital suffisant pour alimenter leur croissance.
Comme elles sont de petite taille, elles ne peuvent pas tirer parti des
pouvoirs qu'elles ont d'ailleurs, seulement 75 % des coopératives
de crédit offrent une gamme complète de services. Pour preuve,
les revenus d'activités facturées des coopératives
de crédit et des caisses populaires équivalent à environ
20 % des revenus nets d'intérêts. Dans les banques, par contre,
cette proportion dépasse les 50 %35,
ce qui signifie qu'elles vendent une grande quantité de services
outre le crédit direct.
Les restrictions auxquelles sont soumises les coopératives de
crédit sont augmentées de l'interdiction qui leur est faite
de fournir des services hors des frontières des provinces où
elles se situent.
Il existe deux façons de régler ces problèmes.
L'une des solutions proposées est la création d'une ou de
plusieurs banques coopératives (voir recommandation 22). Le Comité
accepte cette recommandation. Puisque les institutions coopératives
sont en fait la propriété d'un grand nombre d'actionnaires,
nous ne voyons pas de raison de refuser à ces derniers la possibilité
de posséder collectivement des banques, ce qui est compatible avec
la politique fédérale en vigueur actuellement. La Vancouver
City Savings, une coopérative de crédit, est propriétaire
de la Citizens Bank. Si une seule coopérative de crédit peut
posséder une banque, pourquoi un groupe de coopératives ne
pourrait-il pas en faire autant? De plus, les sociétés d'assurance
mutuelles sont autorisées à posséder des banques,
parce qu'elles ont un grand nombre d'actionnaires.
Enfin, nous remarquons que le nouveau régime de propriété
que propose le Groupe de travail fait place à une plus grande souplesse.
Les institutions de petite taille, c'est-à-dire celles dont les
capitaux propres ne dépassent pas 1 milliard de dollars, peuvent
être la propriété d'un seul actionnaire. Le principe
d'une banque coopérative ne serait donc pas incompatible avec ce
nouveau régime de propriété.
Lorsque les auteurs de la proposition relative à la banque coopérative
ont témoigné devant le Comité à Vancouver,
ils ont recommandé que les dépôts soient assurés
jusqu'à concurrence de 100 000 dollars. Ils ont précisé,
pour soutenir cette recommandation, que l'assurance-dépôts,
pour les membres des coopératives de crédit, varie d'une
province à l'autre et est souvent plus généreuse que
l'assurance que fournit la SADC. Certaines provinces jouissent en fait
d'une garantie illimitée. En dépit du fait que le président
de la SADC n'a soulevé aucune objection majeure à cette recommandation,
le Comité la rejette. Une banque coopérative serait dotée
de tous les pouvoirs des banques actuelles. C'est ainsi qu'il doit en être.
Une telle banque ne devrait pas jouir de privilèges particuliers
et devrait être traitée de la même manière que
les autres banques membres de la SADC.
Par contre, les coopératives de crédit ne tiennent pas
toutes à faire partie d'une banque. Il leur semble plus important
que les lois fédérales et provinciales qui régissent
les centrales de coopératives de crédit soient amendées
de manière à leur permettre d'offrir à leurs membres
de meilleurs services et de devenir plus efficientes. La Loi sur les
associations coopératives de crédit leur fait obstacle
sur ce plan. Le Comité appuie les amendements à la Loi
et recommande que le gouvernement fédéral agisse promptement.
Nous appuyons donc la recommandation 24 visant à autoriser les centrales
de coopératives de crédit à fournir des services financiers
de détail directement aux membres des coopératives de crédit
locales plutôt qu'uniquement aux coopératives de crédit,
comme c'est actuellement le cas.
Un autre facteur qui limite la capacité des centrales de mieux
servir les membres des coopératives de crédit est l'obligation
qui leur est faite de créer des sociétés de service
pour offrir des services à des tiers, et cette prestation de services
est limitée aux institutions financières actionnaires en
grande partie de la société en question. Ces services privilégiés
permettent d'importantes économies d'échelle. Une centrale
ne peut réaliser de telles économies d'échelle qu'en
offrant aux institutions qui ne sont pas des coopératives de crédit
la même qualité de service qu'aux coopératives de crédit.
Les restrictions dont il est question plus haut font obstacle à
la réalisation de telles économies d'échelle. Bill
Knight, de la Centrale des caisses de crédit du Canada, résume
très clairement le problème : « [. . .] Si les centrales
souhaitent servir d'autres entités financières ou fournir
des services financiers de détail, elles doivent le faire par l'entremise
de leurs propres sociétés affiliées. » Pour
réaliser des économies d'échelle, les centrales de
coopératives de crédit devraient pouvoir se lier à
des sociétés affiliées qui offrent des services à
d'autres institutions financières sans exiger de ces clients qu'ils
investissent d'abord dans la filiale prestataire des services. Nous appuyons
donc les changements recommandés dans le Rapport du Groupe de travail.
Nous avons déjà parlé de l'effet de la taxation
sur la compétition. Nous traiterons ici des effets qu'elle peut
avoir sur la compétitivité des institutions financières.
Selon une étude récente de Statistique Canada, le secteur
financier représentait 25 % de l'ensemble des impôts payés
par les sociétés en 1994 (comparativement à 14 % en
1988), contre seulement 12,5 % du total des recettes d'exploitation. De
1988 à 1994, la contribution du secteur financier à l'ensemble
des impôts acquittés par les sociétés a à
peu près doublé, tandis que celle des autres secteurs augmentait
de 5 %.
En 1996, le secteur des services financiers canadien a versé
plus de 8,4 milliards de dollars en impôts aux gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux. L'impôt qu'a versé le secteur financier
représente près de 20 % de l'impôt fédéral
sur les sociétés, bien que ses profits n'aient constitué
que 17 % du total des bénéfices des sociétés.
Le taux moyen d'imposition s'appli- quant aux institutions de dépôts
était de 26 % (comparativement à 6 % pour l'industrie minière,
à 12 % pour l'agriculture, la foresterie et les pêches et
à 17 % pour le secteur des communications)36.
L'impôt fédéral des grandes sociétés,
au taux de 0,225 % du capital, s'applique aux sociétés dont
le capital dépasse 10 millions de dollars, c'est-à-dire à
presque toutes les institutions financières.
Les institutions financières sous réglementation fédérale
sont assujetties à des impôts sur les sociétés
qu'elles sont les seules à payer. En effet, outre l'impôt
au taux de 0,225 % du capital qui s'applique aux grandes sociétés
dont le capital dépasse 10 millions de dollars au Canada, l'industrie
doit aussi payer des impôts fédéraux et provinciaux
sur le capital qui lui sont particuliers. L'impôt fédéral
sur le capital (l'impôt de la partie VI qui s'applique aux institutions
dont le capital dépasse 200 millions de dollars) est perçu
au taux de 1,25 % auprès des institutions de dépôts
depuis 1986 et auprès des compagnies d'assurance-vie depuis 1990.
Ces impôts ne s'appliquent pas aux institutions financières
non réglementées. Depuis 1985, s'ajoute également
une surtaxe temporaire (surtaxe sur le capital de la partie VI) qui s'applique
aux grandes institutions de dépôts et qui doit prendre fin
en 1999. Il y a aussi une surtaxe progressive qui vise les compagnies d'assurance-vie.
En 1996, les institutions financières réglementées
ont payé pour 350 millions de dollars d'impôts fédéraux
sur le capital et 522 millions de dollars d'impôts provinciaux sur
le capital.
Plus de 60 % des 872 millions de dollars perçus en impôts
sur le capital auprès des institutions financières ont été
prélevés par les provinces.
Les impôts sur le capital ont de nombreux effets pervers. Ils
sont nuisibles, étant donné qu'ils augmentent le coût
du capital et rendent les transactions plus coûteuses. C'est pourquoi
le secteur des services financiers au Canada est moins compétitif.
Les impôts sur le capital nuisent aussi à une bonne gestion
prudentielle. Les institutions financières doivent conserver du
capital pour des raisons prudentielles, mais le régime fiscal les
incite à réduire au minimum l'excédent de capital
qu'elles détiennent.
Comme l'indique le Rapport du Groupe de travail37,
une petite institution de dépôts ayant un capital de 10 millions
de dollars seulement doit s'attendre à payer 219 500 $ d'impôts
sur le capital par année, soit 2,2 % de son capital, même
si elle ne réalise pas de bénéfice. Cette situation
est particulièrement critique pour les nouvelles institutions financières
qui n'ont pas de bénéfice auquel l'impôt sur le capital
pourrait être appliqué. Dans ces circonstances, les nouvelles
institutions pourraient être obligées d'épuiser des
ressources financières, ce qui risque de les affaiblir.
Pour ce qui est de la fiscalité, le Groupe de travail MacKay
a également dit que l'impôt sur le capital n'est pas approprié.
Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, et nous insistons
à nouveau sur le fait qu'il existe un écart entre le traitement
qui nous est réservé par rapport à d'autres institutions.
Par exemple, le Mouvement des caisses Desjardins au Québec paie
très peu d'impôts sur le capital, alors que nous en payons
beaucoup. Au début de l'année, son obligation fiscale est
déjà inférieure de 100 millions de dollars à
la nôtre. C'est un beau cadeau à recevoir au 1er janvier.
Léon Courville (président, Banque des particuliers
et des entreprises, et chef des opérations, Banque Nationale du
Canada)
Les banques canadiennes auxquelles s'applique l'impôt des grandes
sociétés et les surtaxes de la partie VI sont assujetties
à un taux d'imposition beaucoup plus élevé que les
coopératives de crédit et les institutions non financières.
Le traitement fiscal n'est manifestement pas équitable dans le secteur
des prêts au Canada. Le régime fiscal rend donc les banques
moins compétitives sur le marché intérieur.
L'observation des impôts sur le capital coûte cher en raison
du manque de coordination entre les différents paliers de gouvernement.
En effet, les impôts sur le capital varient d'une administration
publique à l'autre. Le Groupe de travail soulève aussi le
problème de l'incidence de la taxation multiple - par exemple la
TPS, les taxes de vente et les taxes sur les primes - ,qui peut avoir des
incidences sur les consommateurs.
Le Comité admet que les charges fiscales imposées aux
institutions financières canadiennes nuisent à la compétitivité
des entreprises canadiennes et alourdissent les coûts subis par les
utilisateurs canadiens de services financiers. Il est urgent que le gouvernement
adopte un mode d'imposition des institutions financières qui soit
juste et acceptable et qui tienne compte de l'activité économique
réelle. Robert Astley, de La Mutuelle du Canada, a bien cerné
le problème quand il a déclaré devant le Comité
: « [. . .] Je préconiserais l'adoption d'un régime
d'impôt sur le revenu des entreprises pour remplacer l'impôt
sur le capital qui comporte des éléments dissuasifs. »
L'imposition des taxes sur le capital pénalise les institutions
dont les principes de gestion dictent des niveaux de capitaux plus élevés
afin de protéger leurs clients. Nous approuvons la recommandation
du Groupe de travail visant à éliminer la taxe spéciale
sur le capital et nous comptons sur les législateurs pour instaurer
des changements dans ce domaine.
Richard May (vice-président, Association canadienne
des sociétés fraternelles)
Les recommandations formulées par le Groupe de travail sur l'impôt
sur le capital et la taxation multiple (voir recommandation 44) devraient
être suivies dès que la situation budgétaire des gouvernements
fédéral et provinciaux le permettra. Les recommandations
44b) (ii) et (iii) n'auront pas d'effet négatif sur les recettes
des gouvernements.
Comme on l'a indiqué plus tôt, les impôts sur le
capital peuvent représenter un obstacle de taille à l'accès
des nouvelles et des petites institutions. Le Groupe de travail propose
que les nouvelles institutions financières soient exonérées
pendant 10 ans des impôts fédéraux sur le capital (voir
recommandation 5). Le Comité n'approuve pas cette recommandation,
compte tenu de ce qui vient d'être recommandé, c'est-à-dire
que les charges fiscales devraient être reportées sur les
bénéfices au lieu de peser sur le capital. Même si
cette recommandation du Groupe de travail favoriserait les nouvelles institutions
et accroîtrait probablement la compétitivité, elle
n'éliminerait aucun des effets pervers causés par les impôts
spéciaux sur le capital auxquels sont assujetties les institutions
financières. Par exemple, comme l'indiquait Gerald Soloway, de l'Association
des compagnies de fiducie du Canada : « [L]'impôt sur le capital
constitue un obstacle important à l'entrée d'institutions
de plus petite envergure. Mais pourquoi faudrait-il limiter l'exonération
de 10 ans d'impôt sur le capital aux nouvelles institutions? Nous
pensons que les membres actuels et les nouveaux membres du secteur devraient
bénéficier de ce genre de soutien. Nous estimons que le gouvernement
devrait aller plus loin et qu'il devrait éliminer l'impôt
sur le capital pour les plus petites institutions, tant nouvelles qu'existantes.
»
Qui plus est, si elle est définie de façon générale,
cette trêve fiscale pourrait profiter aux institutions financières
étrangères (y compris les grandes institutions de dépôts),
rendant encore plus désavantageuses les règles du jeu sur
le marché intérieur.
Enfin, il reste à voir quelle serait la définition de
« nouvelle » institution financière. Désignerait-elle
seulement les institutions sous contrôle canadien, ou désignerait-elle
aussi les filiales dans lesquelles une institution financière ne
détient que peu d'intérêts? Les recommandations 44b)
(ii) et (iii) offrent une solution immédiate, sans rendre encore
plus désavantageuses les règles du jeu. À long terme,
il faudrait accorder la priorité aux recommandations 44a) et 44b)
(i), qui traitent de la neutralité du régime fiscal et de
l'élimination des impôts spéciaux sur le capital des
institutions financières.
CHAPITRE 4 : REGROUPEMENTS DANS LE SECTEUR FINANCIER ET PROCESSUS D'EXAMEN DES FUSIONS
Les institutions financières du monde entier regroupent leurs
activités et se repositionnent face au nouvel environnement du marché.
En plus de fusionner avec d'autres institutions financières de leur
pays, elles visent de plus en plus des institutions d'autres parties du
monde. Nous traversons, comme l'affirmait Grant Reuber, de la SADC, «
[...] une ère de turbulence dans le secteur des services financiers
du monde entier ». Cette nouvelle ambiance dynamique est caractérisée
par l'arrivée de méga-institutions financières de
portée mondiale.
La vague de fusions et d'acquisitions qui déferle sur l'Europe,
l'Amérique du Nord et l'Asie transforme le visage du secteur bancaire
international. L'industrie des services financiers, qui est, dans le monde
entier, le théâtre de 4 000 fusions et acquisitions par an,
subit un mouvement de regroupement mondial qui s'accélère38.
En Europe, bon nombre de grandes fusions et acquisitions ont été
annoncées depuis 1997 : Unicredito/Credit Italiano (avril 1998),
Générale de Banque/Fortis (mai 1998), UBS/SBS (décembre
1997), ING/BBL (novembre 1997), Crédit Suisse/ Winterthur (août
1997) et Vereinsbank/Hypobank (juillet 1997).
Bien des forces poussent les banques européennes à se
regrouper39
: la surcapacité sectorielle, la concurrence accrue de puissantes
banques américaines, la perte de la protection nationale, la déréglementation,
la faible croissance des bénéfices dans bien des secteurs
bancaires et les revendications croissantes de meilleurs rendements de
la part des actionnaires. L'imminence de l'Union monétaire européenne
intensifie la pression.
Pour les banquiers européens, la taille fait une différence.
Selon eux, les banques européennes doivent grossir pour étaler
les coûts croissants de la technologie de l'information et du traitement
des données sur une plus grande assiette de revenu. La nécessité
d'accroître la valeur boursière est un autre facteur-clé
derrière bien des fusions bancaires en Europe. Les gouvernements
européens et leurs organismes de réglementation semblent
s'être rangés du côté de ceux qui jugent crucial
de grossir pour réduire les coûts et créer des banques
solides.
En Europe, les gouvernements de pays plus petits, comme la Hollande
et la Belgique, ont encouragé leurs banques à fusionner pour
améliorer leur efficacité et assurer le maintien d'un secteur
bancaire vigoureux qui puisse soutenir la concurrence accrue d'institutions
financières de bien plus grande envergure dans les pays voisins.
Al Flood (président et directeur général,
Banque CIBC)
Aux États-Unis, les choses vont aussi très vite. Trois
grandes fusions ont été annoncées en l'espace de trois
joursen avril 1998 : le mariage transcontinental de NationsBank/ BankAmerica,
l'intégration au coeur du pays de First Chicago NBD/BancOne et l'acquisition
de Citicorp par Travelers Group. Wells Fargo a annoncé, depuis lors,
la conclusion d'un pacte avec Norwest. Pour dresser une liste partielle
des fusions gigantesques qui se sont produites aux États-Unis depuis
18 mois, il faudrait ajouter les fusions annoncées par National
City/First of America, Salomon/Travelers et NationsBank/Barnett Bank ainsi
que toutes les fusions de banques américaines avec des maisons de
courtage (BankAmerica/Robertson Stephens, NationsBank/Montgomery Securities
et Bankers Trust/Alex Brown, entre autres).
Pour indiquer l'ampleur des regroupements, il suffit de mentionner
que, entre 1980 et 1997, le nombre total d'organismes bancaires est passé
de 12 333 à7 122 aux États-Unis. Ce phénomène
s'est accompagné d'une concentration croissante du marché,
illustrée par le fait que la proportion de l'ensemble des dépôts
détenue par les 25 plus grandes institutions est passée pendant
cette période de 29 % à 47 %.
Bien des raisons peuvent servir à expliquer cette tendance aux
États-Unis, par exemple, la conviction que la taille est un facteur
important pour pouvoir concurrencer dans le monde bancaire, la pression
des dépenses croissantes en technologie de l'information, les économies
d'échelle dans des domaines comme la gestion d'actifs et la garde
mondiale de titre, le désir de réduire les coûts sur
le marché interne par l'amalgamation de structures qui se chevauchent
et les avantages qu'il y a à regrouper sous un même toit les
activités bancaires avec d'autres services financiers. Une autre
force, propre aux États-Unis, à savoir la levée de
l'interdiction de longue date des services bancaires nationaux, est aussi
intervenue.
La valeur totale des fusions relatives aux banques en 1997 a atteint
73,5 milliards de dollars américains, à peu près le
double du chiffre enregistré en 1996, et ce, bien que le nombre
de regroupements soit tombé de 357 à 304 d'une année
à l'autre. Cela s'explique par les primes d'acquisition sans précédent
qui ont été payées en 1997.
À mesure que la clientèle commerciale des banques, et
ses besoins financiers, se mondialisent et que l'innovation technologique
progresse, la pression à fusionner s'intensifie. En plus de tenter
de se réorienter par des fusions intersectorielles et sur les marchés
internes, les institutions financières cherchent de plus en plus
à franchir les frontières nationales. Elles considèrent
depuis des années les institutions financières étrangères
comme des cibles éventuelles. La banque hollandaise ABN Amro, par
exemple, possède la LaSalle National Bank de Troy (New York), Merrill
Lynch a récemment fait l'acquisition de Midland Walwyn et la Banque
de Montréal a acheté la Harris Bank de Chicago il y a quelques
années. Cette tendance ne disparaîtra pas de sitôt.
Beaucoup d'institutions financières des États-Unis constituent
des cibles de prise de contrôle de premier ordre; c'est ainsi que
l'UBS de Suisse lorgne J.P. Morgan, que le Groupe ING des Pays-Bas s'intéresse
à Lehman Brothers et que la Banque Dresdner d'Allemagne aurait apparemment
jeté son dévolu sur Paine Webber.
Au dernier trimestre, la NationsBank s'est engagée dans deux
prêts de presque 4 milliards de dollars chacun. Pour notre taille,
nous ne pourrions engager qu'environ la moitié de ce montant, et
pour un seul prêt. Le fait est que plus nos clients fusionnent, plus
ils voudront des prêts considérables. Les banques plus importantes
sont mieux placées pour leur procurer ces prêts.
A. Charles Baillie (président et chef de la direction,
Banque Toronto-Dominion)
Au moment de rédiger ces lignes, la plus grande banque allemande,
la Deutsche Bank, est sur le point de prendre le contrôle de la Bankers
Trust, qui vient au huitième rang des sociétés de
portefeuille bancaire aux États-Unis. La transaction est évaluée
à 9,7 milliards de dollars US. Des rumeurs portent à croire
pendant ce temps en Europe que la compagnie d'assurances française
Axa et la banque Chase Manhattan des États-Unis convoitent la deuxième
banque en importance de la Grande-Bretagne, Barclays PLC. G.E. Capital
Services est en négociation pour acheter la Long-Term Credit Bank
of Japan Ltd., alors que Swiss Re, qui se situe au deuxième rang
mondial des compagnies de réassurance-vie et de santé, vient
d'acquérir Life Re Corp. des États-Unis pour environ 1,8
milliard de dollars US.
D'après un rapport de mars 1998 rédigé par deux
économistes de la Banque du Canada, la rentabilité, plutôt
que la taille, est la plus importante clé du succès des banques.
Selon la revue Fortune, 3 de nos 5 grandes banques-la Banque Royale, la
CIBC et la Banque de Montréal-se classent parmi les15 banques les
plus profitables du monde et elles sont plus rentables que 5 des 10 plus
grandes banques du monde.
Leo Broderick (membre du conseil d'administration, Conseil
des Canadiens)
Selon un rapport récent de la Banque du Canada : « Plusieurs
grandes institutions financières se transforment en gros conglomérats
financiers par des fusions, des acquisitions et des alliances stratégiques,
au lieu de demeurer des institutions relativement spécialisées.
Certaines très grandes institutions tenteront de devenir des conglomérats
financiers mondiaux qui offrent des services de tout genre à tous
les types de clients dans tous les grands centres financiers ou presque.
Il n'y a cependant de la place que pour 5 ou 10 grandes maisons de ce genre
dans le monde. Les autres devront probablement se spécialiser dans
certains domaines40.»
Personne ne sait avec certitude où ces regroupements mèneront
le secteur des services financiers mondial.
Toutes ces fusions, récentes et passées, ont placé
les autorités gouvernementales d'autres pays devant le même
dilemme que de grandes fusions susciteraient au Canada. Comment concilier
le désir de créer, en les regroupant, des institutions nationales
fortes et efficaces avec celui de protéger le consommateur et de
maintenir la concurrence? La politique gouvernementale a évolué
dans bien des pays où les autorités ont fini par se réconcilier
à l'idée des fusions, même entre de très grandes
entreprises. La Suisse et les Pays-Bas sont des exemples notables de pays
dont les gouvernements ont autorisé des fusions afin de créer
de très grandes institutions financières internationales.
En Australie, l'enquête sur le système financier a rejeté
l'idée d'interdire les fusions entre grandes institutions (l'équivalent
australien d'« interdire aux gros d'avaler leurs semblables »).
Le gouvernement a toutefois affirmé que les fusions ne seraient
pas autorisées tant qu'il n'y aura pas plus de concurrence sur le
marché interne.
Malgré les différences d'attitude de ces trois pays envers
les fusions, leurs coefficients de concentration bancaire ne diffèrent
pas tellement, et ne diffèrent guère du nôtre. La récente
fièvre de fusions n'est donc pas le facteur déterminant des
regroupements bancaires. En réalité, lorsque nous constatons
des degrés de concentration bien supérieurs à la norme
canadienne, ce sont généralement des facteurs autres que
les fusions qui priment. Les États-Unis, où les coefficients
de concentration nationale sont faibles simplement parce que la création
de banques nationales a longtemps été interdite, en sont
un exemple parfait.
Le Canada ne saurait s'isoler des répercussions de la tendance
mondiale aux fusions, ni des pressions à se regrouper que les institutions
financières subissent. Il est vital, au contraire, que les organismes
de réglementation créent un cadre de politiques qui laisse
l'industrie des services financiers libre de prendre les meilleures décisions
commerciales possible et de tirer parti des meilleures occasions commerciales
qui se présentent, qui sont conformes à l'intérêt
public. Selon le président et directeur général de
Canada Trust, Edmund Clark, le secteur des services financiers canadien
fera bientôt face à un nouveau grand mouvement de fusion.
Selon lui, « [...] une nouvelle vague de regroupements est inévitable
au Canada, il en va de l'intérêt public d'avoir de solides
institutions canadiennes».
Le secteur des banques et celui des sociétés d'assurance-vie
au Canada se caractérisent tous deux par une forte concentration
sur le plan des parts de marché, du capital employé et de
la rentabilité. Les 5 plus grandes banques représentent plus
de 85 % des bénéfices du secteur bancaire; grâce aux
fusions intervenues récemment dans le secteur de l'assurance-vie,
la proportion des bénéfices des 5 plus grandes sociétés
de cette industrie se rapprochera sans doute de ce pourcentage.
Le secteur canadien des services financiers a connu passablement de
fusions dans le passé. Il suffit de regarder les sociétés
de fiducie, les maisons de courtage et les compagnies d'assurance-vie du
Canada pour constater l'ampleur de cette tendance. Il y a eu plus de 350
fusions et acquisitions dans le secteur depuis 10 ans. La nouveauté
des deux projets de fusion vient de leur ampleur41.
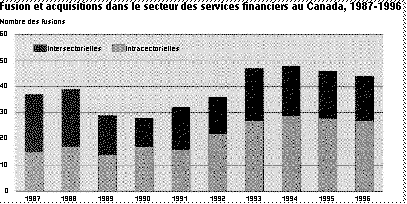
Source: The Conference Board of Canada, The Canadian Financial Services
Industry: The Year in Review, 1997 Edition.
La tâche du Comité était claire lorsqu'il a entrepris
son étude. Il avait pour mandat non pas d'examiner les deux projets
de fusion bancaire comme tels, mais de se pencher sur les recommandations
formulées dans le Rapport du Groupe de travail MacKay. Beaucoup
de témoins ont toutefois tenté de convaincre le Comité
d'entériner ou de rejeter les projets de fusion. La question des
fusions aurait pu fausser le processus de consultation et d'importantes
recommandations auraient été laissées de côté
si le Comité avait succombé aux pressions exercées
sur lui pour l'amener à s'intéresser aux projets de fusion.
J'ajouterai d'entrée de jeu que nous sommes partisans des
fusions de banques parce que nous avons foi dans la liberté des
marchés et nous croyons que sur les marchés financiers mondiaux
d'aujourd'hui la taille d'une entreprise est importante. À bien
des égards, nous préférerions que ce ne soit pas le
cas, mais nous n'y pouvons rien.
David Banks (président, Newcourt Credit Group)
Les partisans des fusions ont évoqué les économies
d'échelle (surtout sur le plan technologique), les économies
de gamme, les réductions de coût par l'élimination
des réseaux qui font double emploi, l'augmentation des bénéfices
tirés d'une gamme de produits élargie, la nécessité
d'accroître les capitaux, les répercussions de la concurrence
accrue des banques étrangères à produit unique, l'aptitude
à concurrencer sur les marchés mondiaux, la croissance de
concurrents internationaux plus forts et l'éventualité d'une
baisse des prix et d'une amélioration du service au consommateur.
Le Canada peut autoriser la fusion proposée et ainsi donner
aux banques et aux autres institutions financières la capacité
d'atteindre la taille et la productivité dont elles ont besoin pour
se développer, pour faire concurrence et pour financer le système
bancaire à service complet, à accès multiples et d'envergure
nationale que les Canadiens ont toujours connu.
Matthew W. Barrett (président et chef de la direction,
Banque de Montréal)
Les adversaires des fusions ont fait ressortir, de leur côté,
la diminution de la concurrence (qui se traduit par une réduction
des services, des choix limités, des frais de service plus élevés,
moins de prêts aux PME, une incidence négative sur les petites
localités et des fermetures imminentes de succursales), des pertes
d'emploi et une concentration plus grande du pouvoir économique.
[L]es fusions bancaires élimineront des emplois au sein de
nos collectivités. Si ces fusions vont de l'avant, les banques ont
déjà refusé catégoriquement de protéger
les emplois. Ce qui arrive aux États-Unis lorsque des banques fusionnent
est éloquent. En effet, quand des banques fusionnent aux États-Unis,
comme cela s'est produit tout récemment, jusqu'à 30 % des
employés sont licenciés. Cela signifie qu'au Canada des dizaines
de milliers de Canadiens-d'après l'industrie, jusqu'à 30
000 en fait-pourraient perdre leur emploi.
Leo Broderick (membre du conseil d'administration, Conseil
des Canadiens)
Bien que le Comité ait résisté aux pressions exercées
pour l'amener à traiter des projets de fusion, les enjeux soulevés
par les témoins sont cependant ceux sur lesquels il faudra se pencher
dans tout examen de projets de fusion à l'avenir.
Il est difficile de savoir quel sera l'effet exact de la fusion des
banques sur les collectivités rurales. Aux États-Unis, ces
fusions ont souvent entraîné une réduction des prêts
consentis aux entreprises locales.
Carol Rock (directrice générale, Women and
Rural Economic Developing)
La présence d'une corrélation positive entre la taille
et l'efficience est loin d'être démontrée. Il se peut
que de grandes institutions financières à produits multiples
ne soient pas aussi novatrices, souples et sensibles aux besoins que de
petites institutions offrant une gamme de produits ou de grandes maisons
à produit unique. Comme le font valoir les auteurs d'un rapport
technique publié par la Banque du Canada : « [...] la question
fondamentale n'est peut-être pas tant la taille des fournisseurs
de services financiers, mais plutôt la nature des activités
dans lesquelles ils s'engagent 42.»
La plupart des recherches effectuées à ce sujet
concluent que les économies d'échelle et de gamme sont limitées
pour les grandes institutions financières. [...] pour une grande
banque multiproduits de type classique, les gains d'efficience qu'on peut
attendre d'une croissance sur le plan de la taille sont limités.[...]
Elles concluaient que les économies de gamme n'étaient pas
importantes non plus; en fait, dans certains cas, le passage à de
nouveaux produits s'accompagnait d'une hausse des coûts.
Les données sur les économies d'échelle portent
à croire que les gains en efficience découlant de la taille
cessent généralement à des niveaux d'actifs inférieurs
à ceux des grandes banques canadiennes, mais que le regroupement
peut clairement permettre à de petites institutions comme les coopératives
de crédit d'en réaliser encore. Mais l'argument selon lequel
les grandes institutions ne sauraient réaliser des gains en efficience
par des fusions n'est pas concluant. Comme le Groupe de travail l'a fait
valoir, « [...] il se peut toutefois que la dynamique actuelle modifie
les relations entre la taille, les coûts et la rentabilité
43.»
Les ouvrages économiques selon lesquels il n'y a pas d'économies
d'échelle se fondent peut-être sur des données qui
ne tiennent pas compte de facteurs qui sont pertinents aujourd'hui et le
resteront à l'avenir. Comme l'a affirmé le gouverneur de
la Banque du Canada devant le Comité : « [...] les données
à ce sujet ne permettent pas d'arriver à une conclusion ferme[...]
Il y a effectivement des économies d'échelle jusqu'à
un certain point, mais au-delà nous ne sommes pas très sûrs.
Il est aussi vrai que bien des changements technologiques, surtout les
principaux, sont assez récents, et que l'analyse repose souvent
sur des données moins récentes. Sans vouloir être trop
catégorique, on ne saurait pencher de l'autre côté
et affirmer que les mégabanques permettraient des économies
d'échelle 44.»
L'un des rapports de recherche produits pour le Groupe de travail abonde
dans ce sens. Selon Donald McFetridge, « le point de vue très
répandu et bien documenté à savoir qu'il n'existe
pas d'économies d'échelle importantes dans le secteur bancaire
provient des États-Unis et découle d'une période au
cours de laquelle la technologie bancaire (tant au chapitre des produits
que des procédés) changeait moins rapidement et les banques
américaines étaient limitées au chapitre des formes
d'expansion et des services ou produits financiers supplémentaires
qu'elles pouvaient offrir45
».
Dans une étude effectuée pour le Groupe de travail,
un échantillon de 125 banques américaines ne permettait pas
d'établir une relation claire entre l'efficience et la taille. Il
ne semblait pas exister non plus de corrélation entre la taille
et l'efficience des 6 grandes banques canadiennes.
Les données sur les répercussions des fusions ne sont
pas concluantes. Le Comité est d'avis qu'il ne faudrait pas se restreindre
à examiner l'état actuel du secteur et ce que les consommateurs
réclament maintenant. Il ne faut pas trop se fier aux données
passées. Même la meilleure analyse universitaire ne saurait
saisir l'intuition de participants au marché dont les décisions
exigent à la fois une vision de l'avenir et la compréhension
des défis et des occasions qu'offrent les forces du marché.
Le défi pour le secteur financier réside dans le fait
que notre productivité, c'est-à-dire le rapport entre nos
frais autres que d'intérêts et nos revenus, est invariablement
inférieure à celle des institutions financières américaines
et internationales qui se démarquent. Et, comme le souligne le Rapport
MacKay, cet écart a eu tendance à s'élargir au cours
des dernières années. Pourquoi? Parce qu'il devient toujours
plus difficile pour notre secteur de financer les investissements massifs
nécessaires dans les nouvelles technologies, problème aggravé
par les coûts élevés que nous assumons pour maintenir
notre réseau de succursales traditionnelles tout en offrant de nouvelles
voies d'accès.
Matthew W. Barrett (président et chef de la direction,
Banque de Montréal)
Les fusions doivent être jugées par rapport aux attentes
de demain. Le monde est un marché en perpétuelle évolution
où ce qui est parfois perçu aujourd'hui comme étant
contraire au bien public et aux intérêts du secteur des services
financiers pourrait bien être essentiel au succès de demain;
ce qui veut dire que tout comme le secteur financier, l'économie
et la société évoluent, la notion d'intérêt
public évoluera également. Les changements technologiques
rapides, la concurrence et les relations unissant les fournisseurs aux
consommateurs font qu'il est essentiel que la notion d'intérêt
public prenne la plus longue perspective de long terme possible.
Premièrement, les fusions ne sont pas nécessaires puisque
les études montrent clairement que les grandes banques du Canada
ont déjà atteint la taille nécessaire pour réaliser
les économies d'échelle qui seraient utiles au secteur bancaire.
Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de cela. Les fusions
ne sont pas utiles parce que, encore une fois, la preuve empirique n'appuie
pas la prétention que les fusions augmenteront l'efficacité
et réduiront les coûts pour les consommateurs ni que les fusions
amélioreront l'accès au service.
Peter Bleyer (directeur principal, Conseil des Canadiens)
Les fusions et les acquisitions ne sont pas des transactions commerciales
ordinaires et le secteur des services financiers n'est pas une branche
d'activité ordinaire. Les fusions de grandes institutions financières
pourraient avoir de profondes conséquences économiques. Elles
peuvent influer globalement sur la solidité et la fiabilité
du secteur financier canadien ainsi que sur l'accès de certains
segments de l'économie aux capitaux. Les regroupements peuvent aussi
bien se traduire par de nouveaux débouchés pour certains
entrepreneurs comme ils peuvent en éliminer pour d'autres. À
la longue, ils peuvent produire des institutions financières mieux
positionnées, aptes à concurrencer dans le monde entier et
donc à créer des emplois au Canada. D'un autre côté,
ils peuvent aussi réduire la concurrence sur le marché interne.
D'où l'importance d'établir un processus d'examen pour évaluer
les répercussions éventuelles du regroupement sur notre mieux-être
économique.
[Une] voie consiste à rejeter les fusions, donc à interdire
aux grandes institutions de s'acheter entre elles, ce qui revient à
dire que nos institutions sont assez grosses pour le Canada, et à
s'opposer à une concurrence efficace dans les marchés mondiaux.
Les parts de marché national des institutions financières
canadiennes s'affaibliraient, devant laisser de la place à des concurrents
étrangers beaucoup plus imposants. Ce choix est valable si votre
vision du Canada fait fi de l'excellence.
A. Charles Baillie (président et chef de la direction,
Banque Toronto-Dominion)
Le Groupe de travail reconnaît dans son Rapport que les regroupements
constituent une stratégie commerciale légitime. Il a d'ailleurs
recommandé que les fusions et les acquisitions ne soient pas rejetées
automatiquement. Certaines des mesures qu'il propose sont même destinées
à promouvoir et à faciliter l'amalgamation des institutions
financières.
La recommandation 45 va à l'encontre de la politique implicite
qui interdit aux grandes institutions de fusionner entre elles depuis 1990.
Le Comité convient qu'une politique qui bloque automatiquement les
fusions entre grandes institutions financières n'a pas de raison
d'être. Toute décision en matière d'amalgamation ou
d'acquisition devrait d'abord être perçue comme une décision
commerciale légitime. Nous avons parlé plus haut des signes
de l'évolution rapide du secteur. Les fournisseurs de services financiers
devront absolument s'adapter et les institutions sont mieux placées
pour décider comment procéder. Il n'appartient pas aux autorités
gouvernementales d'intervenir dans la microgestion des institutions financières.
Il leur appartient cependant de protéger en priorité l'intérêt
public, et la meilleure façon de le faire est par une analyse vigoureuse
et objective.
Si le gouvernement craint une concentration excessive à la
suite des fusions, il devrait chercher une solution structurelle (par exemple,
les dessaisissements) au lieu d'essayer de réglementer les prix
et les autres conditions dans lesquelles nous exerçons nos activités,
et, ce faisant, imposer des coûts à l'ensemble des établissements
concurrents. [...] Plus on imposera de conditions dans le cadre du processus
d'approbation de la fusion, notamment une réduction des prix, plus
les nouveaux partenaires seront incités à se dessaisir de
certains éléments d'actif, rendant ainsi les règles
du jeu plus équitables.
Edmund Clark (président, Canada Trust)
Le rôle du gouvernement devrait consister à examiner les
aspects des politiques gouvernementales qui touchent les fusions et à
s'assurer que celles-ci sont dans l'intérêt du public, et
non pas d'appliquer dans chaque cas des politiques qui préjugent
des fusions et des acquisitions. La politique d'interdire aux grandes institutions
d'en acquérir d'autres peut aboutir à des choix de politique
gouvernementale mal avisés. Le Comité appuie donc fortement
la recommandation 45.
Le Rapport du Groupe de travail recommande (voir recommandations 46
à 52) un processus échelonné d'approbation des grandes
fusions dont feraient partie des enquêtes du Bureau de la concurrence
et du Bureau du surintendant des institutions financières.
Nous pressons le gouvernement de faire preuve d'une diligence accrue.
Comme l'a fait remarquer à juste titre le Groupe de travail MacKay,
il est impossible de faire marche arrière une fois une fusion de
banques approuvée. Il est important, comme l'a recommandé
le Groupe de travail, que le ministre des Finances réclame à
chacune des parties une étude de l'impact de la fusion envisagée
sur l'intérêt public. Le CRBSC est en faveur de cette recommandation.
Stephen Johns (président, Canadian Retail Building
Supply Council)
Il incombe au Bureau de la concurrence d'examiner, aux termes de la
Loi sur la concurrence, les répercussions qu'aurait sur la
concurrence une fusion ou une acquisition. Cet organisme pourrait ensuite
suggérer des façons d'apaiser toute inquiétude que
le gouvernement pourrait avoir. Le Comité croit que cette étape
du processus devrait se faire en concertation et permettre aux entités
visées de répliquer aux inquiétudes du Bureau.
Le Bureau du surintendant des institutions financières évaluera
également les projets de fusion notables, pour ensuite faire rapport
au ministre des Finances de toute conséquence qui pourrait en découler
sur le plan de la réglementation prudentielle. La fiabilité
et la solidité de notre système financier sont primordiales,
et il faudrait autoriser seulement les projets qui répondent à
ces critères. Le BSIF devrait chercher à déterminer,
entre autres, si la théorie selon laquelle les grandes institutions
ne sauraient faire faillite pose de graves problèmes de risque moral.
Tout comme le Bureau de la concurrence, nous croyons que le BSIF devrait
avoir la possibilité de suggérer des mesures correctives
pour apaiser ses inquiétudes et permettre aux entités en
cause d'y réagir en temps opportun. Ces deux étapes du processus
d'examen sont, pour le Comité, des éléments cruciaux
qui guideront le ministre des Finances. Les éléments les
plus importants pour déterminer si l'intérêt public
est sauvegardé sont la concurrence, la fiabilité et la solidité.
Si les fusions et les acquisitions n'inspirent pas d'inquiétudes
sur le plan de la concurrence ou de la fiabilité, il faudrait les
autoriser à moins de démontrer qu'elles sont contraires au
bien public. Le Groupe de travail recommande une nouvelle étape
du processus d'approbation : l'examen de l'intérêt public.
Cette troisième composante porterait sur de grandes considérations
d'intérêt public. Dans le cadre de ce processus public, on
demanderait aux entités en cause de produire une évaluation
de l'impact sur l'intérêt public. Le ministre des Finances
déciderait alors, en se fondant sur les éléments recueillis
et analysés, et après avoir donné aux intéressés
l'occasion de se faire entendre, s'il y a lieu ou non d'autoriser ou de
rejeter un projet.
Dans un tel processus, le ministre n'approuverait un projet de fusion
que s'il estime que cela ne portera pas préjudice à la concurrence
sur les marchés financiers, ni ne nuira à la fiabilité
et à la solidité, et que la transaction est dans l'intérêt
du public. Le Groupe de travail envisage de donner au ministre l'autorité
législative nécessaire pour obtenir des parties à
la transaction des engagements exécutoires, dont le pouvoir d'imposer
des sanctions si ces engagements ne sont pas respectés (voir recommandation
52).
Dans le cadre de l'évaluation de l'incidence sur l'intérêt
public, le Groupe de travail recommande que le ministre des Finances se
fonde sur une courte liste de critères pour évaluer les coûts
et les avantages qui en découlent pour la population canadienne
et le secteur. Les parties à la transaction devraient reprendre
ces critères dans leur évaluation de l'incidence sur l'intérêt
public. Le Groupe de travail recommande, entre autres critères,
les coûts et les avantages qui en découlent pour les consommateurs
et les PME, les répercussions régionales, la compétitivité
internationale, l'incidence sur l'emploi, l'adoption de technologies innovatrices,
l'établissement d'un précédent et toute autre considération
d'intérêt public que le ministre des Finances peut juger nécessaire.
Le Comité recommande un changement aux critères recommandés
par le Groupe de travail. Selon lui, l'examen des répercussions
sur l'emploi devrait englober l'impact à long comme à court
terme. D'autre part, il faudrait jauger ces répercussions par rapport
non seulement aux effets directs sur les institutions visées, mais
aussi aux effets indirects que la fusion pourrait produire ailleurs dans
l'économie. Il est manifestement dans l'intérêt du
public de considérer les répercussions d'une transaction
sur l'emploi au Canada. Mais est-il dans son intérêt d'exiger
que les institutions fusionnées maintiennent le même niveau
d'emploi qu'auparavant? Qu'en est-il si l'on constate déjà
une tendance à un niveau d'emploi à la baisse? Si l'on prévoit
que cela favorisera la croissance et l'innovation dans l'économie,
et se traduira par plus d'emplois mieux rémunérés
pour les Canadiens tant au pays qu'à l'étranger, faudrait-il
l'interdire parce qu'une certaine restructuration a eu lieu? Et le processus
d'examen devrait-il accorder plus d'importance aux répercussions
à court terme qu'à celles à long terme?
Le Comité estime qu'une telle attitude serait une erreur grave.
Ce ne serait d'ailleurs pas compatible avec toute l'idée de la concurrence
à laquelle le Groupe de travail et le gouvernement souscrivent.
La concurrence entraîne toujours certains ajustements, alors que
les ressources passent des secteurs qui ne répondent pas aux attentes
du consommateur, à ceux qui s'y emploient. Le passage, au Canada,
d'une économie fondée sur l'exploitation des richesses naturelles
à une économie fondée sur le savoir entraîne
aussi certaines suppressions d'emplois. Ce fut le cas aussi du libre-échange.
C'est le processus qui permet à la main-d'oeuvre et aux capitaux
de se déplacer vers des secteurs plus productifs.
Le Comité souscrit à la liste des critères recommandés
pour l'évaluation de l'intérêt public, en y apportant
les modifications qui précèdent. Aucun témoin n'a
effectivement signalé d'omission dans la liste, ni demandé
d'en retirer aucun critère.
Les regroupements de grandes institutions financières ont, comme
nous l'avons dit, des répercussions sur l'intérêt public
que d'autres n'ont pas. Un processus d'examen public est donc souhaitable.
Il est toutefois extrêmement important de bien définir l'intérêt
public.
Nous avons énuméré, au début de cette partie,
certains motifs qui accélèrent les regroupements d'institutions
financières dans le monde entier. Le secteur ne sera probablement
pas d'accord dans certains cas. Les parlementaires en jugeront sans doute
aussi certains sans fondement. Mais il s'agit de décisions commerciales
et il appartient aux actionnaires des institutions financières de
juger du bien-fondé de ces décisions. Le gouvernement devrait
intervenir dans le processus si les intérêts du public sont
en jeu, sur le plan de la concurrence, de la fiabilité et de la
solidité, et des critères généraux d'intérêt
public. La frontière entre les décisions commerciales et
les inquiétudes gouvernementales est parfois assez nébuleuse,
mais il est extrêmement important d'éviter de la franchir.
Pour notre part, nous vous recommandons ceci : lorsque vous ferez
une déclaration publique sur les incidences que pourront avoir les
fusions, nous voudrions que vous la fassiez non pas du point de vue des
institutions financières, mais plutôt du point de vue des
clients-les manufacturiers et les exportateurs, les détaillants
et les autres clients d'affaires-et que vous vous demandiez quel effet
pourront avoir ces fusions sur leurs affaires.
Jayson Myers (vice-président principal et économiste
en chef, Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada)
Le Comité souscrit au processus d'examen de l'intérêt
public recommandé. Seules les grandes institutions financières
(c.-à-d. lorsque la fusion vise ou crée des institutions
dont l'avoir des actionnaires dépasse 5 milliards de dollars) devraient
en faire l'objet, à moins que le ministre des Finances le juge nécessaire
par ailleurs. Le Comité convient qu'il faudrait en exclure les petites
transactions qui présentent peu de risque pour le bien public. Lorsqu'il
s'agit d'une institution financière en difficulté, d'autre
part, une transaction rapide pourrait sauvegarder la fiabilité et
la solidité de notre système financier. Le Comité
convient donc qu'il faudrait alors autoriser le Ministre, sur recommandation
du BSIF, à approuver rapidement un projet de fusion ou d'acquisition
et d'éviter le processus d'examen recommandé.
Dans le cadre de ce processus d'examen, le Groupe de travail recommande
que les parties à une fusion présentent une évaluation
de l'incidence sur l'intérêt public en y exposant leurs plans
d'entreprise et leurs objectifs, et en indiquant les coûts et les
avantages de la transaction envisagée pour le public. Les parties
devraient aussi indiquer les mesures qu'elles sont disposées à
prendre pour atténuer les répercussions négatives
de la transaction (p. ex., les engagements envers les PME, les régions
rurales, les cessions d'actifs, et ainsi de suite). Le Comité recommande
que le gouvernement énonce clairement quelle information les institutions
financières devront fournir dans ces évaluations de l'incidence.
L'évaluation des fusions et des acquisitions devait se faire au
cas par cas dans le processus d'examen de l'intérêt public.
Le processus, dont le succès dépend de l'objectivité
avec laquelle il sera mené et de la collaboration des intervenants,
devrait aussi, selon nous, englober des tiers que le projet de transaction
ne vise pas directement. Certains ont suggéré qu'il comporte
des audiences publiques. Le Groupe de travail n'a pas fait de recommandations
à cet égard.
Le cadre d'examen des fusions doit être efficace. Nous croyons
que la troisième étape de ce processus ne devrait s'enclencher
qu'une fois les deux premières franchies. Cette méthode étapiste
ne devrait pas retarder le processus. Une fois que le ministre des Finances
aura publié les lignes directrices appropriées, les parties
aux fusions commenceront vraisemblablement à préparer l'évaluation
de l'incidence sur l'intérêt public pendant que les projets
de fusion prennent forme. La troisième étape, qui pourrait
se révéler coûteuse, ne serait ainsi entreprise que
si elle est nécessaire. Dans un contexte commercial en rapide évolution,
où des regroupements se produisent périodiquement, tout retard
déraisonnable du processus décisionnel pourrait se traduire
par des occasions ratées. C'est pourquoi le Comité recommande
que le Bureau de la concurrence et le BSIF rendent leurs décisions
rapidement. En Suisse, par exemple, la Commission de la concurrence établit
un échéancier de 120 jours. Il faudrait aussi entreprendre
de façon rapide le processus d'examen de l'intérêt
public. Une fois ce processus terminé, on s'attendrait à
une décision rapide de la part du Ministre. Un processus rapide,
efficace, exhaustif, coopératif et transparent garantira que le
secteur des services financiers pourra s'adapter rapidement aux nouvelles
réalités et saisir les meilleures occasions commerciales.
Il fera aussi en sorte de fixer rapidement les actionnaires sur l'approbation
ou le rejet du projet de regroupement. Il constituera en outre, pour les
Canadiens, un moyen d'arriver au meilleur choix possible.
Il faudra que le ministre des Finances soit clairement autorisé
et habilié à accepter et à faire respecter en droit,
par le biais du gouverneur en conseil, les engagements des parties aux
fusions. Si ces engagements ne sont pas respectés, le Groupe de
travail recommande d'imposer des sanctions. Le Comité y souscrit.
Malgré l'importance des sanctions, le Comité croit également
que la divulgation par le Ministre de tout manquement, et le tollé
que cela provoquerait sans doute de la part du public, serait un important
élément de dissuasion. Comme dans bien d'autres cas, l'exposition
au soleil est un antiseptique puissant.
Le Groupe de travail a précisé dans ses recommandations
ce sur quoi l'évaluation de l'intérêt public devrait
porter, mais n'a rien dit au sujet du déroulement du processus.
Comportera-t-il des audiences publiques? Qui les tiendra? Fera-t-il appel
aux témoignages et aux analyses d'experts? Ce sont des questions
importantes sur lesquelles il faut se pencher, et le Comité est
d'avis que le déroulement de cet examen nécessiterait une
structure de travail.
Les recommandations du Comité concernant le processus d'examen
des fusions proposé par le Groupe de travail sont résumées
ci-après.
Le Comité estime que les fusions et les acquisitions constituent
des stratégies commerciales légitimes dans le secteur des
services financiers tant qu'elles demeurent dans l'intérêt
du public.
Le Comité recommande d'établir un processus d'examen tripartite
des fusions pour décider si les projets de regroupement sont dans
l'intérêt du public.
- 1re étape : le Bureau de la concurrence s'assure que le projet
ne viole pas la Loi sur la concurrence et ne menace pas la concurrence.
- 2e étape : le surintendant des institutions financières
s'assure que le projet de fusion ne porte pas atteinte à la fiabilité
ni à la solidité.
Le Comité recommande de chercher activement, en collaboration
avec les parties à la fusion, des mesures de redressement. Les institutions
en cause devraient pouvoir réagir rapidement à toute mesure
de redressement proposée par le Bureau de la concurrence ou le surintendant
des institutions financières. Une fois les deux premières
étapes franchies, le processus d'examen de la fusion passerait à
l'étape finale.
- 3e étape : le processus d'examen de l'intérêt public,
qui englobe une évaluation de l'incidence sur l'intérêt
public. Le Groupe de travail a recommandé que cette évaluation
comporte les éléments suivants :
- les coûts et les avantages pour les clients et les PME;
- les effets régionaux;
- l'incidence sur la compétitivité internationale;
- les effets sur l'emploi;
- l'adoption de technologies innovatrices; et
- la création de précédents.
Le Comité recommande que le ministre des Finances établisse
des lignes directrices pour préciser le déroulement du processus
d'examen et ce qu'on attend des parties à la fusion. Le processus
doit satisfaire aux trois critères suivants :
- il doit être transparent pour que le public puisse évaluer
les avantages et les coûts des projets de regroupement;
- il doit être efficace de manière à ne pas
retarder le processus d'approbation et à ne faire subir aux participants
des coûts et une incertitude inutiles; et
- il doit faire appel à la collaboration afin que toutes
les parties puissent travailler ensemble pour trouver une solution qui
avantage tous les Canadiens.
Le Comité souscrit à l'opinion du Groupe de travail pour
ce qui est des cas où l'étape 3 sera nécessaire. Il
recommande donc que le processus d'examen de l'intérêt public
soit obligatoire pour tout projet qui vise ou qui crée des institutions
dont l'avoir des actionnaires dépasse 5 milliards de dollars. Le
Comité recommande en outre que le ministre des Finances puisse exiger
un processus d'examen de l'intérêt public à l'égard
de projets de fusion de petites institutions. Il serait important que le
Ministre publie des lignes directrices pour s'assurer que ces trois objectifs
sont atteints et faire en sorte que les institutions financières
qui envisagent de se regrouper sachent exactement ce qu'on attend d'elles.
Le Groupe de travail a recommandé les éléments
qu'un tel examen devrait englober, sans suggérer exactement comment
procéder. Le Comité juge important de préciser les
mécanismes du processus.
CHAPITRE 5 : LA RÉGLEMENTATION
Comme c'est le cas pour d'autres facettes du secteur des services financiers,
la structure du système réglementaire canadien comporte à
la fois des avantages et des inconvénients. Nous jouissons d'une
stabilité qui n'existe pas aux États-Unis. Par le passé,
des réformes successives ont permis au secteur de se développer,
afin de répondre à la demande des consommateurs, encore une
fois à la différence des États-Unis. Et le Canada
s'est donné un secteur des services financiers national, dont le
système de paiements fait l'envie du monde entier. L'évolution
du marché bancaire national a profité du fait que les banques
relèvent uniquement de la compétence fédérale.
En tant qu'individu qui a travaillé pour une banque américaine
et qui connaît les systèmes réglementaires des deux
côtés de la frontière, je peux vous dire que nous pouvons
être fiers de la qualité de notre réglementation et
des pratiques qui ont été adoptées dans ce pays.
John Cleghorn (président et directeur général,
Banque Royale du Canada)
En revanche, nous ne sommes pas aussi ouverts que les États-Unis
à l'égard des nouveaux venus qui accèdent au secteur
financier et nous sommes handicapés par une réglementation
fragmentée de l'industrie des valeurs mobilières. Cette fragmentation
fait problème. De plus en plus, l'économie se tourne directement
vers les marchés financiers pour financer les besoins des entreprises.
Et les consommateurs, eux aussi, s'adressent de plus en plus à ces
marchés pour y trouver des occasions d'épargne. Dans ce domaine,
ce sont les provinces qui réglementent, et l'on est encore loin
d'un marché national. Au fur et à mesure que la mondialisation
rendra la coopération internationale plus importante, le cadre réglementaire
canadien pourrait bien être en situation de désavantage. Notre
régime de réglementation des titres de placement est décentralisé,
ce qui rend notre système coûteux et fragmenté. Il
suffit de considérer la prise de contrôle récente de
Fonorola par Call-Net pour comprendre à quel point la réglementation
peut être inefficace et contradictoire.
Il est clair qu'avec 10 responsables distincts de la réglementation
des valeurs mobilières au Canada-et en fait il y en a 12, si l'on
compte les responsables de la réglementation des valeurs mobilières
dans les territoires-on peut s'inquiéter du risque d'une fragmentation
de la réglementation dans ce qui est essentiellement un marché
des capitaux.
David Brown (président, Commission des valeurs mobilières
de l'Ontario)
Depuis des années, on envisage une commission nationale des valeurs
mobilières, mais les provinces n'ont jamais pu s'entendre à
cet égard. Le Comité se réjouit de la mise sur pied
annoncée récemment d'un service canadien de réglementation
des valeurs mobilières qui recevra les prospectus déposés
par les émetteurs, les inscriptions de courtiers en valeurs, les
déclarations d'initiés et autres documents qui, jusqu'à
maintenant, devaient être remis à chaque organisme provincial
de réglementation. Cette initiative de partenariat, si elle réussit,
profitera aux émetteurs et aux investisseurs canadiens.
Au départ, la réglementation du secteur financier visait
à assurer la solidité et la stabilité du secteur,
aussi bien dans son ensemble qu'à l'échelle des institutions
prises isolément. De plus en plus, la réglementation englobe
aussi le comportement des institutions sur le marché, en vue de
protéger les consommateurs. Cela est rendu nécessaire en
raison de la complexité croissante des instruments financiers et
la nécessité qui en découle de protéger les
intérêts des consommateurs.
Néanmoins, la réglementation prudentielle, c'est-à-dire
celle qui tend à la solidité et à la stabilité,
reste la plus courante. Elle vise à réduire le plus possible
le risque systémique. La plupart des consommateurs ont du mal à
évaluer le degré de solvabilité des institutions financières
avec lesquelles ils traitent. Les autorités publiques jouent donc
un rôle vital en exerçant une supervision collective des institutions
financières et du système financier.
La réglementation prudentielle est justifiée économiquement
par l'existence d'externalités dans le secteur des services financiers.
Si une institution éprouve des difficultés, celles-ci peuvent
se répercuter sur d'autres institutions saines, par un effet de
ruée générale. C'est ce qu'on appelle le risque systémique.
La fonction traditionnelle des institutions de dépôts est
de financer des actifs à long terme non liquides (prêts commerciaux)
au moyen d'éléments de passif très liquides à
court terme (dépôts à vue). Si la défaillance
d'une institution pousse les déposants à retirer leurs fonds
des autres institutions, le manque de liquidités de ces dernières
risque de les rendre insolvables. Une seule institution en difficulté,
surtout si elle est relativement importante, peut déstabiliser le
secteur entier, menacer les épargnes des Canadiens et gêner
gravement la capacité de fonctionnement de l'économie.
Comme ce risque est associé principalement aux institutions de
dépôts, un système d'assurance-dépôts
a été instauré il y a 30 ans. Ce mécanisme,
pensait-on, peut à lui seul aider à empêcher les mouvements
systémiques. Toutefois, il comportait une série de risques
nouveaux pour le secteur, à savoir le danger moral qui apparaît
lorsque les déposants estiment qu'ils n'ont pas à s'inquiéter
de la situation financière des institutions avec lesquelles ils
traitent et que les dirigeants de ces institutions cherchent à en
profiter en s'engageant dans des transactions et des prêts à
très hauts risques. En conséquence, les autorités
réglementaires doivent adopter une réglementation prudentielle
supplémentaire pour contrer ce danger moral.
Le BSIF est le principal organe de supervision des banques et autres
institutions financières constituées en sociétés.
Il lui incombe de surveiller toutes les institutions financières
de régime fédéral. De plus, la SADC joue un rôle
réglementaire indirect par le truchement de ses normes de conduite
des affaires. La SADC est une société d'État qui assure
les dépôts faits par le public dans les banques et autres
institutions de dépôts, aussi bien fédérales
que provinciales.
Toutes les institutions de dépôts qui sont membres paient
des cotisations pour couvrir leurs obligations en matière d'assurance
auprès de la SADC, même si ces obligations sont garanties
par le gouvernement du Canada. De plus, la SADC a le pouvoir d'emprunter
soit au Trésor soit au secteur privé, si besoin est. Tous
les emprunts de ce genre sont au bout du compte remboursés au moyen
des cotisations des institutions membres.
Le secteur des services financiers canadien se caractérisait
autrefois par ses quatre « piliers » - les banques, les courtiers
en valeurs mobilières, les sociétés d'assurance et
les sociétés de fiducie. Les institutions exerçaient
une gamme limitée d'activités et la réglementation
était axée sur les institutions.
Les quatre piliers ont commencé à s'effriter en 1987,
lorsque le gouvernement fédéral a autorisé les institutions
financières à charte fédérale à posséder
des firmes de courtiers en valeurs mobilières. Les grandes institutions
de dépôts ont toutes profité de cette possibilité,
et elles l'ont fait de manière très spectaculaire.
Cette première incursion a été suivie d'un changement
profond en 1992, lorsque chaque institution financière fédérale
a eu la possibilité de devenir propriétaire de presque n'importe
quelle autre catégorie d'institution financière. De plus,
les pouvoirs internes des institutions ont été augmentés.
Comme conséquence, n'importe quelle institution financière
a pu offrir les services de toutes les autres, soit à l'interne
soit par l'entremise d'une filiale. Les institutions financières
canadiennes sont en train de se transformer en conglomérats. Les
regroupements les plus vastes sont ceux que forment les banques de l'annexe
I.
Le Groupe de travail soutient que les deux caractéristiques du
secteur des services financiers de demain sont : la convergence accélérée,
qui estompera la différence entre les catégories d'institutions
et les produits qu'elles offrent; et l'évolution technologique rapide,
qui permet aux consommateurs de profiter de services entièrement
nouveaux et d'avoir accès aux services traditionnels et nouveaux
selon des modalités complètement nouvelles. Cette convergence
est un phénomène mondial. Cela permet aux consommateurs d'effectuer
dans une même institution ou un même groupe financier des transactions
bancaires et d'assurance, des transactions sur valeurs mobilières
et des opérations de gestion du patrimoine.
La technologie offre des moyens meilleurs et plus efficaces de promouvoir
les nouveaux produits et de prendre des décisions. Les télécommunications
et l'informatique permettent d'acheminer les produits autrement. Les guichets
automatiques, le téléphone et Internet permettent aux gens
d'effectuer des transactions financières 24 heures par jour, 365
jours par année, n'importe où au Canada, et même ailleurs
dans le monde. Certaines institutions n'ont même pas de succursale
au Canada. D'autres n'exercent même pas d'activités, à
proprement parler, à l'intérieur de nos frontières.
Les nouveaux conglomérats financiers, qui offrent des produits
nouveaux et complexes, livrés instantanément par voie électronique,
compliquent la tâche des organes de planification. Le Rapport du
Groupe de travail propose certaines mesures qui amélioreraient la
capacité du BSIF de remplir ses fonctions plus efficacement dans
ce contexte.
Au 30 avril 1999, la SADC aura mis en place un régime de primes
liées au risque. Il y a des témoins qui se sont prononcés
contre cette initiative, craignant ses effets sur les petites entreprises
et les nouveaux concurrents. Gerald Soloway, de l'Association des compagnies
de fiducie du Canada, nous a déclaré : « Plutôt
que de favoriser des institutions de second rang fortes, nous croyons que
cela aurait l'effet contraire. Cela pourrait nuire aux petites sociétés
en les rendant moins compétitives. De fait, nous croyons que le
système proposé aura pour effet de valoir aux petites institutions
des cotes de risque plus élevées. »
Henri-Paul Rousseau, de la Banque Laurentienne, a abondé dans
le même sens. Il a dit au Comité que « l'objectif précis
de la SADC est de faire en sorte que le nouveau ou le petit joueur apporte
plus de concurrence. Si [. . .] par le système des primes on crée
de nombreux obstacles à la croissance, alors on n'obtiendra pas
le résultat qu'on recherche. » Il est important que le régime
réglementaire ne mette pas un concurrent en désavantage vis-à-vis
un autre.
Ce qui nous plaît le plus, c'est le fait que, pour la première
fois depuis bien longtemps, une institution associée au gouvernement
fédéral a reconnu les inégalités qui existent
en matière de services financiers, banques et compagnies d'assurance
confondues, sur le plan de la concurrence. Ces iniquités ont trait
à l'assurance-dépôts et à l'accès au
système des paiements.
M. Claude Garcia (président et directeur général,
Compagnie d'assurance Standard Life)
Si le régime réglementaire ne doit pas étouffer
la concurrence, il ne doit pas la fausser non plus. La tendance étant
à la convergence dans le secteur financier, les produits et les
institutions sont de plus en plus des rivaux directs. L'Association canadienne
des compagnies des assurance de personnes (ACCAP) a affirmé que
la moitié des primes annuelles des assurances-vie et des assurances-maladie
au Canada provenaient de fortunes protégées par la SIAP.
Par ailleurs, les banques et les sociétés de fiducie offrent
maintenant des produits compétitifs semblables sur le marché
des fortunes qui sont protégées par la SADC, une société
d'État.
Si la réglementation avantage un groupe de sociétés
ou de produits au détriment d'autres groupes, cela crée des
barrières qui pourraient contribuer à réduire la concurrence
sur le marché. Le Groupe de travail est d'avis qu'il existe un tel
déséquilibre entre les programmes de protection des consommateurs
destinés aux clients des institutions de dépôts et
des compagnies d'assurance-vie. Les recommandations 12, 117 et 118 proposent
la fusion de la SADC et de la SIAP. Le Groupe de travail n'indique pas
laquelle des deux options il préfère, le modèle du
secteur privé ou celui de la société d'État.
J'aimerais parler [de la question de] l'égalisation des conditions
de concurrence. La SIAP est d'avis que, dans l'éventualité
de l'insolvabilité d'un établissement financier, quel qu'il
soit, les consommateurs devraient pouvoir bénéficier du même
soutien de l'État.
Gordon M. Dunning (vice-président exécutif,
Société canadienne d'indemnisation pour les assurances de
personnes)
Le Groupe de travail et les témoins du secteur des assurances
considèrent que ce déséquilibre tient au fait que
les consommateurs ont plus confiance dans la SADC, parce qu'il s'agit d'une
société d'État qui a accès aux garanties fédérales
et au Trésor. La SIAP a affirmé qu'il ne fait pas de doute
que les inégalités actuelles dans les arrangements d'indemnisation
des consommateurs créent d'importants désavantages compétitifs
pour les compagnies d'assurance-vie et d'assurance-maladie par rapport
aux banques et aux fiducies. Dans son mémoire, la SIAP a présenté
une étude de cas résumant la décision de l'administrateur
d'un important fonds de pension (125 millions de dollars) d'en enlever
la gestion à une grande compagnie d'assurances parce que la SIAP
n'est soutenue que par l'industrie des assurances, et non par le gouvernement.
Tous les sondages montrent que les consommateurs préfèrent
nettement les produits garantis par la SADC. Des témoins ont dit
au Comité qu'ils avaient perdu des contrats de produits d'épargne
au profit des institutions de dépôts simplement parce que
les clients considéraient que les produits de l'institution de dépôts
comportaient une meilleure garantie.
Le Groupe de travail propose cette initiative [à savoir, revoir
la SADC et la SIAP] afin de réaliser deux grands objectifs d'intérêt
public : premièrement, l'égalité des déposants
et des titulaires de polices; et deuxièmement, une concurrence et
une compétitivité accrues. Notre industrie est entièrement
d'accord avec le Groupe de travail. Nous exhortons donc le Comité
à recommander au gouvernement d'adopter rapidement une démarche
visant à mettre sur un pied d'égalité les divers régimes.
Chris McElvaine (président, Association canadienne
des compagnies d'assurance de personnes)
Les consommateurs estiment que les produits d'épargne offerts
par les institutions de dépôt jouissent de la garantie du
gouvernement, contrairement à ceux qui jouissent de la protection
de la SIAP. Or, les instruments d'épargne offerts par les banques
et les compagnies d'assurance étant en concurrence directe, cette
asymétrie peut avoir des répercussions très réelles
et injustifiées sur la concurrence.
À un niveau supérieur, il nous faut prendre en compte
les recommandations concernant le système de paiements et la SADC
en demandant l'avis de professionnels. Ce sont des questions complexes
qui ont des répercussions énormes sur la solidité
et la viabilité du secteur financier. Je ne les conteste pas; je
dis simplement que des praticiens devront les examiner de très près.
Peter C. Godsoe (président et directeur général,
Banque Scotia)
La SADC a affirmé au Comité que les produits des compagnies
d'assurances et des institutions de dépôts étaient
encore assez différents pour rendre le fusionnement complexe, et
peut-être contre-productif. Le Comité est donc d'avis que
le gouvernement fédéral devrait envisager sérieusement
de se contenter de privatiser la SADC pour répondre à cette
préoccupation. Gordon Dunning, de la SIAP, a soutenu ceci : «
Nous ne préconisons pas un type de soutien gouvernemental particulier,
mais nous pensons que des solutions faisant appel à une aide limitée
des pouvoirs publics répondraient bien aux attentes actuelles de
la population et de l'État.
Nous exhortons le Comité à recommander que soit adoptée
la proposition d'égaliser les conditions de concurrence et que soient
étudiées plus en profondeur cette question et les questions
connexes de convergence au niveau des institutions et des produits et de
la confusion qui règne chez les consommateurs. Il existe plusieurs
solutions qui permettraient de régler ces problèmes. Nous
nous réjouissons à l'avance de participer à toute
réflexion future sur celles qui seraient les plus appropriées.
Alan E. Morson (président, Société canadienne
d'indemnisation pour les assurances de personnes)
La question est certes très complexe. Le Comité appuie
le principe des recommandations du Groupe de travail, mais il estime qu'il
faut étudier la question plus à fond. Il recommande donc
que le gouvernement réfléchisse à la meilleure façon
de résoudre ce problème.
La vague de changements qui balaie le secteur des services n'a pas pour
seule conséquence de remettre en question la capacité du
gouvernement d'assurer une réglementation équitable. Elle
a un effet considérable sur les organes de réglementation,
qui s'inquiètent pour la solidité et la stabilité
du secteur financier. Les institutions financières, qu'elles aient
leur siège au Canada ou à l'étranger, sont en train
de se transformer en conglomérats financiers à activités
et à produits multiples. Il est difficile pour le commun des mortels
de comprendre bon nombre des produits et des transactions inscrites au
menu des institutions. Seuls les spécialistes peuvent examiner en
connaissance de cause la structure d'entreprise d'une institution moderne
pour mesurer la nature et l'ampleur du risque que celle-ci présente.
Les institutions financières canadiennes font dorénavant
partie intégrante du marché mondial, puisque la moitié
de leurs bénéfices sont gagnés à l'étranger.
Non seulement les banques canadiennes gèrent-elles leurs risques
à l'échelle mondiale, mais elles doivent aussi gérer
ceux de leurs filiales des secteurs de l'assurance, de la fiducie et des
valeurs mobilières. Les transactions à grande échelle
peuvent se faire instantanément.
Il est donc de plus en plus difficile pour les autorités réglementaires
de mesurer le risque associé à telle ou telle institution,
ou encore les menaces qui pèsent sur sa solvabilité et sur
la stabilité du système financier. Les autorités pourraient
bien avoir la propension, dans une situation comme celle-là, à
réagir exagérément et à prendre des règlements
trop sévères qui risqueraient d'étouffer les initiatives
des entrepreneurs. Il faut résister fermement à cette tendance.
Le Groupe de travail affirme plutôt que « le défi, pour
les responsables de la réglementation prudentielle moderne, consiste
à trouver les moyens d'exercer une surveillance efficace sur des
institutions plus innovatrices et entreprenantes, sans pour autant entraver
la concurrence et le dynamisme qui sont les fruits de l'innovation46.
» Le Comité souscrit à cette idée, qui d'ailleurs
correspond à sa recommandation antérieure voulant que soit
abandonnée l'approche de la réglementation « à
taille unique ».
Il est notamment recommandé que le mandat du Bureau du surintendant
des institutions financières soit modifié pour qu'y figure
également la nécessité de parvenir à un équilibre
entre la concurrence et l'innovation, d'une part, et la solidité
et la viabilité financières, d'autre part. Cette orientation
suscite de graves inquiétudes dans notre industrie. Les responsabilités
supplémentaires qu'on propose de confier au BSIF pour encourager
la concurrence et l'innovation et pour assurer la protection des consommateurs
pourraient l'empêcher de bien s'acquitter de sa tâche essentielle,
qui consiste à veiller à la solidité et à la
viabilité financières des sociétés. Le mandat
du BSIF deviendrait plus difficile et éventuellement plus ambigu
du fait des tensions qui existent entre la solidité et la viabilité
financières, d'une part, et la promotion de l'innovation, de l'autre.
Chris McElvaine (président, Association canadienne
des compagnies d'assurance de personnes)
Le Comité ne souscrit pas à la manière dont le
Rapport étend la portée de cette idée en recommandant
que le mandat du BSIF soit modifié de manière à exiger
explicitement que le Bureau établisse l'équilibre entre le
souci de solidité et de stabilité, d'une part, et l'amélioration
de la concurrence, de l'innovation de la protection des consommateurs et
de la compétitivité internationale, d'autre part. Nous sommes
au contraire d'accord avec le maintien de l'actuel mandat du BSIF, qui
met l'accent sur la solidité et la stabilité, sans toutefois
restreindre la concurrence. Le BSIF « [. . .] doit remplir son rôle
en tenant compte de son impact sur la concurrence [. . .] » ce qui
l'aide « [. . .] à ne pas succomber à la tentation
d'appliquer la réglementation de façon excessive47
», selon John Palmer, actuel surintendant des institutions financières.
Le Groupe de travail cherche à réaliser certains objectifs
politiques importants, y compris l'augmentation de la concurrence et l'amélioration
de la protection des consommateurs. Toutefois, des recommandations visant
ces objectifs pourraient influer négativement sur la capacité
du gouvernement d'atteindre d'autres objectifs, y compris la protection
des déposants et des souscripteurs et le degré élevé
de confiance du public dans la sécurité du système
financier.
John Palmer (surintendant, Bureau du surintendant des institutions
financières Canada)
M. Palmer a ensuite exprimé son opposition à ces recommandations
(recommandations 10 et 112) : « [. . .] la concurrence et l'innovation
[. . .], a-t-il déclaré, ne sont pas assujetties au contrôle
du BSIF et peuvent entrer en conflit avec la solidité et la stabilité.
[. . .] L'ajout d'une responsabilité précise en matière
de concurrence et d'innovation pourrait inciter le BSIF à s'abstenir
de réglementer, au détriment d'une intervention précoce
et d'une résolution rapide des problèmes48.
» M. Palmer est même allé plus loin : « [. . .]
l'ajout de la responsabilité de la concurrence et de l'innovation
au mandat actuel du BSIF pourrait nuire à l'indépendance
du BSIF et le rendre plus sensible à des préoccupations non
réglementaires. [. . .] Si la concurrence devenait une responsabilité
du BSIF, celui-ci pourrait être poussé à approuver
la propriété d'institutions financières par des personnes
moins recommandables. » Michael Mackenzie, ancien surintendant des
institutions financières, partage lui aussi notre inquiétude
à propos d'un tel élargissement du mandat du BSIF.
[Le] BSIF doit influer le moins possible sur la concurrence, mais
nous ne croyons pas que cela veuille dire que la responsabilité
de faciliter la concurrence nous est dévolue. Au lieu de cela, les
objectifs du BSIF en matière de dérogation sont de protéger
les déposants et les souscripteurs contre les pertes indues et de
maintenir la confiance dans le système financier.
John Palmer (surintendant, Bureau du surintendant des institutions
financières Canada)
Améliorer la concurrence et promouvoir la compétitivité
des institutions nationales est un objectif valide, voire important, pour
les pouvoirs publics. Ce ne doit toutefois pas être un objectif pour
l'autorité réglementaire prudentielle. Tout comme la Banque
du Canada reconnaît que la poursuite d'un seul objectif lui permet
de mieux fonctionner et de mener sa politique monétaire avec plus
de transparence, ce qui la rend plus responsable devant les Canadiens,
de même nous croyons que le BSIF doit avoir un mandat clair et non
contradictoire, à savoir, assurer la solidité et la stabilité
du secteur financier et des institutions qui en font partie.
Le Rapport MacKay suggère d'étendre les responsabilités
du Bureau du surintendant des institutions financières pour qu'il
comporte un volet de protection des consommateurs. Je suis en désaccord
avec cette recommandation parce qu'elle placera le Bureau du surintendant
des institutions financières en situation de conflit. La mission
première du BSIF est d'assurer la stabilité et la solvabilité
du système financier canadien.
Jean Roy (professeur agrégé de finance, École
des Hautes Études Commerciales (à titre personnel))
De cette façon, tout conflit entre les deux objectifs pourra
être examiné et débattu en public. Si, par exemple,
de l'avis général, un objectif est favorisé à
l'excès au détriment de l'autre, la discussion aura lieu
au grand jour. Le surintendant des institutions financières et le
ministre des Finances pourraient être appelés à comparaître
devant un comité parlementaire pour expliquer le conflit en question.
Les différends seraient davantage assujettis à la règle
de la transparence. Or, cette transparence et le débat public n'auront
guère de chances de devenir réalité si les conflits
d'objectifs sont résolus au sein d'un même organisme, qu'il
soit structuré comme il l'est actuellement ou qu'il comporte un
conseil d'administration, ainsi que le propose le Groupe de travail.
Élargir le rôle du BSIF de manière à lui
donner des fonctions accrues en matière de protection des consommateurs
pose également des problèmes. Ici encore, l'actuel et l'ancien
surintendants des institutions financières ont soutenu qu'il n'était
pas dans l'intention de l'autorité réglementaire de protéger
les intérêts des consommateurs. Et la possibilité de
conflit existe ici aussi, quoique pas autant que si le BSIF devait aussi
favoriser le jeu de la concurrence. John Palmer a affirmé : «
Le BSIF a assurément la responsabilité de protéger
les intérêts des souscripteurs. Cependant, quelle est la meilleure
façon d'y arriver? En maintenant un niveau adéquat de solvabilité
et de stabilité, ou en soutenant les intérêts des consommateurs?
On ne sait pas précisément quel rôle l'emporterait
en cas de conflit. »
En conséquence, le Comité s'oppose aux recommandations
10 et 112 du Rapport du Groupe de travail. Il recommande en revanche que
soit établi un bureau de la protection des consommateurs (BPC).
Le Comité recommande que le nouvel ombudsman des services financiers
soit responsable de ce bureau. Celui-ci aurait pour champ d'action toutes
les mesures de protection des consommateurs qui sont citées dans
le Rapport MacKay. Cela coïncide avec la suggestion que formulait
le Comité des finances dans une recommandation de son Rapport d'octobre
1996 intitulé « L'examen de 1997 de la législation
régissant les institutions financières : Propositions de
modifications ». La promotion de la concurrence et de l'innovation
devrait être considérée comme un principe fondamental
de la politique générale du gouvernement à propos
du secteur financier.
En recommandant de créer un bureau de la protection du consommateur,
nous ne suggérons nullement qu'il faille se désintéresser
du fardeau de la réglementation. Nous souhaitons simplement que
tous les organismes de réglementation reçoivent des objectifs
et un mandat appropriés.
Il existe plusieurs façons d'alléger le fardeau de la
réglementation, à l'avantage des consommateurs en accroissant
la concurrence et à celui des institutions en baissant les coûts
et en augmentant la compétitivité. Nous souscrivons aux recommandations
du Groupe de travail, selon lesquelles il faudrait alléger le processus
d'approbation des nouvelles institutions (recommandation 4b)). La SADC,
qui assure les dépôts, a, petit à petit, assumé
des fonctions réglementaires élargies. Le Groupe de travail
recommande que toutes les fonctions de réglementation et de supervision
soient centralisées au BSIF, et le Comité souscrit à
cette idée. Grant Reuber, de la SADC, n'est pas en faveur de cette
recommandation. Il soutient ce qui suit : « [. . .] en éliminant
ou en réduisant les moyens dont la SADC dispose pour renforcer la
sûreté et l'intégrité du système, on
irait à l'encontre de son mandat actuel qui consiste, entre autres,
à réduire le plus possible ses risques de perte. »
Le Comité estime que la partie du mandat de la SADC qui exige qu'elle
fasse la promotion de saines normes commerciales et financières
pour ses membres fait double emploi avec les règles du BSIF. Aussi,
le rôle de la SADC dans l'établissement de normes applicables
aux pratiques commerciales et financières devrait-il être
transféré au BSIF (recommandation 114). La SADC serait l'assureur
et s'occuperait de toutes les initiatives correspondant à ce rôle.
Une coopération étroite entre le BSIF et la SADC n'est pas
seulement utile, elle est nécessaire. Encore une fois, si cette
coopération fait défaut, la chose sera probablement rendue
publique et fera l'objet d'un examen parlementaire.
La recommandation 113 demande que le BSIF soit doté d'un conseil
d'administration, afin d'améliorer sa régie. S'il est vrai
que le surintendant a donné son appui de principe à cette
recommandation, il a également apporté une réserve,
à savoir que le conseil d'administration pourrait saper les pouvoirs
du surintendant et du ministre des Finances et avoir des effets néfastes
sur la filière de reddition des comptes, qui va du surintendant
jusqu'au Ministre, puis du Ministre au Parlement. Le Groupe de travail,
dans son Rapport, ne précise pas quel serait le rôle de ce
conseil d'administration. Comme l'a déclaré Jean Roy, de
l'École des Hautes Études Commerciales : « Dans le
cas du BSIF, il sera important d'exprimer explicitement les rôles
respectifs du ministre, du surintendant et du futur conseil d'administration.
» Le Comité est très préoccupé à
cet égard et il recommande que le gouvernement n'applique pas cette
recommandation pour l'instant.
Il serait [. . . important que les règles soient harmonisées
entre les provinces afin de diminuer les dépenses administratives
inhérentes.
Jean-Guy Langelier (président et chef de la direction
La Caisse centrale Desjardins, Confédération des caisses
populaires et d'économie Desjardins du Québec)
Le Comité souscrit au principe qui sous-tend les recommandations
115 et 116, visant à réduire le chevauchement réglementaire
et à alléger les formalités. Comme la recommandation
115 porte sur les pouvoirs des diverses compétences, le Comité
estime que le gouvernement fédéral et le BSIF devraient travailler
en étroite collaboration avec leurs homologues provinciaux, afin
de trouver des moyens acceptables de corriger ce chevauchement. Si l'application
de cette recommandation est un succès, il en résultera des
synergies et moins de doubles emplois dans les régimes réglementaires.
Yvon Charest, de L'Industrielle-Alliance, s'est exprimé très
clairement là-dessus : « À notre compagnie, L'Industrielle-Alliance,
nous avons à la fois des compagnies à charte québécoise
et des compagnies à charte fédérale [. . .]. Même
si la compagnie mère du groupe est à charte québécoise,
nous devons remettre régulièrement des informations financières
à l'autorité de surveillance fédérale. Dans
la mesure où il y aurait respect des juridictions primaires, nous
n'aurions pas à transiger avec deux autorités de surveillance
différentes. »
Le Groupe de travail a également abordé une question liée
à la réglementation qui risque de poser des problèmes
croissants aux autorités réglementaires nationales, à
savoir la façon de traiter les institutions qui offrent des services
aux Canadiens sans avoir établi de présence physique dans
notre pays. Ce problème n'est pas nouveau. D'importantes sociétés
canadiennes traitent depuis longtemps directement avec des institutions
étrangères. Certains voyageurs canadiens maintiennent des
relations bancaires au Canada et à l'étranger. Bien des personnes
domiciliées non loin de la frontière américaine font
affaire avec des banques américaines, à Buffalo par exemple.
L'arrivée de la Wells Fargo sur le marché canadien représente
toutefois un type entièrement nouveau d'accès aux institutions
étrangères. En outre, le développement prévisible
des transactions par Internet permettra littéralement aux Canadiens
de « faire leurs emplettes financières » dans le monde
entier. On les attirera non seulement par des envois postaux massifs, mais
aussi par des promotions sur Internet. Les moteurs de recherche d'Internet
s'utiliseront, comme Les Pages Jaunes, pour orienter les consommateurs
vers les sites Web du type www.cheapestmortgage.com ou www.freechequing.com.
À quel genre de protection les consommateurs peuvent-ils et doivent-ils
s'attendre?
À l'heure actuelle, aucune loi ni aucun règlement cohérent
ne s'applique aux firmes qui pénètrent le marché canadien
sans y être présentes physiquement. Les dispositions de la
Loi sur les banques ne s'appliquent qu'aux institutions financières
qui exercent leurs activités au Canada en y ayant une présence
physique. Les autres ne sont assujetties à aucun règlement
ni à aucune loi du gouvernement fédéral. En ce qui
concerne la Wells Fargo, nous sommes devant le cas d'une institution financière
qui s'est donné beaucoup de mal pour remplir les exigences du surintendant
des institutions financières. Comme l'a souligné le Groupe
de travail, rien ne justifiait ces mesures du point de vue commercial ou
prudentiel. Elles visaient simplement à étayer l'affirmation
voulant que la banque n'effectue aucune transaction bancaire au Canada.
Dans un tel monde, que faut-il réglementer et comment appliquer
cette réglementation? Le Groupe de travail conclut que l'accès
virtuel à un marché à partir de l'étranger
ne peut être réglementé de façon satisfaisante
que par une entente internationale qui fixera des règles communes
et attribuera à l'autorité réglementaire nationale
la tâche de les appliquer. Dans l'intervalle, il recommande un certain
nombre de solutions temporaires, notamment un système d'agrément
des prêteurs étrangers qui font de la sollicitation massive,
et des moyens par lesquels les consommateurs seront tenus informés
au sujet des fournisseurs étrangers. Ce processus d'agrément
constitue un moyen de faire en sorte que les sociétés financières
étrangères qui traitent avec les Canadiens respectent la
déontologie de la réglementation canadienne. Quelle en serait
l'efficacité? Cela reste à voir.
Comme le souligne le Groupe de travail, les institutions financières
sans présence physique au Canada, qui acceptent des dépôts
de clients canadiens, soulèvent une inquiétude beaucoup plus
grande pour les autorités réglementaires et les décideurs
publics. Il s'agit là d'un problème qui manifestement ne
peut être résolu de manière unilatérale et,
d'après le Groupe de travail, le Canada devrait agir à l'échelon
international pour encourager une approche commune de ce phénomène.
Il recommande une réglementation par la compétence locale.
Le Groupe de travail a recommandé que, d'ici à ce que les
arrangements internationaux aient été pris, le BSIF augmente
ses activités de divulgation de renseignements sur Internet.
Nous sommes d'avis que le gouvernement peut prendre dès maintenant
certaines initiatives concrètes qui répondraient à
beaucoup d'inquiétudes exprimées dans le Rapport. Le Comité
recommande que le gouvernement fédéral entame, avec les États-Unis
d'abord, des négociations visant à assurer un traitement
national des clients des institutions financières. Ainsi, les personnes
domiciliées au Canada qui déposent des fonds dans des banques
américaines jouiraient des mêmes avantages que les personnes
domiciliées aux États-Unis. Les emprunteurs qui résident
au Canada seraient protégés par la réglementation
au même titre que ceux qui vivent aux États-Unis. La même
chose serait vraie pour ce qui est des habitants des États-Unis
qui traitent avec des banques canadiennes. Si Citicorp décidait
d'offrir une gamme complète de services financiers aux Canadiens
par l'entremise d'Internet, à partir d'un lieu quelconque aux États-Unis,
les Canadiens pourraient profiter de la même protection du consommateur
et de la même assurance-dépôts49
que les personnes domiciliées aux États-Unis qui traitent
avec Citicorp.
CHAPITRE 6 : ACCROÎTRE LE POUVOIR DU CONSOMMATEUR
Il y a deux façons de protéger les consommateurs : accroître
la concurrence et légiférer pour faire échec aux pratiques
anticoncurrentielles inacceptables.
La concurrence peut être considérée comme l'ultime
rempart du consommateur. Une fois mises en oeuvre, bon nombre de recommandations
du Groupe de travail, approuvées par le Comité, élargiront
les choix offerts aux consommateurs. La concurrence entre différentes
entreprises permet d'offrir aux consommateurs un plus vaste éventail
de choix et assure l'accès aux meilleurs produits à de meilleurs
prix. La plus grande variété de choix accroît, quant
à elle, la mobilité, de sorte que les consommateurs qui estiment
être mal servis par un fournisseur en particulier peuvent facilement
se tourner vers un autre qui leur offrira un traitement honnête et
convenable. Si les forces concurrentielles fonctionnent parfaitement bien,
il ne sera pas nécessaire de légiférer pour contrôler
les pratiques des entreprises, puisque les consommateurs insatisfaits n'auront
qu'à s'adresser à un autre fournisseur.
Il est bien clair que les institutions financières serviront
tous les Canadiens bien et équitablement uniquement si les consommateurs
sont responsabilisés, si les règles de transparence et de
divulgation sont strictes et complètes, et si un système
de responsabilisation globale est promulgué. Il est également
évident que les institutions financières, en particulier
les banques, doivent servir tous les intervenants bien et équitablement
parce qu'elles ont profité historiquement de protections.
Duff Conacher (président, Coalition canadienne pour
le réinvestissement communautaire, et coordonnateur, Démocratie
en surveillance)
Notre contexte commercial actuel est toutefois très complexe
et les forces concurrentielles n'y interviennent pas toujours. Ainsi, il
n'est pas toujours facile pour les consommateurs de se prévaloir
de tous leurs choix, en raison de l'existence d'intervenants dominants
et de pratiques commerciales abusives ou, plus fréquemment, à
cause du manque d'information.
Il leur est de plus en plus malaisé de faire des choix en raison
de la complexité croissante des produits financiers et de leurs
caractéristiques parfois uniques qui rendent difficile toute comparaison.
Il suffit de voir comment il est ardu de comparer la multitude de cartes
de crédit offertes sur le marché pour comprendre à
quel point les produits financiers sont sophistiqués et innovateurs
et à quel point il est compliqué pour les consommateurs de
s'y retrouver. Cette difficulté est exacerbée par les nouvelles
technologies qui élargissent encore davantage l'éventail
des choix. Bien des consommateurs feront quand même le tour du marché
et choisiront leurs produits financiers auprès de plus d'une institution
financière. De nombreux autres, par contre, profiteront des avantages
offerts par les services financiers groupés. Les institutions financières
sont de plus en plus nombreuses à vouloir établir une relation
globale avec leur clientèle. Ainsi, les institutions de dépôts
veulent non seulement offrir des comptes de chèques et d'épargne
à leurs clients, mais aussi des cartes de crédit, des REER,
de l'assurance-vie, des services de courtage et de gestion de la richesse.
Pour ce faire, elles ont recours à toute une panoplie de mesures
d'encouragement et de compensation (frais moins élevés, taux
d'intérêt réduits sur les emprunts, meilleur rendement
sur l'épargne, et autres). Dans un tel contexte, les choix des consommateurs
deviennent difficiles à évaluer et à influencer. Les
conditions suivantes doivent exister pour aider les consommateurs à
prendre de bonnes décisions : l'accès à l'information
nécessaire pour faire des choix avisés; des mesures qui protègent
les renseignements personnels contre toute utilisation abusive; des règles
strictes interdisant les ventes liées avec coercition et la possibilité
de passer librement d'une institution financière à une autre.
Le Bureau de la concurrence a pour mandat d'examiner le comportement
des entreprises dans le secteur des services financiers et dans d'autres
industries pour s'assurer que celui-ci ne fait pas obstacle à la
concurrence dans le secteur examiné. La politique de la concurrence
s'applique toutefois à l'échelon macroéconomique.
Elle ne permet pas de garantir à chaque consommateur à titre
individuel qu'il ne sera jamais victime de pratiques abusives, ni de garantir
que le recours à de telles pratiques est exceptionnel. Elle vise
plutôt à faire en sorte que les pratiques commerciales restrictives,
comme le refus de faire commerce, la vente liée, la limitation du
marché ou l'abus de position dominante, ne permettent pas aux entreprises
d'exercer une emprise sur les marchés.
Le Comité a fait ressortir la portée limitée de
la Loi sur la concurrence au printemps 1998, lorsqu'il s'est penché
sur la question des ventes liées. Il a finalement recommandé
que l'article 459.1 de la Loi sur les banques soit promulgué.
Il ne fait aucun doute que la Loi sur la concurrence, bien qu'elle
soit un instrument important, ne protège pas efficacement les consommateurs
contre les pratiques abusives. C'est là un point de vue que partage
le Groupe de travail. En fait, celui-ci va même plus loin dans son
Rapport en affirmant que la Loi sur la concurrence ne suffit pas
à créer un environnement favorable à la concurrence
sur le marché financier moderne.
Les Canadiens semblent également préoccupés
par les dispositions qui régissent leurs contrats financiers. Une
proportion étonnamment élevée de Canadiens (16 %)
déclarent que, à leur avis, leur emprunt, hypothécaire
ou autre, n'aurait peut-être pas été approuvé
s'ils n'avaient pas acheté un autre produit à l'institution
prêteuse.
Comme nous l'avons constaté le printemps dernier et comme le
confirme le Rapport du Groupe de travail, les ventes liées sont
devenues l'une des principales préoccupations des consommateurs
et des fournisseurs de services financiers. La vente liée est le
mécanisme en vertu duquel un produit peut être acheté
seulement s'il y a achat d'un deuxième produit.
[L]e régime anti-vente liée le plus rigoureux n'aura
qu'un effet limité si les consommateurs canadiens continuent de
se sentir impuissants devant leur agent de prêts bancaires.
David Thibaudeau (président, Association canadienne
des conseillers en assurance et en finance)
Il existe des situations où la vente liée peut être
profitable et acceptable pour les consommateurs. Dans certains cas, elle
est nécessaire en raison de l'aspect technologique des produits
ou en raison de la demande des consommateurs. Il arrive aussi parfois que
l'interdistritution ou la vente groupée soit avantageuse, c'est-à-dire
lorsque le prix d'un ensemble de produits, qui peuvent être achetés
séparément ou collectivement, est inférieur à
la somme de leurs prix individuels. À cause de la convergence qui
s'exerce dans le secteur des services financiers, les institutions ont
de plus en plus tendance à regrouper leurs services. Ce genre de
pratique est habituellement profitable aux consommateurs.
Comme nous l'avions appris au cours de nos audiences antérieures
sur la vente liée et comme nous l'ont confirmé nos présentes
audiences sur le Rapport du Groupe de travail, ce qui inquiète les
Canadiens, c'est le caractère potentiellement coercitif de cette
pratique. La coercition crée une inégalité de pouvoir
dans les relations financières dont il faut atténuer l'ampleur,
en particulier si les institutions financières doivent se transformer
en conglomérats. Non seulement ces pratiques sont-elles abusives
à l'endroit des consommateurs, mais elles risquent fort de réduire
la concurrence. Il est difficile pour les consommateurs de réagir
aux pratiques abusives par l'intermédiaire du marché. Il
n'est ni simple ni gratuit pour une entreprise de transférer ses
affaires d'une institution à une autre. Conscients de ce fait, les
conglomérats financiers pourraient se servir de leur influence pour
attirer à eux un grand nombre d'entreprises.
Le Comité a constaté aussi que la pratique des ventes
liées relève autant de la perception que de la réalité.
Dans la mesure où son influence a pour effet de réduire la
concurrence, il est clair que des mesures s'imposent pour corriger la perception
aussi bien que la réalité.
Le Groupe de travail a formulé quatre recommandations à
cet égard. Le champ d'application de l'article 459.1 de la Loi
sur les banques, qui a récemment été promulgué
sur la recommandation du présent Comité, devrait être
élargi pour englober un plus vaste éventail de services financiers
susceptibles d'être liés les uns aux autres. Selon le Groupe
de travail, cette mesure devrait être adoptée sans délai.
De plus, les consommateurs qui concluent une entente en vertu des nouvelles
dispositions doivent être informés du fait qu'il est contraire
à la loi de la part d'une institution de recourir à des méthodes
coercitives et doivent savoir ce qui constitue une vente liée avec
coercition. Enfin, le Rapport recommande l'établissement d'un mécanisme
de recours civil.
Le Comité appuie donc les recommandations 70 à 75.
En plus d'interdire certaines pratiques, il faut donner aux consommateurs
les moyens d'exercer et de faire respecter leurs droits. La liberté
d'agir des consommateurs est une condition préalable importante
à l'instauration d'une concurrence. Comme il est mentionné
précédemment, la concurrence contribue aussi à la
compétitivité des institutions financières. La concurence
n'est pas seulement une question du nombre de fournisseurs dans un marché
ou des niveaux de concentration. Elle dépend de l'attitude. Pour
que la concurrence existe sur le marché, il faut que l'ensemble
des participants respectent les règles qui la régissent et
agissent de façon à en favoriser l'émergence. Un marché
fonctionne bien lorsque les participants ont le choix, par exemple, lorsqu'ils
peuvent à leur gré se débarrasser des mauvais fournisseurs.
Par conséquent, l'adoption de politiques pour accroître le
pouvoir des consommateurs peut avoir une énorme incidence sur l'aspect
global du secteur des services financiers au Canada. À cet égard,
les mesures prises en ce sens peuvent être grandement profitables
à l'économie, à condition d'être bien conçues
et efficaces.
Le Groupe de travail recommande l'adoption d'une série de mesures
visant à élargir les choix offerts aux consommateurs et à
leur conférer davantage de pouvoir dans l'exercice de ces choix.
Une documentation claire et précise devrait compenser pour
l'absence de documents de référence traditionnels qu'a apporté
la venue du monde Internet.
Rozanne E. Reszel (présidente et directrice générale,
Fonds canadien de protection des épargnants)
Comme le signale le Groupe de travail, pour que les consommateurs puissent
bien jouer leur rôle, ils doivent être en mesure de voir ce
qui distingue un bon produit d'un mauvais produit, une bonne institution
d'une mauvaise institution. C'est une condition préalable, mais
elle est loin d'être suffisante. En effet, il s'agit là de
tout un défi, compte tenu de la nature de bon nombre de produits
financiers et de la façon dont s'effectuent les transactions. Ce
sont des services complexes qui, la plupart du temps, sont achetés
de façon peu fréquente. De plus, les consommateurs hésitent
souvent à changer d'institution en raison des coûts engagés
pour le faire. Dans ce contexte, les institutions financières estiment
pour leur part qu'elles ne risquent pas grand-chose en traitant négligemment
leurs clients.
Pour 64 % des Canadiens, l'information reçue au sujet des
produits bancaires qu'ils achètent n'est pas suffisante. Le chiffre
est comparable (68 %) pour les produits vendus par les sociétés
d'assurances.
Un consommateur habile est un consommateur averti. Pour l'être,
il doit comprendre les produits qui lui sont offerts et les conditions
qui leur sont applicables. En d'autres termes, les transactions doivent
se caractériser par leur transparence. L'information doit non seulement
être divulguée, mais elle doit l'être d'une façon
qui soit facilement compréhensible pour les consommateurs.
La réglementation du contenu des prospectus fait l'objet d'une
révision à l'heure actuelle, en particulier pour ce qui est
des fonds communs de placement, mais il est évident que le client
doit recevoir des informations claires et précises pour qu'il puisse
prendre des décisions éclairées. Nous appuyons sans
aucune réserve la recommandation 57 qui demande que les documents
juridiques soient rédigés en termes clairs et simples.
Rozanne E. Reszel (présidente et directrice générale,
Fonds canadien de protection des épargnants)
Les nouvelles règles en matière de divulgation et de transparence
permettraient aux consommateurs de comprendre ce qu'on leur offre, à
quel prix et à quelles conditions. Il est essentiel à cet
égard de recourir à un langage simple. Les formules incompréhensibles
et le jargon technique sont à proscrire. L'une des conditions préalables
pour assurer la transparence réside dans la divulgation en temps
opportun des conditions d'un contrat financier. Les services financiers
sont des produits nébuleux et pour savoir ce qu'ils achètent
réellement, les consommateurs doivent bien comprendre les conditions
applicables à leurs contrats de services financiers. Quiconque a
signé récemment un contrat d'hypothèque sait ce que
cela veut dire. Rares sont ceux parmi nous qui seraient en mesure d'expliquer
ce que sont les surcharges de paiement anticipé sur un emprunt hypothécaire
fermé, si on le leur demandait.
À cet égard, le Comité souscrit aux recommandations
57 à 60 contenues dans le Rapport du Groupe de travail.
Tel qu'on l'a expliqué précédemment, le Comité
ne croit pas que la responsabilité de faire appliquer les exigences
en matière de transparence et de divulgation devrait incomber au
BSIF à l'échelle fédérale. En fait, cela pourrait
nettement entrer en conflit avec le mandat principal du BSIF qui consiste
à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur
des services financiers, si le surintendant se voyait aussi confier la
responsabilité de promouvoir l'innovation, la protection du consommateur
et la concurrence, comme le propose la recommandation 112 b) du Groupe
de travail. Le Comité est d'avis que cette responsabilité
devrait être confiée au nouvel office de protection des consommateurs
qui doit relever du nouvel ombudsman des services financiers. En conséquence,
le Comité ne peut souscrire à la recommandation 61 dans sa
version actuelle.
Le Comité a aussi des réserves concernant la recommandation
62 concernant la divulgation des frais, des commissions et autres rémunérations
versés à des employés ou à des tiers. Quelques
témoins ont fait part de leur objection à la proposition
du Groupe de travail. Par exemple, selon Mario Georgiev (Optimum Réassurance),
« [. . .] le Groupe de travail va trop loin dans ses recommandations,
surtout lorsqu'il traite de la divulgation de toute forme de rémunération
qui pourrait être utilisée dans la distribution des produits
financiers ». Le Comité est d'avis que les institutions financières
ne devraient être tenues de divulguer que le type de rémunération,
de salaire, de gratification et de frais versés aux employés
ou aux agents. Il estime que la divulgation des frais, des commissions
et autres rémunérations versés n'est pas de nature
à aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés.
En fait, comme l'a fait valoir l'Association canadienne des compagnies
d'assurance de personnes, dans son mémoire au Comité : «
La meilleure solution [. . .] serait d'assurer que le coût total
du produit soit clairement affiché à l'avance. Il serait
également utile pour le consommateur de savoir si l'intermédiaire
reçoit des honoraires, une commission, un salaire ou une gratification
[. . .] lors de sa souscription. Chercher à dépasser cet
objectif pour expliquer comment les frais de distribution sont répartis
dans le cas d'un canal de distribution donné pourrait s'avérer
tout à fait impossible et risquerait fort d'induire les clients
en erreur. »
Enfin, le Comité rejette la recommandation 63. Si on y donne
suite, la recommandation visant à faire en sorte que la modification
unilatérale des contrats conclus avec les consommateurs soit interdite
par la loi pourrait être préjudiciable aux consommateurs.
D'abord, il est tout à fait légitime pour les entreprises
de revoir à intervalles réguliers leur échelle de
prix et la gamme de services qu'elles offrent. On ne peut pas s'attendre
à ce qu'une entreprise gèle ses prix jusqu'à ce les
consommateurs consentent à une augmentation. Ensuite, les modifications
unilatérales ne sont pas nécessairement néfastes.
On n'a qu'à penser, par exemple, aux nouveaux services (par exemple,
les cartes à puce ou les services bancaires sur PC) offerts sans
frais supplémentaires avec un ensemble de services sur lesquels
on s'est déjà entendu. L'important n'est pas tant d'interdire
la modification unilatérale des contrats, mais de faire en sorte
que les changements soient communiqués intégralement et en
temps opportun (comme le recommande le Groupe de travail dans ses recommandations
57 à 60) pour que les consommateurs puissent prendre la meilleure
décision possible.
Les Canadiens sont très préoccupés par la protection
de leurs renseignements personnels, mais les opinions sont partagées
sur la qualité de la protection de leurs droits à ce titre.
La protection des renseignements personnels revêt un caractère
unique parce, comme l'a noté le Groupe de travail, elle constitue
presque un droit de la personne. Mais elle est aussi un droit économique
au sens où elle définit la capacité des personnes
à décider du genre de relation qu'elles veulent entretenir
avec leur institution financière. Le secteur des services financiers
évolue rapidement et devient plus intégré. À
mesure que de nouveaux produits financiers font leur apparition et que
l'omniprésence des technologies de l'information se précise,
les risques d'utilisation abusive des renseignements personnels se multiplient.
Comme l'a fait valoir le Groupe de travail, « [é]tant donné
que les possibilités d'utilisation illégitime des renseignements
personnels se multiplieront, de même que les incitations à
le faire, il faudra imposer des normes rigoureuses de comportement afin
de préserver l'intégrité de la relation entre les
institutions financières et leurs clients50
». Le Comité est d'accord avec cette observation.
En théorie vous avez beau mettre des fichiers informatiques
séparés, vous avez beau dire que les gens qui vont vendre
de l'assurance vont être physiquement séparés des autres
employés de la caisse, qu'il va y avoir un mur… mais dans une succursale
bancaire, vous allez avoir 10 employés dont 2 qui vendent de l'assurance,
qui ont tous des objectifs de ventes à rencontrer, qui lunchent
ensemble, qui se côtoient 8 heures par jour, la théorie de
mettre des murs, en pratique ne permettra pas de s'assurer que les renseignements
personnels seront réellement gardés de façon confidentielle.
Yvon Charest (vice-président exécutif, chef,
Exploitation, Industrielle Alliance)
Il y a au Canada beaucoup de secteurs où les considérations
relatives à la protection des renseignements personnels peuvent
intervenir. Le secteur des services financiers s'est pour sa part doté
à cet égard de différents codes adaptés à
chaque secteur. Le Québec a lui aussi adopté des mesures
législatives en matière de protection des renseignements
personnels, dont la portée est très générale
et étendue.
Nous pensons que les normes minimales de base qui ont été
définies ne sont pas trop lourdes et qu'elles protègent effectivement
le droit à la protection des renseignements personnels des Canadiens.
Walter Robinson (Fédération des contribuables
canadiens)
Le Comité appuie sans réserve la décision du gouvernement
de légiférer pour imposer des normes à l'égard
de la collecte, de l'utilisation et de la protection des renseignements
personnels. Le projet de loi C-54, intitulé Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques,
s'il est adopté, garantira aux Canadiens que leur droit à
la protection de leur vie privée sera respecté lorsque des
renseignements personnels à leur sujet seront recueillis, utilisés
ou communiqués. Cette mesure législative s'appliquera en
premier lieu aux sociétés assujetties à la réglementation
fédérale. Les dispositions régissant la protection
des renseignements personnels se fondent sur les 10 principes énoncés
dans le code type de l'Association canadienne de normalisation (CSA). Le
projet de loi C-54 devrait être adopté sans délai par
le Parlement. En conséquence, le Comité souscrit aux recommandations
64, 68 et 69.
Avant d'accorder de nouveaux pouvoirs aux banques, nous vous demandons
de veiller à ce qu'elles respectent les lois de ce pays, qu'elles
respectent la vie privée des consommateurs et qu'elles ne portent
pas atteinte à leur liberté de choix en les contraignant
à acheter d'autres produits.
Claude Garcia (président et directeur général,
Compagnie d'assurance Standard Life du Canada)
Le Groupe de travail recommande que le secteur financier soit tenu d'élaborer
d'autres codes sectoriels exécutoires, qui non seulement seraient
conformes aux normes prévues dans la loi, mais iraient au-delà
de celles-ci (voir recommandations 65 à 67). Le Comité souscrit
à l'orientation de ces recommandations. Il souhaite rappeler au
gouvernement que le BSIF ne devrait pas être investi de la responsabilité
de certifier les codes de conduite et de vérifier s'ils sont respectés
(comme le stipule la recommandation 66). Cette tâche devrait plutôt
incomber au nouvel office de protection des consommateurs relevant du nouvel
ombudsman des services financiers.
Pour ce qui est du caractère privé des renseignements
et des droits des consommateurs, je suis personnellement d'accord avec
toute l'argumentation qui vise à donner plus de pouvoirs aux consommateurs.
Les banques sont dans une position de pouvoir et d'influence considérables
face à leurs clients et elles devraient être tenues de rendre
des comptes sur la façon dont elles utilisent ce pouvoir.
Christopher Moon (avocat, Davis Webb Schulze & Moon)
En 1996, les banques à charte canadiennes se sont dotées
d'un ombudsman bancaire canadien. Ses pouvoirs ont été élargis
en 1997 pour englober les services bancaires aux particuliers. La participation
des banques à l'OBC est volontaire et 12 banques en sont actuellement
membres. L'effectif de l'OBC est constitué des ombudsmans désignés
par chaque banque. Le client s'adresse d'abord à l'ombudsman de
l'institution; s'il n'obtient pas satisfaction, il peut faire appel à
l'OBC. L'industrie de l'assurance-vie s'est elle aussi dotée d'un
mécanisme d'ombudsman semblable au mécanisme de recours des
banques.
[N]ous appuyons fortement l'idée de nommer un ombudsman fédéral
des services financiers, d'une personne qui fonctionnerait à l'extérieur
du régime actuel des ombudsmans de banques.
Stephen Johns (président, Conseil canadien des détaillants
de matériaux de construction)
Le Comité est d'accord avec le Groupe de travail et appuie les
recommandations (voir recommandations 76 à 80) selon lesquelles
la législation devrait prévoir la création d'un ombudsman
du secteur financier. Cette entité pourrait agir comme médiateur
et conciliateur pour régler les griefs des consommateurs à
l'endroit de n'importe quelle institution financière fédérale,
pas seulement les banques. Elle fonctionnerait indépendamment des
participants de l'industrie. Avec l'assentiment des provinces, l'ombudsman
pourrait intervenir auprès des institutions financières tant
fédérales que provinciales. On croit que cette solution permettrait
de réduire sensiblement la confusion qui règne chez les consommateurs
et faciliterait l'accès au mécanisme de recours. Ainsi, un
consommateur qui achète une assurance-vie auprès d'une filiale
de fiducie et qui veut déposer une plainte n'aurait pas à
se demander quelle filière emprunter pour obtenir réparation.
L'intégration de l'ensemble des mécanismes de traitement
des plaintes en un seul endroit au service des consommateurs sera un pas
important dans la bonne direction.
Deuxièmement, le Rapport suggère d'élargir le
rôle de l'ombudsman bancaire canadien pour qu'il puisse agir sur
l'ensemble des services financiers. J'appuie pleinement cette recommandation.
De plus, je crois que le rôle de l'ombudsman devrait aussi être
étendu à tout le champ de la protection des consommateurs
et non pas seulement à la médiation de problèmes individuels.
Ainsi, je suggère que l'ombudsman s'occupe des questions de transparence
des contrats et de normes d'accès aux services financiers.
Jean Roy (professeur agrégé de finance, École
des Hautes Études Commerciales (à titre personnel))
Jean Roy, des HEC, soutient que « le rôle de l'ombudsman
devrait aussi être étendu à tout le champ de la protection
des consommateurs et non pas seulement à la médiation de
problèmes individuels ». Le Comité est tout à
fait d'accord avec cette affirmation. En conséquence, en ce qui
a trait au mandat du nouveau poste, le Comité recommande que le
nouvel ombudsman ait la responsabilité de veiller à la protection
du consommateur et de s'assurer du respect des exigences en la matière.
L'office de protection des consommateurs nouvellement créé
devrait aussi relever de ce bureau.
Le Groupe de travail recommande la création d'une organisation
de consommateurs de services financiers. Il croit qu'un groupe de défense
pourrait inciter les consommateurs à être plus vigilants.
Le Comité estime qu'une telle organisation serait profitable mais
qu'elle ne devrait pas être financée par le gouvernement.
À la place, nous croyons qu'Industrie Canada devrait étudier
les différents modèles existants pour assurer le financement
d'organisations semblables, notamment la diffusion d'information relative
aux groupes de défense des consommateurs au moyen d'encarts postaux.
Enfin, le Comité est d'accord avec les recommandations du Groupe
de travail concernant les normes de compétence (recommandations
81 à 86). À mesure qu'évolue le rôle d'intermédiaire
financier, la notion d'organisme de réglementation unique chargé
d'harmoniser les normes de compétence d'un territoire de compétence
à l'autre devient plus attrayante. La province de Québec
s'est déjà engagée dans cette voie.
En conclusion, le Comité tient à réitérer
que l'un des défis qui se pose à notre gouvernement réside
dans la façon d'accroître le pouvoir du consommateur dans
un monde en constante évolution. Au moment de donner suite aux recommandations
53 à 55, il faut prendre garde de ne pas imposer un fardeau trop
lourd au secteur des services financiers ou compromettre sa capacité
de s'adapter aux réalités changeantes. Il faut parvenir à
un juste équilibre, car une réglementation trop contraignante
risquerait de diminuer la concurrence et la compétitivité.
CHAPITRE 7 : COMPORTEMENT DES ENTREPRISES ET ATTENTES DES CANADIENS
Tous les jours, les clients des institutions financières effectuent
des millions de transactions : renouvellement de la marge de crédit
d'une PME, dépôt d'un chèque au guichet automatique,
paiement d'un compte, dépôt de nuit, change en devises étrangères,
paiement direct à l'épicerie, etc.
Tous les jours, des millions de Canadiens se considèrent bien
servis, à un prix raisonnable, grâce à l'accès
à une vaste gamme de services. Selon les données présentées
au Groupe de travail, 91 % des clients des banques sont satisfaits et 67
% n'ont pas changé d'institution financière depuis 5 ans51.
Les frais mensuels sont nettement inférieurs à ceux qui sont
imposés aux États-Unis ou en Suède, par exemple52.
Les consommateurs canadiens jouissent d'un écart moins grand entre
les taux d'intérêt des prêts personnels et des hypothèques53.
Tous ces résultats satisfaisants peuvent être contestés
par d'autres données, anecdotiques notamment. Le Comité s'est
fait dire à maintes reprises que de nombreux Canadiens à
faible revenu ont difficilement accès aux services financiers de
base et que bien des propriétaires de PME ont du mal à trouver
du financement. Les études réalisées pour le Groupe
de travail révèlent que seulement 29 % des répondants
estiment que les services fournis par les banques étaient de qualité
de bonne à excellente54.
D'autres données indiquent que 44 % des clients des banques pensent
que les frais des services sont injustes55.
Les écarts entre les taux d'intérêt sont plus grands
au Canada qu'aux États-Unis56.
Il existe certainement des secteurs où le comportement des entreprises
est jugé sévèrement et où les attentes des
consommateurs ne sont pas comblées. Voilà pourquoi le Groupe
de travail recommande des mesures pour corriger les difficultés
que de nombreux Canadiens rencontrent dans leurs rapports quotidiens avec
les institutions financières. Le Comité estime que le secteur
des services financiers doit répondre à des attentes plus
élevées que d'autres secteurs de l'économie. Il doit
répondre aux besoins des petites entreprises (y compris des micro-entreprises)
et des entreprises de risque du secteur du savoir technologique. Le Comité
considère également qu'il est important que tous les Canadiens
aient accès à un vaste choix de services financiers de qualité,
à un prix raisonnable.
Ces obligations des sociétés financières se justifient
par le fait qu'elles jouent un rôle spécial dans notre économie.
Que ce secteur ne constitue pas une industrie ordinaire, les politiques
du gouvernement le reconnaissent depuis longtemps57.
Cependant, le Comité tient à souligner que les institutions
financières ne sont pas des compagnies de services publics, dont
une bonne partie de l'activité commerciale doit être réglementée.
Ce ne sont pas des monopoles naturels, contrairement à bien des
services publics comme par le passé. Elles fonctionnent dans un
environnement qui les soumet à la concurrence. En outre, le Comité,
tout comme le Groupe de travail, tient à favoriser la concurrence
sur le marché. La réglementation des services publics est
tout à fait incompatible avec un contexte aussi concurrentiel.
Le Groupe de travail a formulé plusieurs grandes recommandations
sur le financement des PME, des entreprises fondées sur le savoir
et des entreprises autochtones.
Les PME jouent un rôle majeur dans l'économie : 75 % des
entreprises canadiennes comptent moins de 5 employés et 97 %, moins
de 50. On a démontré que les très petites entreprises
sont celles qui ont créé de l'emploi de la façon la
plus constante depuis 10 ans. En 1996, elles auraient créé
87 % des emplois. Les PME représentent plus de la moitié
de l'emploi dans le secteur privé et totalisent 43 % du PIB.
Les coopératives de crédit et les caisses populaires
qui, en 1933 et en 1964, avaient une part négligeable du financement
des PME, représentaient en 1996 près de 15 % des crédits
à ses entreprises.
Les banques détiennent 38 % du crédit commercial total.
Elles dominent le marché des prêts aux entreprises, avec 84
%58.
Parmi tous les services bancaires aux entreprises, les prêts aux
PME sont parmi les plus rentables. On estime qu'en 1997 ces prêts
ont engendré 1,3 milliard de dollars de profits et produit un rendement
entre 10 et 15 %.
Les sociétés de financement spécial ont enregistré
une croissance rapide au cours des dernières années, de sorte
qu'elles détiennent maintenant environ 16 % du marché du
financement par emprunt des PME, contre 9 % en 1994.
Les banques ont tenté, et tentent toujours, de répondre
aux critiques des PME concernant l'accès aux capitaux. Elles ont
instauré des mesures qui visent non seulement les PME, mais aussi
les industries du savoir. La Banque de Montréal offre un crédit
non garanti de 50 000 $ dans un délai de 24 heures; la CIBC consent
des prêts de 15 000 $ à 100 000 $ à 1 % de moins que
le taux préférentiel; la Banque TD possède de 13 centres
bancaires spécialisés dans les industries du savoir et offre
un programme de prêts pour la technologie avancée; la Banque
Royale dispose de spécialistes de l'industrie du savoir et offre
un fonds de risque pour les petites entreprises; la Banque Scotia a un
programme de prêts pour le secteur de l'innovation et de la croissance
de 50 millions de dollars. Le Comité convient que les mesures prises
sont importantes, mais que les institutions doivent faire davantage.
En fait, le Comité s'est fait dire à maintes reprises
que les institutions financières serviraient mal les PME. On se
plaint généralement de l'accès au financement bancaire
et au capital en général, y compris au financement par capitaux
propres59.
Il semble y avoir un vide qui n'est pas comblé par les institutions
financières classiques. En examinant la pléthore de programmes
fédéraux et provinciaux créés pour financer
les PME, on constate l'ampleur des besoins financiers qui ne sont pas comblés
par le secteur privé. Au fédéral seulement, on trouve
une longue liste de mesures60.
Le gouvernement et le secteur des services financiers devraient être
en mesure de mieux évaluer les besoins financiers des petites entreprises.
L'arrivée récente de la Wells Fargo est également
symptomatique du fait qu'un segment du marché est mal servi. Cette
institution financière de San Francisco offre des services de qualité
adaptés aux PME canadiennes en utilisant un modèle exclusif
d'évaluation du risque. Les scores de crédit qu'il décerne
permettent d'autoriser un prêt en 15 minutes. Par marketing direct,
la Wells Fargo offre actuellement des lignes de crédit préapprouvées
jusqu'à 50 000 $.
À part des faits anecdotiques, rien ne permet de mesurer concrètement
les difficultés des PME à obtenir du crédit. On convient
que celles-ci sont moins susceptibles que les grandes entreprises de demander
du financement, et plus susceptibles de devoir fournir des nantissements
sur leurs emprunts, de payer des intérêts plus élevés
et de se voir refuser des demandes de prêt. Cependant, comme le Groupe
de travail l'a observé, on manque de données pour orienter
clairement les mesures à prendre. Par conséquent, le Comité
appuie les recommandations 101, 105 et 106, destinées précisément
à combler ce vide de données.
Les relations entre les banques et les PME sont loin d'être idéales.
Comme l'indique le Rapport du Groupe de travail, les chargés de
prêts doivent gérer de gros volumes d'emprunteurs et traiter
de nombreuses demandes de prêts. À cause du cheminement de
carrière imposé par la culture des banques, les chargés
de prêts sont souvent mutés dans une autre succursale ou un
nouveau service. Une étude récente révèle que
60 % des PME avaient traité avec plus d'un directeur de comptes
depuis 3 ans. Le Comité estime que ce taux de roulement rapide de
personnel empêche les PME d'établir une relation personnelle
et forte avec la banque; il endosse donc la recommandation 102 du Rapport
du Groupe de travail.
Devant le Comité, le P.D.G. de la Banque Royale du Canada a annoncé
la création d'une nouvelle filiale au service des PME. Le Comité
ne peut qu'applaudir à des initiatives de ce genre qui peuvent créer
des relations plus fortes entre les emprunteurs et leurs institutions financières.
Cela devrait également décentraliser les décisions
touchant le crédit, dans le sens de la recommandation 10 3
du Groupe de travail.
Les taux des prêts accordés aux PME au Canada se situent
pour la plupart entre le taux de base et le taux de base plus 3 %, la moyenne
étant de 1,75 % au-dessus du taux de base. Aux États-Unis,
la fourchette est beaucoup plus large, pouvant aller du taux de base au
taux de base majoré de 8 %, avec un moyenne de 3,25 % au-dessus
du taux de base. Cette fourchette plus étroite au Canada signifie
peut-être que les banques canadiennes ne tiennent pas bien compte
du risque dans l'établissement des taux, ce qui pourrait se répercuter
sur l'accessibilité du crédit pour les PME.
En plus de la hiérarchie dans les banques, l'attitude de ces
dernières face au risque nuit également à l'accès
des PME aux capitaux. Les prêts aux petites entreprises sont souvent
consentis à un taux supérieur de 3 % au taux préférentiel.
Le problème est résumé clairement par Terry Norman,
de la Chambre de commerce du Grand Halifax : « Si le prêt est
considéré plus risqué, on préfère le
refuser plutôt que l'accorder à un taux supérieur,
comme cela est courant aux États-Unis. » Voilà pourquoi
les propriétaires de petites entreprises sont souvent contraints
d'utiliser leur carte de crédit personnelle ou l'hypothèque
sur leur maison principale pour se financer. Par ailleurs, la Wells Fargo
offre en ce moment des prêts au taux préférentiel plus
8 % et trouve preneurs. Plutôt que de refuser du crédit aux
emprunteurs qui sont prêts à payer une prime de risque, les
institutions financières devraient servir ce marché avec
des prêts à un taux convenable. Le Comité endosse la
recommandation 104 qui va dans ce sens.
L'une des recommandations concrètes du Rapport MacKay concernant
le financement des petites entreprises, pour les aider directement, est
que les prêteurs devraient être disposés à offrir
des programmes de financement plus innovateurs à des prix appropriés
pour les emprunteurs à risque élevé qui, actuellement,
ne peuvent probablement pas obtenir de financement. Selon mon expérience,
cela constitue une déclaration plutôt naïve puisque dans
tous les cas à risque élevé, il n'y a pas de prix
approprié qui permette de couvrir le ratio de perte et le coût
de l'administration.
Christopher Moon (avocat, Davis Webb Schulze & Moon)
Les développements technologiques rapides transforment l'économie
canadienne. Nous sommes en train de passer d'une économie fondée
sur les ressources à une économie du savoir, où les
connaissances seront la clé du succès, dans un pays offrant
un haut niveau de vie à ses citoyens. Les compétences, l'innovation,
l'invention, la technologie, la R-D et l'entrepreneurship sont les moteurs
de cette nouvelle économie. L'industrie du savoir ne dispose pas
d'actifs physiques, mais humains. En général, les institutions
financières se défient de ces entreprises pour cette raison,
et parce que le cycle de développement de leurs produits est très
long. Ces entreprises comptent donc davantage sur le nantissement que sur
un fond de roulement. L'industrie du savoir présente des problèmes
de financement très particulier. Ici encore, Terry Norman, de la
Chambre de commerce du Grand Halifax, résume très bien le
problème : « La plus grande partie de la croissance des PME
est le fait des entreprises du savoir, qui ont des besoins de financement
non traditionnels. Une bonne part des actifs de ces entreprises rentre
le soir à la maison se coucher. Il faut donc abandonner les prêts
basés sur les actifs pour des prêts basés sur les flux
d'encaisse, avec une connaissance poussée du marché. Dans
certains cas, il faut également des prêts facturés
en fonction du risque, ce qui est contraire à la pratique des six
grandes banques à charte. » Le Comité appuie les recommandations
106 à 108.
Le Groupe de travail formule des recommandations précises qui
devraient faciliter l'accès des Autochtones et de leurs institutions
au crédit, même si certaines institutions financières
ont déjà pris des initiatives importantes à cet égard.
Ainsi, la Banque de Montréal a fondé un programme bancaire
autochtone en 1992. Elle exploite aujourd'hui des centres bancaires dans
16 villages autochtones partout au Canada. Elle a annoncé plus tôt
cette année, qu'en collaboration avec Postes Canada, elle allait
étendre ce service dans 20 autres localités éloignées.
La Banque TD a établi une coentreprise avec la Saskatchewan Equity
Foundation et a créé la Banque des Premières nations.
Des mesures importantes comme celles-là ont eu un effet positif
sur la vie des Autochtones, le Comité endosse les recommandations
109 à 111.
[Pour avoir accès à des services bancaires personnalisés,
il faut d'abord avoir accès à une banque, puis accès
à un compte bancaire. Le Groupe de travail a constaté qu'il
y avait effectivement un problème, car 600 000 Canadiens n'ont pas
de compte bancaire, soit 3 % de la population adulte.
Serge Cadieux (Syndicat Banque Laurentienne, Coalition québécoise
pour le maintien des emplois et services bancaires personnalisés)
Des groupes comme Options Consommateurs, à Montréal, ont
montré clairement comment certaines personnes parmi les plus vulnérables
de la société n'ont absolument aucun accès aux services
financiers de base. Ainsi, elles ont de la difficulté à ouvrir
un compte en banque ou à encaisser des chèques d'aide sociale.
En 1997, 3 % des Canadiens adultes ne détenaient pas de compte en
banque; ce taux dépassait 5 % en Colombie-Britannique et dans les
Maritimes. Au total, 8 % des adultes appartenant à des ménages
dont le revenu annuel est inférieur à 25 000 $ n'ont pas
de compte en banque de base. Ce phénomène est attribuable
à l'exigence des pièces d'identité et au fait que
les créditeurs peuvent saisir les fonds déposés dans
un compte de banque. Des milliers de Canadiens doivent donc compter chaque
semaine sur les services de compagnies d'encaissement de chèques
comme Money Mart.
Quatre-vingt-quatorze pour cent des Canadiens estiment qu'il est
nécessaire pour les particuliers d'avoir un compte d'épargne
ou de chèques. Plus de la moitié (51 %) estiment que cela
est « absolument nécessaire. . . »
Ceux qui disposent d'un compte en banque voient leurs dépôts,
y compris les chèques du gouvernement, retenus de 5 à 7 jours
par les institutions de dépôts. Même si les grandes
banques à charte ont convenu avec le gouvernement, en 1997, d'un
nouveau régime pour faciliter l'accès des Canadiens à
faible revenu aux comptes et aux services d'encaissement de chèque,
il semble que très peu de progrès ait été réalisé.
Nous pensons que l'accès aux services bancaires de bases devrait
être garanti et devrait être un droit pour tous les Canadiens.
Malheureusement, le Groupe de travail a dit que les banques devraient prendre
un certain nombre de mesures, mais qu'il allait leur accorder plus de temps.
Des groupes de citoyens, des groupes de lutte contre la pauvreté
et des groupes de consommateurs exercent des pressions depuis plus de 10
ans et essaient d'obtenir que les banques servent équitablement
tous les Canadiens, et ce, à un prix équitable.[. . .] Donnez
à tous les Canadiens le droit d'avoir un compte bancaire. Exigez
des banques qu'elles donnent accès aux services bancaires de base.
Duff Conacher (président, Coalition canadienne pour
le réinvestissement communautaire, et coordonnateur, Démocratie
en surveillance)
Le Groupe de travail soutient que ce sont des problèmes de mentalité
et de culture qui empêchent ici le progrès. Il affirme que
les Canadiens à faible revenu ne sont pas perçus par les
institutions financières comme des clients valables. Même
si la rentabilité était en cause, les institutions canadiennes
ne devraient refuser à personne, quelle que soit sa condition socio-économique,
l'accès aux services financiers de base à un prix raisonnable.
Comme tous les témoins entendus à ce sujet, le Comité
est d'accord avec les recommandations 88 à 92. Cependant, sur la
recommandation 90a) voulant que le gouvernement fournisse une pièce
d'identité personnelle, le Comité préconise la prudence,
étant donné les abus et les fraudes possibles. On n'a qu'à
penser aux critiques récentes du Vérificateur général
concernant les numéros de carte d'assurance sociale. Il faudrait
étudier davantage la question avant de se lancer dans l'émission
de cartes d'identité aux citoyens.
Si certains s'imaginent qu'en règle générale
la plupart des petites entreprises peuvent effectuer leurs transactions
bancaires courantes par voie électronique, ils se trompent sérieusement.
[. . .] Les détaillants comprennent les possibilités croissantes
de la technologie. Ils savent aussi que la technologie est loin de pouvoir
remplacer de façon suffisante et complète les services offerts
par les succursales locales d'institutions financières concurrentes.
Diane J. Brisebois, (présidente, Conseil canadien
du commerce de détail)
Les fermetures de succursales pénalisent avant tout les personnes
âgées, les petits villages, les petites entreprises et les
personnes à faible revenu. Les édifices proprement dit, si
importants il y a quelques années, sont moins indispensables aujourd'hui.
Les transactions électroniques, rendues possibles par les guichets
automatiques, le téléphone et l'ordinateur personnel ont
bouleversé notre relation avec les institutions financières.
Dans quelques années, nous devrions être capables de télécharger
de l'argent sur nos cartes à puce, à l'aide d'un téléphone
public ou d'un ordinateur personnel. Nul doute que de plus en plus de succursales
fermeront leurs portes, car les transactions bancaires évoluent
vers le recours à des modes de fonctionnement moins coûteux
que les modes classiques.
Nous avons donc été ravis de voir que le Groupe de
travail recommandait que les institutions financières s'engagent
à fournir un accès général à des services
bancaires de base.
Andrew Bolter (directeur, Life Spin - Women's Resource Centre)
Le Comité convient que les institutions financières devaient
être obligées de donner un préavis de fermeture d'une
succursale à la population touchée. Il appuie donc la recommandation
93.
Nous [. . .] travaillons [sur la question du microcrédit,
et] nous espérons pouvoir prendre un engagement ferme en ce qui
concerne une nouvelle approche à l'égard du microcrédit
dans le futur. Et ce n'est pas qu'une vague promesse, nous allons nous
y engager et nous occuper de cette question dans le document portant sur
l'évaluation de l'intérêt public.
Matthew W. Barrett (président et chef de la direction,
Banque de Montréal)
Depuis plusieurs années, la fondation Calmeadow expérimente
des modalités de crédit au profit de personnes qui ont besoin
de très petites sommes pour se créer un emploi. On peut considérer
le microcrédit comme une façon d'accroître l'emploi
autonome chez les Canadiens dont les besoins financiers sont trop modestes
pour intéresser les institutions financières traditionnelles.
Même si ces prêts ont un coût de traitement qui peut
fort bien dépasser le rendement escompté, ils ont un potentiel
énorme pour le développement social et individuel. Le Comité
s'est fait dire par des groupes comme l'Association communautaire d'emprunt
de Montréal que les besoins d'emprunt dont on parle vont de 2 000
$ à 20 000 $. « Mais il y a 20 % de la population qui n'a
pas accès au crédit dans les institutions financières
classiques. Ce sont des gens qui vivent dans la pauvreté, mais ils
ont quand même de bonnes idées. Comment peuvent-ils avoir
accès au crédit? Des institutions comme l'Association communautaire
d'emprunt de Montréal permettent d'y parvenir. » Le Comité
estime qu'il faut encourager des initiatives de ce genre; il appuie les
recommandations 94 à 97.
Il y a un point au sujet de l'accès au microcrédit
que nous aimerions ajouter à ce que dit à ce sujet le Rapport
en question; tant au Canada, aux États-Unis que dans les pays en
développement, les programmes d'accès au microcrédit
ont donné de meilleurs résultats lorsqu'ils étaient
reliés à d'autres genres de services, comme la formation
en gestion des petites entreprises ou les conseils techniques.
Peter Nares (directeur exécutif, Self Employment Development
Initiatives)
Les institutions financières sont actives dans leur milieu. Ainsi,
les cinq grandes banques ont été les cinq plus grandes entreprises
à contribuer aux causes philanthropiques au Canada en 1997, avec
des dons dépassant 78 millions de dollars à l'échelle
du pays61.
En plus de cela, les institutions financières et leurs employés
donnent de leur temps et jouent un rôle dominant dans les activités
communautaires. La Table ronde du secteur bénévole relève
plusieurs mécanismes nouveaux permettant de bâtir une société
plus solidaire et plus compatissante; ces mécanismes devraient être
considérés par le gouvernement et le secteur financier. Le
Comité suggère donc aux dirigeants des institutions financières
et du secteur bénévole d'envisager de nouveaux partenariats
comme le suggère la recommandation 98. Ces nouvelles mesures pourraient
améliorer sensiblement le sort de nos collectivités.
Les institutions financières ne donneront pas d'argent sans
être eccouragées à le faire, car il y a de fortes chances
que certaines entreprises ne survivent pas.
Roger Snelling (membre du conseil d'administration, Association
des prêts communautaires de Montréal)
Comme le Groupe de travail MacKay, le Comité s'est fait dire
par la Coalition canadienne pour le réinvestissement communautaire
que le Canada devrait adopter une loi semblable à la Community
Reinvesment Act (CRA) qui s'applique aux banques aux États-Unis.
Aux États-Unis, la demande de réinvestir dans le milieu
émane du mouvement des droits civiques de la fin des années
60 et du début des années 70. Bien des banques et des institutions
d'épargne et de crédit avaient exclu de leur activité
les vieux quartiers urbains. Dans certaines villes, on encerclait littéralement
de rouge sur une carte certains quartiers pauvres où les banques
acceptaient les dépôts mais refusaient délibérément
de prêter de l'argent aux entreprises ou aux personnes, à
cause de la faiblesse du rendement attendu.
Par conséquent, le Congrès américain a adopté
en 1975 le Home Mortgage Disclosure Act, baptisé à
l'origine Financial Institutions Reporting Act. Les institutions
financières étaient tenues de divulguer à quel endroit
elles consentaient des prêts. La loi a entraîné
un mouvement de réinvestissement. En 1977, les milieux sociaux sont
allés plus loin encore et ont exigé, en plus de la divulgation
des chiffres, l'obligation de réinvestir dans les quartiers défavorisés.
La CRA impose aux prêteurs l'obligation légale de servir toute
la population et de répondre aux besoins du milieu où ils
font affaire.
La loi américaine oblige notamment les institutions financières
à faire la preuve qu'elles rejoignent tous les segments du marché
local du crédit, et qu'elles répondent aux besoins de crédit
de toute la population, y compris les personnes à revenu moyen et
faible, sans pour autant compromettre leur solidité financière.
Elle ne force pas les institutions à prêter à des mauvais
créanciers en recourant à des quotas ou à des affectations
obligatoires de crédit. Le respect de la CRA par les institutions
financières est jugé par quatre organismes fédéraux.
Les institutions prêteuses sont évaluées aux 18 ou
24 mois sur des critères comme la répartition géographique
des prêts et l'investissement et les services dans les milieux servis.
Le gouvernement américain est tenu de considérer le respect
de la CRA lorsqu'il doit prendre la décision d'autoriser ou non
des fermetures de succursales, des acquisitions, des fusions ou des applications
de la charte. Il compte sur les rapports et sur la divulgation des données
pour encourager les institutions financières à prêter
du capital dans les zones défavorisées. La crainte de voir
une demande refusée pour infraction à la CRA est le principal
incitatif de la loi.
Inspirée par l'expérience américaine, la Coalition
canadienne pour le réinvestissement communautaire affirme que les
institutions financières canadiennes devraient rendre davantage
de comptes afin de mieux répondre aux besoins des milieux locaux.
Elle recommande l'adoption d'une loi semblable par le Canada.
Le Comité n'appuie pas cette démarche. D'abord, dans ce
secteur en évolution constante, il serait très difficile
et très coûteux d'appliquer cette loi. La nouvelle structure
de beaucoup d'institutions financières (holdings financiers) retirera
les actifs des filiales bancaires traditionnelles, réduisant du
même coup le champ d'application de la CRA. Dans le secteur financier
de demain, de nombreuses activités bancaires ne seront plus le fait
des institutions traditionnelles et ne concerneront plus les produits traditionnels.
On n'a qu'à voir les milliards de dollars que les Canadiens versent
chaque année dans les fonds mutuels et les portefeuilles d'actions.
Deuxièmement, les critères du classement satisfaisant seraient
subjectifs et arbitraires; en outre, comme le phénomène de
convergence viendrait brouiller les cartes, ce classement traiterait injustement
les concurrents. Troisièmement, le premier effet du règlement
serait d'accroître le coût des transactions, en particulier
pour les petites institutions et celles qui fonctionnent dans les quartiers
défavorisés. Quatrièmement, en voulant bien paraître,
les institutions financières pourraient adopter des comportements
complaisants et choisir des pratiques bancaires inacceptables. Ces investissements
moins qu'optimaux pourraient mettre en péril la solidité
et la solvabilité de certaines succursales. Par conséquent,
des succursales pourraient fermer dans les quartiers déjà
mal servis. Contrairement à ce qui se fait aux États-Unis,
rien n'indique que nos institutions financières refusent systématiquement
le crédit dans les quartiers pauvres. Au Canada, aucune plainte
sérieuse n'a été portée à l'attention
des autorités à ce sujet.
En outre, le secteur bancaire et le contexte social du Canada et des
États-Unis sont très différents. Nous avons des institutions
nationales, ils ont des institutions locales. Les villes canadiennes ne
sont pas rongées par le cancer qui caractérise tant de vieux
quartiers de villes américaines. Par conséquent, le Comité
convient avec le Groupe de travail qu'il n'est pas nécessaire d'adopter
une loi comme la CRA au Canada.
Ce qui précède ne veut pas nécessairement dire
que les institutions financières ne devraient pas être plus
transparentes. Le Groupe de travail reconnaît également que
nos institutions financières doivent être plus responsables
envers les collectivités qu'elles servent. Pour y arriver, il recommande
(recommandation 99) que les institutions de dépôts et les
compagnies d'assurance-vie réglementées au niveau fédéral
soient tenues par la loi de produire des rapports sur les responsabilités
envers la collectivité. Ces rapports feraient état des contributions
de l'institution financière au milieu : oeuvres philanthropiques,
investissement dans le développement communautaire, emplois créés,
impôts versés à tous les paliers de gouvernement, participation
des employés aux activités communautaires. Ces rapports seraient
communiqués chaque année au ministre des Finances et déposés
également devant le Comité permanent des finances de la Chambre
des communes.
Le Comité n'est pas d'accord avec le volet légal de cette
recommandation. D'abord, l'exigence légale alourdirait sensiblement
le fardeau réglementaire déjà imposé aux institutions
financières. Il y aurait des coûts supplémentaires,
en particulier pour les petites institutions et les nouveaux venus. Edmund
Clark, du Canada Trust, s'oppose vigoureusement au rapport sur les responsabilités
en ces termes : « [le] règement favorise les grandes institutions
financières aux dépens des petites, et pourtant, ce sont
les petites qui fournissent la concurrence dont profite le consommateur.
. . » Dans son mémoire, l'Association canadienne d'assurance-santé
et d'assurance-vie affirme : « L'industrie s'inquiète néanmoins
du fait que cette exigence pourrait devenir un règlement lourd et
coûteux d'application, alors qu'on cherche déjà à
simplifier et à réduire la lourdeur administrative des nombreux
rapports qu'on exige déjà de l'industrie.
Deuxièmement, la loi pourrait limiter la transparence et la participation
à la vie communautaire. Ainsi, Edmund Clark ajoute, dans son témoignage,
qu'une loi exigeant des rapports sur les responsabilités envers
la collectivité retirerait la responsabilité morale du DG
de l'institution envers la population. Il affirme que le PDG ne devrait
rien de plus à la société au-delà de ce qu'exige
la loi : « Dites-nous seulement ce qu'il faut faire et nous le ferons.
»
Troisièmement, comment définir la collectivité?
A-t-elle rapport à la présence d'une succursale dans un quartier,
à un code postal, à la distribution géographique des
clients? Une succursale située dans un parc industriel devrait-elle
déposer un rapport? Comment une banque virtuelle, comme ING, la
Citizens Bank ou mbanx, définit-elle sa collectivité locale?
Quatrièmement, comme on l'a déjà dit, les fonctions
bancaires d'aujourd'hui sont déjà très différentes
de celles d'il y a quelques années, et elles continueront de changer.
Les institutions à produits uniques exploitées de l'étranger,
comme la Wells Fargo ou la Countrywide Credit, devraient-elles être
obligées de remplir un rapport? Le secteur bancaire traditionnel
sera-t-il le seul à répondre à cette exigence? Comme
l'a dit Jean Roy, de l'École des Hautes Études Commerciales:
« [I]l faut réaliser qu'il y a un potentiel de mettre
les grandes institutions canadiennes dans une situation difficile puisque,
d'une part, on leur demande de jouer un rôle social et, d'autre part,
le nouvel environnement financier risque de les mettre en compétition
avec divers types de sociétés de financement qui n'auront
pas à remplir de telles obligations. »
Enfin, on ne sait pas très bien ce que le Comité permanent
des finances de la Chambre des communes devrait faire de ces rapports.
Avec des milliers de rapports à examiner sur les responsabilités
envers la collectivité, il est peu probable que la démarche
d'examen public suggérée par le Groupe de travail soit efficace.
Et finalement, les banques canadiennes doivent répondre à
l'attente grandissante des Canadiens qui veut que les compagnies de services
financiers fournissent des appuis tangibles aux communautés et poursuivent
plus de partenariats avec les communautés clientes.
John Cleghorn (président et chef de la direction,
Banque Royale du Canada)
Le Comité s'oppose aux recommandations 99 et 100. Il croit qu'il
faut continuer à encourager les mesures volontaires, plutôt
que de créer un nouveau règlement. Il estime qu'il est dans
le meilleur intérêt du secteur des services financiers de
participer à la vie communautaire, et de le faire d'une façon
qui réponde aux besoins de cette communauté. Les institutions
financières, dans de telles circonstances, voudront rendre des comptes
sur leurs activités. Cela relève des bonnes pratiques commerciales,
et les institutions financières n'ont pas besoin d'un Comité
parlementaire pour leur en suggérer.
1 Bien
que cette transaction it relativement récente, elle n'exigeait aucune
modification de la législation fédérale.
2 Sans
dépasser l'ensemble des dépôts bancaires, les sommes
investies dans des fonds communs de placement dépassent maintenant
le montant total des dépôts personnels en banque.
3 Boston
Consulting Group, Financial Services at the Crossroads, janvier
1997.
4 Ibid.,
p. 24.
5 Bien
que les produits dérivés leur permettent d'assumer de nouveaux
types de risque, les investisseurs le paient par des taux de rendement
légèrement inférieurs à ce qu'ils pourraient
obtenir s'ils investissaient directement.
6 Groupe
de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien, Document
de discussion, juin 1997, p. 5.
7 McKinsey
& Company, L'évolution du secteur des services financiers
au Canada : De nouvelles forces, de nouveaux compétiteurs, de nouveaux
choix, Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers
canadien, pièce 7-10.
8 McKinsey
& Company. « L'évolution du secteur des services financiers
au Canada », Document de recherche préparé pour
le Groupe de travail, septembre 1998, pièce 5.13.
9 Concurrence,
compétitivité et intérêt public, Document
d'information no 1, p. 16.
10
Ce chiffre est une estimation pour 1998. Voir : CIBC, Why Customer Choice
and Canadian Ownership Matter, octobre 1997. Dans le document de recherche
rédigé par McKinsey & Company pour le compte du Groupe
de travail « L'évolution du secteur des services financiers
au Canada », les transactions bancaires dans les succursales ont
représenté 21 % du total.
11
À en juger par la diapositive « La redistribution des transactions
de succursales aux modes de prestation de remplacement se poursuivra au
Canada » dans le document de recherche produit par Ernst & Young
pour le compte du Groupe de travail intitulé L'adoption des nouvelles
technologies par les institutions financières du Canada (septembre
1998), on pourrait conclure que c'est déjà la solution d'hier.
12
Transferts électroniques de fonds au point de vente.
13
En règle générale, les usagers n'économisent
pas grand-chose en utilisant un guichet automatique ou les services bancaires
par téléphone au lieu de faire affaire dans une succursale.
Ils profitent cependant du fait que ces canaux sont beaucoup plus pratiques.
Voir McKinsey & Company, pièce 6-29.
14
Les ménages ne contrôlent que partiellement la distribution
de leurs actifs financiers et n'ont en général aucun contrôle
sur leurs avoirs sous la forme de régimes de pension institutionnels.
Les ménages détiennent maintenant 45 % de leurs avoirs discrétionnaires
sous une forme à long terme. Cette proportion devrait passer à
60 % dans les 10 prochaines années, ce qui témoignerait d'une
désaffectation encore plus grande vis-à-vis des dépôts.
15
On peut concevoir, par exemple, qu'en faisant leurs transactions bancaires
sur Internet, les consommateurs canadiens puissent avoir accès aux
services d'établissements financiers étrangers qui offrent
les produits qu'ils cherchent (dépôts, prêts, assurances
et fonds mutuels) à un seul endroit. Si les institutions canadiennes
n'étaient pas autorisées à faire de même, elles
ne seraient pas compétitives, alors que les Canadiens profiteraient
quand même de la concurrence. L'inverse pourrait être également
vrai. Certains pays ont une politique de création de « champions
nationaux », c'est-à-dire des établissements nationaux
qui sont aussi d'importants acteurs sur la scène mondiale. Ils y
arrivent par des fusions qui ont pour résultat de créer des
marchés intérieurs hautement concentrés. Si le marché
intérieur comporte des barrières qui le rendent inattaquable,
cette forte concentration pourrait aboutir à une baisse de la concurrence
intérieure. Il y a des pays dont les politiques « sacrifient
» la concurrence intérieure au profit d'une compétitivité
accrue de leurs institutions nationales sur le marché international.
16
À 18 $ par mois pour un « bouquet » de services habituel,
les frais bancaires exigés des PME au Canada se situent à
mi-chemin entre les tarifs inférieurs qu'on trouve en Europe et
les tarifs pratiqués aux États-Unis. (Document d'information
no 1, p. 82.)
17
Comité permanent des finances de la Chambre des communes, Témoignages,
29 septembre 1998, fascicule 116, p. 27.
18
« Rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises
», soumis au ministre des Finances en décembre 1997, p. 6.25.
19
« Souplesse d'organisation des institutions financières :
un cadre d'intensification de la concurrence », Document d'information
no 2, p. 77 à 81.
20
Ibid., p. 111.
21
E.P. Neufeld et H. Hassanwalia, « Challenges for the Further Restructuring
of the Financial Services Industry in Canada », dans G.M. von Furstenberg,
The Banking and Financial Structure in the NAFTA Countries and Chile,
Kluwer Academic, Boston, 1997, graphique 12.
22
Ibid., graphique 13.
23
Les commissions, exprimées en proportion du volume des transactions
à la Bourse de Toronto et à la Bourse de Montréal,
sont passées de 1,6 % en 1987 à moins de 1 % en 1995. C'est
durant cette période que les banques ont pris une position dominante
dans le secteur des valeurs mobilières. (Groupe financier de la
Banque Royale, Three C's of Canadian Banking: Conduct, Competition,
Concentration, février 1996.)
24
Coopers & Lybrand, « L'industrie de l'assurance générale
», Rapport de recherche produit pour le compte du Groupe de travail
sur l'avenir du secteur des services financiers canadien, p. 33.
25
DesRosiers Automotive Consultants Inc., Rapport sur l'élargissement
des pouvoirs des banques à la location-bail de véhicules
légers, p. 15-16.
26
Les prêts bancaires comptent maintenant pour 34 % de l'endettement
des entreprises, contre 44 % il y a 10 ans (Rapport, p. 53).
27
En 1991, les dépôts bancaires des particuliers totalisaient
216,5 milliards de dollars et représentaient 4,3 fois les sommes
placées dans des fonds communs de placement. En 1997, les dépôts,
de 290,3 milliards de dollars, ne représentaient plus que 1,02 fois
l'actif des fonds communs de placement.
28
Par exemple, la cote AAA de GE Credit est supérieure à celle
de n'importe quelle banque canadienne.
29
I.J. Horstmann, G.F. Mathewson et N.C. Quigley, « Ensuring Competition:
Bank Distribution of Insurance Products », Institut C.D. Howe, mai
1996, p. 86.
30
C. Freedman et C. Goodlet, « The Financial Services Sector : Past
Changes and Future Prospects », Banque du Canada, Rapport technique
no 82, mars 1998, p. 21.
31
Canada Trust ne remplit pas les exigences du Groupe de travail, puisque
35 % de ses actions en circulation ne sont pas assorties d'un droit de
vote.
32
Concurrence, compétitivité et intérêt public,
Document d'information no 1, p. 193.
33
Changement, défis et possibilités, Rapport du Groupe
de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien, septembre
1998, p. 104-105.
34
« Souplesse d'organisation des institutions financières :
un cadre d'intensification de la concurrence », Document d'information
no 2.
35
Idem., p. 133.
36
Rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises,
décembre 1997, p. 4.2.
37
Rapport du Groupe de travail, Concurrence, compétitivité
et intérêt public, Document d'information no 1, page 112.
38
McKinsey & Company, L'évolution du secteur des services financiers
au Canada : De nouvelles forces, de nouveaux compétiteurs, de nouveaux
choix, Rapport de recherche produit pour le Groupe de travail sur l'avenir
du secteur des services financiers canadien, septembre 1998, pièce
4-4.
39
Euromoney, Euro-gigantisme, février 1998.
40
Charles Freedman et Clyde Goodlet, The Financial Services Sector : Past
Changes and
Future Prospects, Banque du Canada, Rapport technique no 82, p. 25.
41
En janvier 1998, la Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal
ont annoncé leur intention de fusionner, suivies en avril 1998 de
la CIBC et de la Banque TD. Au 31 octobre 1997, les actifs conjugués
de la Banque Royale et de la Banque de Montréal auraient dépassé
450 milliards de dollars, tandis que l'avoir de leurs actionnaires atteignait
près de 20 milliards. Les actifs totaux de la TD et de la CIBC dépassaient
410 milliards de dollars, alors que l'avoir de leurs actionnaires était
de plus de 17 milliards.
42
Charles Freedman et Clyde Goodlet, The Financial Services Sector : Past
Changes and Future Prospects, Banque du Canada, Rapport technique no
82, p. 21.
43
Rapport du Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers
canadien, Concurrence, compétitivité et intérêt
public, Document d'information no 1, p. 141.
44
Comité permanent des finances de la Chambre des communes, délibération,
27 octobre, fascicule 144, 20h15.
45
Donald G. McFetridge, Enjeux liés à la politique sur la
concurrence, p. 101.
46
« L'amélioration structurelle de la réglementation
», Document d'information no 5, p. 25.
47
Comité permanent des finances de la Chambre des communes, Témoignages,
fascicule 147, 29 octobre 1998, 18h35.
48
Ibid., 18h40.
49
À l'heure actuelle, l'assurance-dépôts est généralement
restreinte aux comptes de dépôt libellés en devises
locales. Donc, les comptes en dollars américains dans les banques
canadiennes ne sont pas garantis par la SADC, tandis que les comptes en
dollars canadiens dans les banques américaines ne sont pas protégés
par les garanties de la FDIC.
50
Rapport du Groupe de travail, p. 148.
51
Voir McKinsey & Company, L'évolution du secteur des services
financiers au Canada : De nouvelles forces, de nouveaux compétiteurs,
de nouveaux choix, septembre 1998, pièces 6.33, 6.34.
52
Ibid., pièce 6.25.
53
Ibid., pièces 6.20, 6.21.
54
Ibid., pièce 6.32.
55
Ibid., pièce 6.23.
56
Ibid., pièce 6.22.
57
On peut affirmer que des mesures comme la restriction à l'accès
des banques étrangères, l'assurance-dépôts,
l'accès au système de soutien des liquidités de la
Banque du Canada et la politique de propriété très
large constituent des privilèges accordés au secteur bancaire.
58
Ibid., pièce 2.27.
59
En plus de l'accès au crédit, les critiques concernent le
roulement des directeurs des comptes et le prix des services financiers
: 60 % des répondants à un enquête de la FCEI signalent
qu'ils ont fait affaire avec plus d'un directeur des comptes depuis 3 ans.
60
Loi sur les prêts aux petites entreprises, Banque de développement
économique du Canada, fonds des agences de développement
régional (APECA, PDEC, Programme de développement économique
du Québec), Initiative fédérale de développement
économique du nord de l'Ontario, Société d'aide au
développement des collectivités, Plan d'investissement communautaire
du Canada, Source de financement, Société du crédit
agricole, Aide financière aux organismes culturels canadiens, Entreprise
autochtone Canada, Programme du développement économique
des collectivités, Programme de développement commercial,
Programme de négociation de l'accès aux ressources, Programme
commercial des Premières nations et des jeunes, incitatifs fiscaux
généreux comme le Crédit à la recherche scientifique
et au développement expérimental (RSDE) et le Crédit
au capital de risque de travailleurs.
61
Ibid., pièce 2.43.